-
ALEXIS JENNI : " Féroces infirmes " il parle de son père (membre de l'OAS) dans son nouveau roman

Féroces infirmes

« Jean-Paul Aerbi est mon père. Il a eu vingt ans en 1960, et il est parti en Algérie, envoyé à la guerre comme tous les garçons de son âge. Il avait deux copains, une petite amie, il ne les a jamais revus. Il a rencontré ma mère sur le bateau du retour, chargé de ceux qui fuyaient Alger.
Aujourd’hui, je pousse son fauteuil roulant, et je n’aimerais pas qu’il atteigne quatre-vingts ans. Les gens croient que je m’occupe d’un vieux monsieur, ils ne savent pas quelle bombe je promène parmi eux, ils ne savent pas quelle violence est enfermée dans cet homme-là.
Il construisait des maquettes chez un architecte, des barres et des tours pour l’homme nouveau, dans la France des grands ensembles qui ne voulait se souvenir de rien. Je vis avec lui dans une des cités qu’il a construites, mon ami Rachid habite sur le même palier, nous en parlons souvent, de la guerre et de l’oubli. C’est son fils Nasser qui nous inquiète : il veut ne rien savoir, et ne rien oublier.
Nous n’arrivons pas à en sortir, de cette histoire.»Féroces infirmes
d'Alexis Jenni
Entretien
« Je n’aimerais pas que mon père atteigne quatre-vingts ans. II en a soixante-quinze, il a bien vécu, je ne sais plus comment l’écouter, je ne sais plus comment lui parler, je ne veux plus l’entendre. Je ne veux pas sa mort, ce n’est pas ça, mais je ne sais pas comment faire pour que ça s’arrête. Quoi ? Ce qui brûle en lui, ce qui rayonne par sa parole. Que ça s’arrête, ce radotage, cette vitupération et cette hargne, que ça s’arrête ce récit de sa jeunesse violente qu’il radote à chaque tour avec de nouveaux détails, des détails cruels que je découvre. »
Les derniers mois de la guerre d’Algérie sont au cœur
du roman…
C’est dans cette période de 1961 à 1962 qu’il a été annoncé que la France allait donner l’indépendance à l’Algérie et retirer sa présence militaire. On voit alors le basculement d’une partie de l’armée et de la population pied-noir dans l’activisme et le terrorisme. Tout va se terminer dans un chaos total, le printemps 62 est un enfer où tout le monde tue tout le monde. Cette chute d’Alger a traumatisé douloureusement ceux qui l’ont vécue et, plus confusément, l’ensemble du pays. Pourtant, la mémoire collective a tenté de balayer le problème.
Peut-on parler d’une fuite en avant de la France ?
Je suis fasciné par ce qu’on peut appeler le futurisme gaullien. La France, qui vient de lâcher son empire colonial, se met à coloniser le futur. On construit à tours de bras, on modernise à tout va, aviation, fusées, bombe atomique… Tout se passe comme si on avait décidé de tourner le dos à vingt ans de guerre permanente depuis 1940, d’oublier les vieux problèmes, de créer le pays de demain.
Un des décors majeurs du roman est un grand ensemble, La Duchère à Lyon…
Les grands ensembles sont un des aspects de ce futurisme, et La Duchère a été conçu par un architecte qui avait le sentiment de construire la ville de demain, aérée, verdoyante, avec des logements vastes, lumineux, confortables… Cette utopie urbaine a d’abord accueilli les pieds-noirs rapatriés. Plus tard, le quartier va se paupériser et se dégrader. C’est là que vivent le narrateur et son père, ancien activiste de l’OAS qui n’a rien renié, et sur le même palier la famille Abane dont le grand-père fut un héros du FLN.
Jean-Paul, le père, parti en Algérie comme appelé, a choisi
la violence…
Il va multiplier les mauvais choix, qu’on pourrait qualifier de « virilistes ». Puisqu’on l’envoie à la guerre, il va en découdre, sans limites. Avec le recul, on sait que cette guerre était sans issue, que ces choix-là étaient malheureux, malsains. Mais comment réagit-on sur le terrain quand on vous envoie faire la guerre à vingt ans, puis qu’on vous annonce du jour au lendemain « c’est fini, on laisse tomber » ?
Toujours cette volonté officielle de dire « il ne s’est rien passé » ?
Pourtant le passé ne fait que ressurgir, y compris de façon inattendue. Juste une anecdote : je cherchais un décor pour certaines scènes du roman et, en traversant La Duchère en bus, j’ai aperçu un monument aux morts de la guerre de Quatorze, absurde dans cette ancienne zone agricole. En fait, il s’agit du monument aux morts de la ville d’Oran, transplanté là. Jamais je n’aurais pu imaginer symbole plus éclatant de ce passé qui ne passe pas.
L’image du noyau en fusion au cœur des centrales nucléaires, capable de tout détruire tout comme le noyau dur de la haine, traverse le roman…
La guerre d’Algérie appartient à ce que j’avais appelé dans un ouvrage avec Benjamin Stora « les mémoires dangereuses ». Elle reste un noyau enkysté dans notre histoire contemporaine, qui dégage toujours un rayonnement maléfique malgré le sarcophage de béton dont on a tenté de le recouvrir.
Entretien réalisé avec Alexis Jenni à l’occasion de la parution de Féroces infirmes.
© Gallimard
Alexis Jenni. Ecrivain
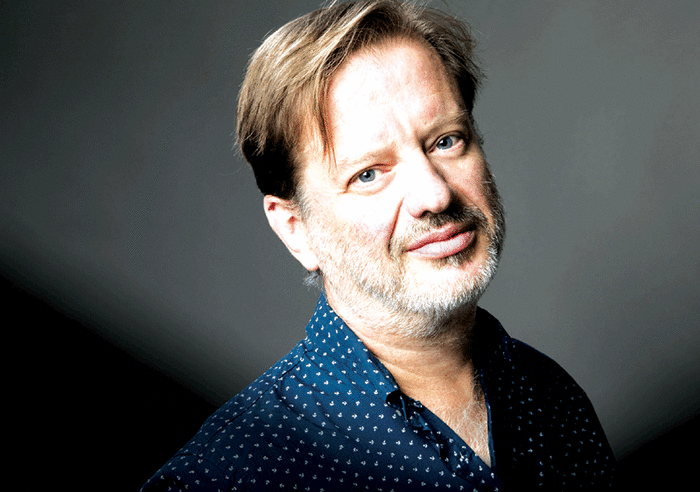
«Le racisme est une façon de rationaliser une violence»

Le nouveau roman d’Alexis Jenni, Féroces infirmes (éditions Gallimard), pousse le lecteur vers une itinérance héréditaire dans le monde destructeur de la guerre d’Algérie, alors qu’on célébrera, vendredi, le 57e anniversaire de l’indépendance. Le narrateur est le fils d’un jeune appelé. Comment recoller les morceaux d’un père brisé par sa plongée au cœur de l’inhumanité et devenu inhumain à son tour ? Le flambeau de ce legs brûle à jamais : «Il a été la jeunesse combattante, il est la vieillesse humiliée, j’hérite de tout.» Le romancier a bien voulu aller plus loin avec nous.
– Après L’Art français de la guerre – dans lequel vous aviez dit un certain nombre de choses sur la guerre en général, et la guerre d’Algérie en particulier – dans Féroces infirmes, on sent que votre projet littéraire est devenu l’art de la déchirure. Est-ce une nouvelle phase de votre critique de la guerre ?
Je plonge dans une guerre traumatique. En France, il y a ce souvenir terrible des jeunes gens qui sont allés se battre. Des jeunes qui n’avaient aucune idée de l’Algérie. Tous les jeunes de 20 ans, à partir de 1956 et jusqu’à 1962, ont participé à ces combats. C’est quelque chose de terrible.
Cette guerre n’était pas très claire, côté français. Assez confuse, autant que le fait colonial l’était. On ne pouvait pas dire qu’on était là pour défendre son pays. Du coup, cet aspect terrifiant est présent dans la mémoire française, dans l’imaginaire. Parce que c’est un moment de grand trouble, d’extrême violence et dont on ne sait pas quoi faire.
– Votre narrateur écrit : «J’écris tout ce que je sais pour avoir le cœur net.» Vous avez le cœur net après avoir fini ce roman ?
Un peu plus. En ayant écrit L’Art français de la guerre et en ayant écrit celui-là, je comprends un peu mieux les choses, quels sont les enjeux, les rôles des protagonistes. C’est vrai aussi que j’écris toujours des sujets que je ne comprends pas bien. Ce qui m’anime, c’est le désir de comprendre.
Même si la guerre commence à dater, puisqu’elle s’est achevée en 1962, soit 57 ans, cela reste un problème mal réglé, qui continue d’agir dans l’imaginaire français.
– Il y a dans votre livre cette autre phrase : «Les pères, leur absence, leurs crimes, un roman.» Pour vous c’est la déraison qui se transmet comme un legs ?
Tout-à-fait. C’est une problématique psychologique, voire psychanalytique. Un traumatisme, s’il n’est pas traité, raconté, mis en récit, va se transmettre intact, de génération en génération. Il traverse le temps. Ces questions, non seulement de la guerre d’Algérie, mais en plus de la question coloniale, n’ont su être racontées. Du coup, c’est quelque chose de tordu qui se transmet.
– Vous abordez d’ailleurs dans le roman la question du racisme, du dédain, du rejet de l’autre, mais peu la question coloniale en soi. C’est un choix de votre part ? Avez-vous éliminé au final des pages sur ce sujet ?
Non, je n’ai pas éliminé de pages. Ce n’était pas mon thème. Pour ça, il aurait fallu que je parle de l’Algérie telle qu’elle était. Moi, mon sujet, c’était la tragédie d’un homme plongé dans la violence. Son racisme est en quelque sorte une mise en forme de la violence. Le racisme est une façon de rationaliser une violence.
Cela me fait penser aux premières manifestations officielles du racisme que sont le code noir à l’époque de Louis XIV. Une façon de codifier la cruauté. Dans la colonie algérienne, le racisme met à distance ceux qui n’étaient pas citoyens : les «musulmans», les «indigènes», les mettre à l’écart pour qu’ils ne participent pas à la vie sociale.
– Dans votre livre, il y a trois générations : le grand-père, qui a été collabo durant la Seconde Guerre mondiale, sur lequel on passe vite, le père, qui a fait la guerre d’Algérie et qui est au centre du roman, et le fils, perdu dans cet héritage. Ce qui est intriguant dans votre roman, c’est le père qui a fait la guerre et en revient traumatisé. Vous le décrivez jeune comme un personnage gentil, presque attachant. Comment l’Algérie va-t-elle le transformer durement au point de le faire rentrer dans la folie ?
Il y a une escalade de la violence. Au début, il est envoyé en Algérie comme tous les jeunes gens. Peu à peu, plutôt que d’attendre que ça se passe, il rêve d’être un guerrier pour ne pas avoir peur. Il participera à un commando de chasse…
Puis quand on commence à dire que la guerre va finir, il passe à l’OAS dans des petits groupuscules fascistoïdes violents, qui finiront par se détruire eux-mêmes. La scène où il se fait torturer par ses collègues qui le soupçonnent de traîtrise est le moment où il craque vraiment. Tout ce sur lequel il avait basé sa vie depuis deux ans s’effondre, dont la camaraderie virile.
– C’est la force de la fiction et de la narration, mais pourquoi de retour d’Algérie votre personnage ne reprend-il pas une vie normale avec boulot, femme et enfants ?
Une vie normale, c’est souvent compliqué quand on a vécu ce qu’il a vécu, alors qu’il a joué le jeu de la violence. Ces jeunes gens qui ont appris la guerre sont déstabilisés. Ils ont laissé libre cours à une violence dont ils ne savent que faire au retour.
Vous vous êtes du reste documenté sur des témoignages de gens qui ont vécu difficilement ce retour ?
Il y a eu pas mal de groupuscules de gens d’extrême droite au début des années 1960 qui rêvaient d’en découdre, anciens d’Algérie ou pas. Il y a eu à un moment comme quelque chose qui a été voilé, comme une roue de vélo. La fréquentation de la violence les avait modifiés. Jusqu’en 1968, il y a eu des violents qui voulaient se battre. C’est une caractéristique des années 1960 en France. Le Front national a récupéré ces gens lors de sa création.
Extrait : Honte d’avoir accepté de venir, honte d’obéir
à tout
«On l’a emmené à l’écart, il a disparu comme disparaissent les hommes de ce pays. Peut-être que la guerre sera finie quand tous les hommes auront disparu ? Il ne faut pas y compter, j’ai croisé son regard. Cette nuit-là j’ai pris la décision de ne pas sangloter en serrant l’oreiller.
Je ne veux pas être ça. J’ai croisé les yeux de l’homme que nous avons capturé, il a plongé son regard dans le mien, son regard dur et opaque est entré dans l’eau de mon regard, il y est tombé comme une pierre et il m’a redressé. J’ai pris la décision de garder les yeux secs quoi qu’il en coûte, à son exemple.
J’ai honte d’être là, honte d’avoir accepté de venir, honte d’obéir à tout, honte d’attendre, honte d’en être réduit à attendre, attendre qu’on me tue ou que l’on me libère, honte d’attendre que quelqu’un ou quelque chose décide pour moi.
Alors soit je m’enfuis, soit je me bats. (…) Je préfère ressembler aux loups maigres que nous chassons plutôt qu’aux chiens domestiques que nous sommes, qui boivent le soir au bar du poste pour tuer l’ennui et noyer la peur.»
« Par sa passivité la majorité se fait complice...L’honneur de l’Europe a un visage : Carola Rackete a forcé l'entrée du port de Lampedusa, devant la situation humanitaire des migrants que transportait son bateau. »
-
Commentaires





Oui, bien qu'ayant été en Algérie à la même époque que le père de l'auteur mon parcours ne ressemble en rien au sien. Sans doute les circonstances ont fait que j'ai été épargné. A dû jouer également la conscience que j'avais du colonialisme et de la guerre menée pour tenter de le maintenir.
J'ai souffert de l'institution militaire, de son absurdité, de sa violence répressive qui atteignait non seulement ceux d'en face mais ceux qui comme je l'étais avaient été repérés comme non conformes à la réalisation du projet en cours.
Je garde surtout de cette période le gâchis de 26 mois de ma jeunesse qui m'ont été volés et du décalage subi lors de mon retour à la vie civile.