-
"Les clés retrouvées." de Benjamin Stora
"Les clés retrouvées."

Lorsque la mère de Benjamin Stora est décédée en 2000, il a découvert, au fond du tiroir de sa table de nuit, les clés de leur appartement de Constantine, quitté en 1962. Ces clés retrouvées ouvrent aussi les portes de la mémoire. La guerre est un bruit de fond qui s’amplifie soudain. Quand, en août 1955, des soldats installent une mitrailleuse dans la chambre du petit Stora pour tirer sur des Algériens qui s’enfuient en contrebas, il a quatre ans et demi et ne comprend pas.
Quelques années plus tard, quand ses parents parlent à voix basse, il entend les craintes et l’idée du départ. Mais ses souvenirs sont aussi joyeux, visuels, colorés, sensuels. Il raconte la douceur du hammam au milieu des femmes, les départs à la plage en été, le cinéma du quartier où passaient les westerns américains, la saveur des plats et le bonheur des fêtes. Ces scènes, ces images révèlent les relations entre les différentes communautés, à la fois proches et séparées. Entre l’arabe quotidien de la mère et le français du père, la blonde institutrice de l’école publique et les rabbins de l’école talmudique, la clameur des rues juives et l’attirante modernité du quartier européen, une histoire se lit dans l’épaisseur du vécu. Benjamin Stora a écrit là son livre le plus intime.
À travers le regard d’un enfant devenu historien, il restitue avec émotion un monde perdu, celui des juifs d’Algérie, fous de la République et épris d’Orient.
INTRODUCTION
« Les souvenirs, à commencer par les souvenirs d’enfance, sont toujours plus ou moins reconstruits, déformés. Nous les entretenons avec soin, nous y tenons comme à des êtres aimés. Peu nous importe qu’ils soient ou non des fictions, tant ils nous sont précieux. Ils sont la preuve de notre singularité. » Jean-Bertrand Pontalis .
C’était le 20 août 1955. J’avais quatre ans et demi. Il faisait très chaud ce jour là dans notre petit appartement de Constantine, situé en face des gorges du Rummel. Et puis, brusquement, des soldats sont entrés. Ils ont ouvert la fenêtre, installé une sorte de trépied, et posé une mitrailleuse dessus. Ils ont tiré. Le bruit était épouvantable. Les douilles sautaient, et une odeur âcre a envahi ma petite chambre. Sur qui, sur quoi tiraient- ils ? Les soldats formaient une masse grise et floue. Je me souviens surtout de ma terreur au moment de leur entrée dans la pièce. Cet événement me mit pour la première fois en présence de la mort. Longtemps, j’ai cru que cette scène de guerre, qui revenait dans mes rêves, était tirée d’une séquence de film. Mais au fil de mes études sur l’histoire de l’Algérie, j’ai compris. Le 20 août 1955, j’avais bien vu des soldats français qui tiraient sur des Algériens s’enfuyant le long des gorges du Rummel, de l’autre côté de notre maison. La guerre d’Algérie était cachée dans les plis de ma mémoire d’enfant.
Tout au long de mon travail commencé dans les années 1970, j’ai peut-être sans cesse cherché, inconsciemment, ces lambeaux de vie personnelle capable de renouveler aussi bien l’histoire événementielle que celle de la longue durée. Des petits faits qui lèvent le voile, et dévoilent une histoire toujours difficile à saisir, à comprendre. Celle de l’Algérie pendant la présence française, où les communautés, sous le drapeau de la République, vivaient ensemble dans l’espace public, sans se mélanger (ou rarement) dans l’espace privé. Une histoire d’attraction, de force du modèle républicain, qui mettait au secret les origines. Avant d’aborder mon récit d’enfance, prenons ainsi ce fait, dont je me suis rendu compte très récemment. J’ai cru toute ma vie que j’avais appris à lire et à écrire par le biais de la langue française. Et bien ce n’est pas si simple. Les petits enfants de la ville très pieuse de Constantine allaient, dès l’âge de quatre ans, au Talmud Torah (l’école juive, que l’on appelait « l’Alliance », on verra pourquoi par la suite). J’ai donc commencé à lire des lettres…. par l’hébreu. Je parlais l’arabe à la maison, avec ma mère. Mais je ne comprenais pas l’hébreu, et ne lisais pas l’arabe. L’école française est arrivée ensuite très vite, et, bien sûr, c’est là que j’ai appris à lire et à écrire. L’arabe et l’hébreu se sont progressivement effacés, et j’ai réalisé ce que le mot « assimilation » pouvait vraiment signifier…
Autre exemple, pêle-mêle, dans le précieux désordre du sac de la mémoire où sont enfouis le futile et l’indispensable. Au moment du grand déménagement de mon pavillon que j’ai quitté en 2013, j’ai enfin ouvert la boite d’archives concernant mon père, que je n’avais jamais touchée depuis son décès en 1985. Mon père a inscrit sur la boite le mot « Souvenirs », de sa belle écriture. Je découvre toutes sortes de papiers : la facture d’achat du frigidaire « Amiral », en 1958, chez les Cohen-Haddad ; le récépissé d’une demande de paiement d’impôt en 1961 (et mon père paiera tous ses impôts au moment du départ vers la France en juin 1962) ; une carte postale envoyée de Vichy par mes grands-parents en 1935 ; une lettre disant le décès d’un oncle ; une copie de son diplôme de baccalauréat passé en langue arabe, et un vieux livre de la Haggada, le livre de Pessah, la Pâque juive… Je lis lentement, tourne et déplace chaque document avec précaution, et suis bouleversé. Dans l’exode et dans chaque déménagement, mon père a donc tenté de sauvegarder quelques traces de sa vie passée. Il y a surtout des documents sur la guerre, celle de 1939-40, avec un carnet personnel où il a noté au jour le jour entre le 10 mai et le 28 mai1940, la débâcle de son unité. Il y a la lettre de mon grand père demandant que sa nationalité française soit préservée, après l’abrogation du décret Crémieux, en octobre 1940. Mon père a gardé ce document où mon grand-père, Benjamin, a plaidé pour la restitution de ses biens confisqués à Khenchela et attribués à un « Français de souche ». Mais les biens ne lui ont pas été restitués dans leur totalité. Il est mort un an après, en 1945.
Pour mon père, à l’évidence, pas question de jeter ces papiers à la poubelle. Il ne voulait pas que tout cela tombe dans l’immense espace de l’oubli. J’ignorais jusque là sa volonté de laisser une trace de sa vie, de notre vie ensemble. Je découvre les photographies soigneusement collées dans des albums. Je les regarde longuement, cherchant une date, une explication. Je reviens en arrière, me transporte dans des lieux. Mon père a gardé mes photos de classe, prises année après année. Mais au dos, aucun nom de mes camarades de l’époque. J’essaie de reconstituer, d’imaginer… Je les ai tous perdus, je ne les ai plus jamais revus. Aucun. Nous avons été dispersés par l’exode, l’exil, le vent de l’histoire.
Un voyage à Bejaia en 2014, en Kabylie, où a été mis en scène sous la forme d’une pièce de théâtre, mon livre Les trois exils, Juifs d’Algérie, me pousse à revenir sur cette histoire judéo-berbère. Le public de Bejaia (l’ancienne ville de Bougie) est nombreux, attentif, en attente de restitution de cette séquence disparue . Il faut que j’écrive cette histoire d’enfance, j’hésite. La mémoire est sélective, je trie, voit la remontée des souvenirs en regardant ces archives familiales. On ne peut pas tout garder. Mais j’avance sous l’impulsion de mon éditrice, Nicole Lapierre. Elle m’encourage, je me décourage, puis je reprends finalement l’écriture. Comment découper, raconter cette histoire d’enfance ? En suivant un ordre chronologique ? En évoquant la « grande » histoire de la guerre d’Algérie, moment où se déroule mon enfance ? En associant librement des propos, sans tenir compte d’une cohérence linéaire ? L’enfance est comme hors-temps, un bloc où tout se mêle : des héros de bandes dessinées ; le corps différent des filles découvert sur la plage de Philippeville (aujourd’hui Skikda) ; la petite boutique du marchand de bonbons au nom imprononçable (« chouailem », vraisemblablement une abréviation de « chalom ») vers laquelle je courrais ; le cinéma de mon quartier où des péplums italiens, des western américains me faisaient rêver …
Mon père, ma mère, et ma sœur (nous étions une petite famille) étaient toujours près de moi lors de promenades le soir après diner, sur la grande Place de la Brèche. Là, nous dégustions des petits « créponnets » de glaces Il n’y a pas de souffrance dans le rappel de ces moments heureux. Et pourtant la guerre (les « événements ») était là, et bien là.
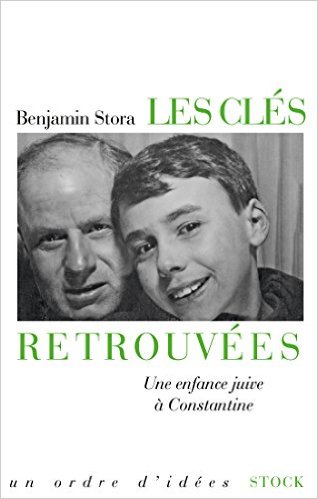
Par Jean-Paul Mari
© TOUS DROITS RESERVES
SOURCE : http://www.grands-reporters.com/Les-cles-retrouvees.html
« Tahar Ben Jelloun - Cet enfant, c'est l'humanité échouée ! MISE A JOUR : LA VIDEO TERRIBLE Elisabeth: «Moi aussi, je me suis sentie longtemps en exil!» "Nous sommes tous des exilés" par Ben »
-
Commentaires




