-
Le silence du radio : le témoignage de Michel Francout

« Qu’est-ce que tu veux que je lui dise au psychologue ? Qu’est-ce qu’il va faire pour moi ? Tu crois peut-être qu’il va pouvoir me rendre toutes ces années gâchées, bousillées par cette putain de guerre ? Tu crois que lui raconter ce que je ne vous ai jamais raconté m’empêchera de chialer quand je vois, à la télé, des mômes rentrer d’Afghanistan ou du Mali où ils vont faire des guerres sans savoir pourquoi ? Quand je vois les petits Ricains qui se prennent pour des grands G. I. et qui ne voient pas la mort en face devant leur écran d’ordinateur comme moi je ne la voyais pas devant ma radio ? Si tu veux vraiment que je raconte à quelqu’un ce qui m’est arrivé à moi, trouve-moi autre chose qu’un psychologue… »
C’est ainsi que commence le témoignage de Michel Francout « Le silence du radio »
Le silence du radio

Michel Francout avec son épouse et sa fille Béatrice
Michel Francout a séjourné en Algérie, dans la région de Constantine, de décembre 1958 à novembre 1960. Son récit sur la guerre d'Algérie a été composé par Annick Madec, spécialiste de la sociologie narrative, de l'Université de Brest. C'est à la demande de sa fille Béatrice que cette sociologue a accepté de rencontrer Michel, afin de recueillir le témoignage dont il voulait faire part.
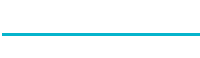
N’avait-on pas constaté, au moment de l’armistice, que les gens revenaient
muets du champ de bataille — non pas plus riches, mais plus pauvres en expérience communicable ?
Walter Benjamin, « Le conteur », Oeuvres III, Gallimard/Folio, 200016
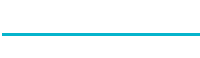
Qu’est-ce que tu veux que je lui dise au psychologue ? Qu’est-ce qu’il va faire pour moi ?
Tu crois peut-être qu’il va pouvoir me rendre toutes ces années gâchées, bousillées par cette putain de guerre ? Tu crois que lui raconter ce que je ne vous ai jamais raconté m’empêchera de chialer quand je vois, à la télé, des mômes rentrer d’Afghanistan ou du Mali où ils vont faire des guerres sans savoir pourquoi ? Quand je vois les petits Ricains qui se prennent pour des grands G. I. et qui ne voient pas la mort en face devant leur écran d’ordinateur comme moi je ne la voyais pas devant ma radio ? Si tu veux vraiment que je raconte à quelqu’un ce qui m’est arrivé à moi, trouve-moi autre chose qu’un psychologue. Un historien qui pourra mettre ça dans ses archives et le raconter après à d’autres, à des jeunes pour qu’ils comprennent qu’il ne faut pas marcher quand on t’envoie à la guerre. Je sais que les jeunes d’aujourd’hui, ils savent bien plus de choses qu’on en savait nous, à vingt ans, ils ne se laisseraient pas faire comme nous on l’a fait. Nous, on était des moutons, sages comme des agneaux. Avec la télé, Internet, et tout ça, les jeunes, maintenant, ils sauraient se défendre. Moi, depuis que je suis à la retraite et toujours devant la télé, ça me revient tout le temps. Et c’est pas vrai que c’était le bon temps.
Rendez-vous pris par sa fille, une femme de cinquante ans, commerçante, militante associative, préoccupée par l’état de santé de ce père auquel elle s’est opposée durant toute sa jeunesse.
À défaut d’historien disponible, elle s’est tournée vers la sociologie afin qu’une discipline universitaire recueille le récit d’un « ancien » d’Algérie et fasse part de ses expériences à des étudiant(e.s). L’épouse m’accueille et me dit discrètement : il n’est pas encore descendu sieste. Et ajoute très vite : Un homme pas facile qui l’use avec ses discours racistes et violents. Elle a beau lui dire : « Mais c’est loin, c’est fini depuis longtemps tout ça. » Non, rien n’y fait. Il rabâche tout le temps la même chose. Mais il a des excuses dont il ne me soufflera sans doute pas mot : on connaît les hommes, ils ne disent pas ces choses-là, et pourtant, ça compte ; quand il est parti là-bas, il était déjà malheureux, il avait perdu sa mère. Et puis, on a fait beaucoup de travaux dans cette maison avec notre fils qui a eu un accident. Ils se disputaient souvent tous les deux, ils n’ont pas eu le temps de s’expliquer ni de finir les travaux. Notre fils est mort. Et depuis, ce n’est vraiment pas facile.
Il arrive, elle nous sert un café, parle à nouveau des travaux faits avec le fils. Il l’interrompt brutalement : elle n’est pas là pour entendre parler de ça. L’épouse s’éclipse. Il reprend aussitôt, et lance les larmes aux yeux : on est là pour parler de napalm. De napalm et de barbelés électrifiés. Je comprends qu’il vient de livrer en trois mots le secret qui a empoisonné l’existence de sa famille, d’après sa fille, toutes ces années. Il parlera ensuite quasiment sans s’interrompre durant deux heures. Perturbée par son récit, je trouve le moyen d’effacer ce monologue au moment de partir. Consciente que ce qui a été raconté ce jour-là ne pourra jamais être repris de la même manière un autre jour, il me restait à imaginer ce qu’il a pu penser après mon départ.
Mais qu’est-ce qu’elle a pu comprendre à ce que je lui ai raconté la petite sociologue qui pourrait être ma fille ? Comment elles pourraient comprendre ces bonnes femmes ce qu’un bonhomme comme moi a dans la tête ? Comment elles pourraient comprendre alors que moi-même je ne peux pas comprendre que je me mette à chialer comme un môme devant cette nana et son magnétophone? Je ne sais pas ce qu’elle a compris du napalm. C’est pas ce que je pensais lui dire au départ, c’est sorti tout seul, dès qu’elle a mis son engin en route, c’est parti. Faut dire que ça fait quelque temps que j’ai ça sur l’estomac. Même si je lui ai dit et répété que non, je n’ai jamais fait de cauchemars à cause de l’Algérie. Je sais bien, ils disent tous ça les appelés qui racontent leur guerre. Mais moi, non, pas de cauchemars. Enfin, je ne crois pas. Mais ça me rend dingue que les jeunes, mes enfants, leurs enfants aussi sans doute, nous prennent pour des assassins. Qu’ils ne comprennent pas qu’on n’avait pas le choix, qu’à vingt ans, en 1958, quand on bossait déjà depuis cinq ans, on ne savait rien. On était cons, il faut le dire, dociles comme des agneaux. Le père s’était tapé 45, cinq ans prisonnier. Son père avait fait 14/18. C’était notre tour et quand faut y aller, faut y aller. Mon vieux pas plus que mon frangin savaient qu’en 58, c’était dix gars qui tombaient par jour. Mais il y a des choses qui ne sont pas dures à comprendre pourtant. Moi, bien sûr, que j’étais fier d’avoir tellement bien réussi les tests d’aptitude qu’on me mette radio. Évidemment quand tu t’es fait virer de ton apprentissage de cuisinier parce que tu ne supportais pas que le patron te colle des calottes, quand tu fais le manœuvre pour pas grand-chose depuis des années, radio, c’est autre chose. Tu apprends le langage, la technique. Et puis quand tu n’as pas eu trop l’occasion de voyager, ben, l’Algérie, tu ne connais pas et tu te dis que tu vas voir du pays. Tu es comme les autres couillons. De ces mecs qui ont d’abord appris le maniement des armes avec du carton et de la pacification. Ça, c’étaient les discours des officiers. Les sous-officiers, les sergents qui avaient fait l’Indochine, eux, ils n’hésitaient pas. Ils n’ont pas attendu 1999 et la reconnaissance officielle de l’Assemblée nationale pour dire que c’était la guerre. On n’était pas là pour s’amuser. Mais qu’est-ce qu’on comprenait nous ? Pas grand-chose, et on a quand même rigolé, des fois. On s’est aussi emmerdé. Et on a sifflé les filles. C’est bien à cause de ça que je me suis retrouvé sur ce fameux piton où on se faisait larguer de la viande datée de 1938, des barils de 200 litres de vin qu’il fallait boire dans les trois jours avant que la chaleur le rende imbuvable. Muté parce que je n’avais pas donné le nom d’un copain qui avait sifflé la poule d’un trois-galons, sa secrétaire, qui se baladait à poil ou presque dans le campement. Au lieu de sanctionner les appelés, des mecs de vingt ans, ce connard ne pouvait pas dire à sa nana de s’habiller, non ? En tous les cas, il a fait dégager un radio à deux mois de la quille et moi, je me suis retrouvé radio en pleine montagne de mars à septembre. Plus de drapeaux, moins de corvées, moins de discipline parce que plus de danger et moins nombreux : quarante dont la moitié de bougnoules. Mais du pro Français. Un poste qui avait été pris d’assaut en février, 31 morts dont un officier et un soldat, le reste, c’étaient des bougnoules. La Légion était à 200 mètres au-dessus de nous. Il y avait des appelés jaloux qui disaient que les radios étaient des planqués, qu’ils couraient moins de risques. Sauf que moi, j’étais tout seul comme radio là-haut, donc 24/24 et 7/7, en dormant toujours d’un œil et d’une oreille. Branché sur ma radio sans arrêt. Dans un coin comme ça, la radio, c’est le point de mire. Quand le mec dans son zinc me contactait : « demande de position de mechtas », c’était un ordre, fallait l’exécuter. Fallait répondre, transmettre les coordonnées données par l’officier ou lire la carte. Après, est-ce que j’avais vraiment conscience qu’il allait larguer des bombes de 500 kg de napalm ? Est-ce que je peux vraiment dire maintenant ce que je pensais quand j’avais vingt ans ? Je ne crois pas. À vingt ans, on est inconscient. Et puis, ça ne se passait pas sous mes yeux. Je ne voyais rien. Est-ce que je savais ce que ça faisait le napalm ? Je ne crois pas. Mais je savais à quoi allait servir ma génératrice, 220 volts en continu, que je devais prêter aux deux anciens d’Indochine qui avaient un fellaga à dérouiller. Ou une femme, je savais aussi que les femmes, il n’y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, des jeunes, ils les violaient avant de les passer à la gégène. Je ne savais pas tout mais je sais qu’un jour, il y a une qui a parlé. Et j’avais compris que pour torturer, il faut être sadique, il faut aimer ça. Les deux anciens d’Indochine, ils aimaient ça. Et c’est vrai ce que je lui ai répondu à la sociologue qui m’a demandé directement si moi, j’avais quelque chose à me reprocher, je lui ai dit :
« Non, personnellement, non, je n’ai rien à me reprocher. » Mais c’est tout aussi vrai, ce que je lui ai dit après, et merde, je crois bien que là encore, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurnicher en lui disant : « Il n’aurait pas fallu demander à des appelés de faire ce qu’on leur a demandé de faire. » Parce que la torture, bon, on peut dire que j’ai passé du matériel, je n’aimais pas ça mais c’était la guerre, et c’étaient pas non plus des tendres qu’on dérouillait. Même si les femmes quand même, moi, je n’aurais pas pu. Les hommes non plus d’ailleurs. Même pas les animaux. Mais le napalm, c’est autre chose, ça crame tout, les femmes, les enfants, les champs, tout. Et c’est moi qui disais où la bombe devait tomber. Sur qui elle allait tomber. Sur quoi. J’ai compris après, en voyant des films, des documentaires. Avec le Vietnam après, j’ai vu, j’ai compris. J’étais radio, je transmettais des positions. Je n’ai jamais su si la petite Djamila avec qui je parlais des fois quand je suis arrivé là-bas, dans ma première caserne, et qui avait disparu avec ses parents sans qu’on sache pourquoi ils étaient partis ni où ils étaient partis, s’est retrouvée sous un bombardement. J’y pense souvent et je ne saurai jamais ce qu’elle est devenue. Une gamine de paysans, un peu comme moi. On parlait en tout bien tout honneur, elle était gentille. Peut-être que, quand même, j’étais moins naïf que ce que j’ai raconté à la sociologue. Peut-être que c’était à cause de la disparition de Djamila que j’avais fait une demande pour être engagé dans les SAS au lieu de quitter l’Algérie à la fin de mon service. Les SAS, c’étaient quand même des missions d’assistance aux populations rurales, la promotion pacifique de la France. Et il n’y en avait pas beaucoup de radios de 22 ans prêts à rester en Algérie fin 60. L’armée ne voulait pas me lâcher, elle m’a envoyé les poulets voir ce que je devenais de retour en France parce que je ne m’étais pas présenté à la gendarmerie pour répondre de mon engagement. Mon frangin n’était pas d’accord, il voulait que je rebosse avec lui et notre vieux dans le bâtiment. Et moi, je voulais plus être emmerdé, recevoir d’ordres. J’ai dit merde au frangin, à l’armée, à la fille qui voulait me passer la corde au cou. Personne ne parlait de la guerre mais on plaisait bien aux filles quand on revenait bronzés comme les bougnoules et pleins aux as. J’ai flambé en deux mois tout ce que mon père avait gardé pour moi du temps où j’avais travaillé avec lui. Une java de deux mois avec mon pactole. La java parce que j’étais furieux. Voyage du retour, fin novembre 60, je me fais engueuler par un flic parce que j’avais gardé ma tenue militaire sans autorisation. Engueulé par un contrôleur parce que je n’étais pas dans le bon train, j’avais fait un crochet pour aller voir un copain à Lyon. Ma fille dit que je suis toujours en colère, c’est peut-être vrai que je suis resté en colère depuis ce temps-là. La java pour faire passer ma visite aux parents d’un copain, fils unique, qui avait pris deux cartouches dans le buffet lors d’un accrochage. Je m’étais promis de ramener ses affaires à ses parents, je l’ai fait, mais je savais qu’il faudrait aussi que j’aille après à l’enterrement d’un autre copain qui s’est pendu quelques semaines après notre retour en France. Alors quand on m’a proposé du boulot à Trappes, j’ai dit non. Déjà rebosser dans le bâtiment, c’était pas ce que je voulais, je regretterai toujours d’avoir lâché la cuisine. Et là-bas, c’était presque l’Algérie en 61. Je voulais un peu la provoquer, la sociologue, quand je lui ai dit qu’il aurait fallu que je travaille avec un cheptel de bougnoules. Mais ils m’emmerdent ces intellos qui ne l’ont pas faite, eux, cette guerre. Facile après de dire, l’agneau docile avait besoin de voir les travailleurs algériens comme des animaux pour se disculper d’avoir participé à bombarder des villages peuplés par les familles de ces ouvriers. Facile. Trop facile. De toutes façons, moi, à partir de ce moment-là, j’ai foutu le camp en Bretagne où il n’y avait pas un Arabe à l’horizon et j’ai dit : « Silence radio. » L’Algérie, c’est fini, motus et bouche cousue. Pour s’en sortir dans la vie, faut pas être faible. Faut savoir se taire et savoir se faire obéir. Au moins par sa femme, ses enfants, et si possible ses ouvriers. J’ai rencontré ma femme en 1965, elle était serveuse dans le restaurant où j’allais tous les midis. Je ne lui ai jamais raconté tout ce que j’ai raconté aujourd’hui à la sociologue. Jamais. Jamais rien dit. À personne. Pas même aux gars de la FNACA, on n’était pas du même coin et donc on n’a pas été envoyés dans les mêmes coins. Et puis il faut savoir que si on était 400000 en Algérie, on n’était que 100000 dans des secteurs où on se faisait taper sur le museau. Là-bas non plus on ne se parlait pas, entre appelés, jamais on parlait de ce qui se passait, de ce qu’on faisait, de ce qu’on nous faisait faire. On ne parlait pas de la guerre. Dès qu’on pouvait, on picolait, on déconnait. On avait 20 ans. Ailleurs, je ne sais pas comment c’est, mais ici, dans les repas d’anciens combattants on ne parle jamais de l’Algérie. Non, le seul avec qui j’ai reparlé de l’Algérie, c’est mon patron. Et ça, je ne sais pas ce qu’elle en a pensé la sociologue quand je lui ai raconté ce drôle de concours de circonstances. Je lui ai dit que j’avais retrouvé autour d’un verre de rouge un jour sur le port un ancien de la légion, deux galons là-bas, trois à son retour, qui m’a reconnu. C’est lui qui m’a abordé en me demandant où j’étais début 59. C’est lui qui m’a rappelé que je lui avais servi de radio quand le sien s’était fait allumer en allant bêtement chasser le pigeon autour de leur poste. J’avais fait l’intérim et pas n’importe quelle semaine encore. Opération « rouleau compresseur » : nettoyage de mechtas à la grenade dans des secteurs fermés aux barbelés électrifiés. Il y avait une ligne téléphonique qui marchait un jour sur trois et il n’avait plus de radio. Donc sa messagerie passait par moi. J’étais chef de chantier, je faisais des bonnes journées. Et il faut bien le dire : l’Algérie ne m’empêchait pas de dormir. Je ne faisais pas de cauchemars. Mais quand j’ai retrouvé ce galonné et qu’il m’a dit qu’il allait être mon patron, ça m’a fait quelque chose. J’y pensais plus aux barbelés mais là, avec lui devant moi, lui qui aimait bien boire son petit coup et qui me disait qu’avoir fait ensemble le rouleau compresseur crée des liens, je me suis dit que l’Algérie, c’était pas fini. Vingt-cinq ans après. On était en 1983/1984. Mais non, on en a parlé ce jour-là mais c’est jamais revenu. Et pourtant il est resté mon patron, on se voyait tous les jours ou presque. Peut-être que j’avais dit à ma femme que mon patron était un ancien d’Algérie mais ma femme, de toute façon, elle n’a jamais rien su du rouleau compresseur. Donc ça s’est arrêté là. C’est bien possible que la sociologue, qui n’est pas psychologue, j’ai bien compris, pas plus que ma fille, mais elles sont toutes pareilles, ait pensé que ce n’est pas vrai, et que bien sûr, ça ne s’est pas arrêté là. Je l’ai bien vu à la façon dont elle m’a regardé qu’elle se disait que ce n’était pas une mince affaire que d’avoir à nouveau ce gradé comme chef. C’est sûr que pour oublier, c’était pas facile avec ce galonné sous les yeux. Mais bon, il a bien fallu qu’on travaille avec tout le monde et on en a eu aussi des bougnoules avec nous sur les chantiers, bon, on a fait avec, sans problème. Je les ai traités comme les autres. Je lui ai dit, à la sociologue, j’ai été honnête que je ne me rappelle pas de tout, précisément. Pourtant, il y a des copains que j’aimerais revoir maintenant mais je ne sais pas où les trouver. Pourtant, j’avais gardé une valise entière de cartes, de photos, de lettres, d’adresses et tout ça, mais mon oncle a tout brûlé quand il a vidé la maison de mon père après sa mort. Quand j’ai su ça, là aussi, j’étais dans une colère noire. Peut-être qu’il y a des gars de mon âge qui regrettent de ne pas l’avoir faite l’Algérie, c’est vrai que sur le moment, on en a bavé, on a eu la trouille, mais je ne suis pas sûr qu’on était vraiment malheureux. Je ne crois pas. On était inconscients. On tenait à notre peau, on savait bien que ceux qui s’opposaient à cette guerre étaient envoyés en expédition, avec un simple poignard, sans arme à feu, avec des chances quasi nulles de s’en sortir. C’est des années plus tard qu’on comprend et qu’on se demande ce qu’on est allé faire là-bas. Qu’on comprend qu’on n’avait pas à fourrer notre nez là-bas. Qu’on se demande ce qu’on a vraiment fait là-bas. Que je me demande ce que j’ai fait.
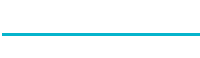
Publication de « La sociologie narrative : un artisanat civil » de Annick Madec
Paru dans « Sociologie et sociétés » • vol. XLVIII.2
Laboratoire d’études et de recherche en sociologie. (LABERS)
Université Bretagne Occidentale
« CHENOVE (Côte-d'Or) : Une conférence tournée vers la guerre d'AlgérieTémoignage d'Hubert Rouaud ancien appelé de la guerre d'Algérie »
-
Commentaires




