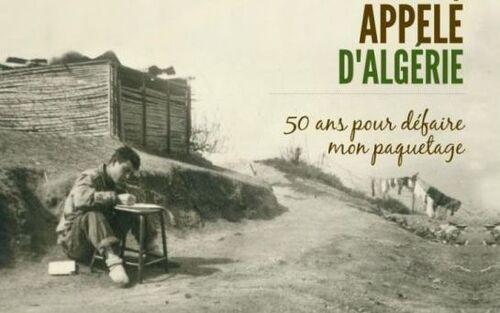-
Par micheldandelot1 le 16 Septembre 2014 à 08:01
Saint-Usuge
La FNACA perd des effectifs (décès)
Malgré de nouvelles adhésions
Le secteur FNACA de Saint-Usuge tiendra son assemblée générale le 18 octobre à 17 heures. Photo Y. C. (CLP)
François Buguet et les membres de la section FNACA de Saint-Usuge organisaient, vendredi après-midi, une réunion du secteur 10 de la Bresse, animée par Jacques Devaux, le responsable départemental et rédacteur de la feuille départementale de l’ancien d’Algérie.
À l’heure des bilans, le secteur affiche 734 adhérents dont six nouveaux, le département 8491, dont 63 nouveaux, et à l’échelle nationale 328606, dont 5450 nouveaux.
Parmi les sujets traités, ont été abordés les velléités du gouvernement de remettre en cause les droits à réparation accordés depuis 1918 et certains avantages des retraites.
C’est à Louhans, le 20 novembre, au Palace, qu’aura lieu le congrès départemental, suivi du repas en salle du Marais à Branges.
Le comité départemental aura lieu à Sanvignes, le 9 octobre, avec les renouvellements du comité, du bureau et du président.
Perrecy-les-Forges
349 adhérents sur le secteur pour la FNACA
Le bureau a fait le point sur les effectifs et les différentes manifestations.
Photo M. F. (CLP)
Lors de la dernière réunion de la Fnaca, le président Michel Guinet a ouvert la séance en demandant une minute de silence pour tous les adhérents disparus. Il a ensuite annoncé un effectif pour le secteur 5 de 349 adhérents, dans les communes de Toulon-sur-Arroux (83) Palinges (35), Sanvignes (77), Génelard (49), Ciry-le-Noble (43) et Perrecy-les-Forges (62), impliquant également quatorze veuves.
Au niveau départemental, la FNACA compte 8491 adhérents. Pour la commémoration du 11 Novembre, le rassemblement se fera à 10 h 15 place de la Mairie avant le départ du défilé. Plusieurs informations sur les prochaines réunions ont été données : le conseil départemental (séance plénière) se tiendra jeudi 9 octobre à Sanvignes. Le congrès départemental aura lieu jeudi 20 novembre à Louhans, avec repas à Branges, Georges Ratajac fera partie des nominations et se verra remettre le diplôme ainsi que la médaille offerte par le congrès départemental.
Dimanche 16 novembre à midi, la FNACA organisera son repas coq au vin, animé comme chaque année par Damien Poyard. Tarif : 22 €, inscriptions dès maintenant auprès des responsables. La cotisation pour l’année 2015 est fixée à 22 €, 20 € pour les adhérents perrecycois.
Marie-Claire Vigot a fait remarquer que la section compte 14 veuves sur Perrecy, 48 sur le secteur et 1 294 sur le département. Elle continue de participer aux réunions afin de mieux renseigner les veuves sur leurs droits.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par micheldandelot1 le 15 Septembre 2014 à 11:10

« Rentré chez moi, dans une contrée de prairies et de forêts, j’ai décidé de me libérer de l’Algérie, comme si je m’opérais d’un cancer, en écrivant ». Ainsi se conclut cet ouvrage qui évoque les cahiers de Louis Barthas, combattant de la Grande Guerre, qui se mit à l’écriture juste après la signature de l’Armistice. Michel Bur, sous-lieutenant dans un régiment de l’arme-blindée-cavalerie en Algérie en 1960-1961, devenu professeur d’université et archéologue, médiéviste distingué, membre de l’Institut, écrit ce témoignage hors norme dès qu’il est démobilisé. Il enfouit ce manuscrit dans sa cantine avant de le relire pour la première fois le 20 mars 2011. Sollicité par l’aînée de ses petites-filles, à qui il raconte sa guerre d’Algérie, il décide alors de publier ce document de première importance. Et il faut convaincre les éditions L’Harmattan de faire, pour une fois, de la publicité pour cet ouvrage aux grandes qualités d’écriture qui raconte, d’une façon aussi magistrale que celle d’un autre universitaire, Antoine Prost, le temps de la violence ordinaire en guerre d’Algérie.
Marié, étudiant en histoire, conscient de faire son devoir après avoir subi un complément de formation à Arzew, il est nommé chef de peloton et bientôt chef de poste, Michel Bur est d’abord affecté en janvier 1960, dans l’Ouest algérien, près de la sous-préfecture de Mascara entourée de riches terres à vignes. Ce témoignage recèle bien des trésors, de la nonchalance de ses équipages de chars AMX 13, de la façon dont ces blindés calment, sur ordre, à Oran, les ardeurs des ultras d’Algérie qui pensaient reproduire la semaine des barricades d’Alger, aux relations avec les populations déplacées et les Français d’Algérie, sans oublier le fonctionnement de la SAS dont il dépend. Il décrit aussi pièges et ruses, dont les divers types de feux pour signaler l’avancée des troupes françaises, de l’adversaire et sa politique de terreur jusqu’au massacre de familles et de vieillards ayant osé braver l’interdit du FLN de boycotter les cantonales de mai 1960. L’auteur a changé les noms de personnes. Les portraits qu’il fait de ses supérieurs et de ses adjoints sont à la fois précis et sans concession. A son arrivée, les hommes de son peloton l’ignorent parce qu’il refuse d’employer les méthodes fortes de son prédécesseur pour obtenir des renseignements. Par la suite, cette question de l’utilisation de la torture est constamment présente. Il ne l’a jamais pratiquée, mais assiste à de pénibles séances de supplices à l’eau, à l’électricité... Il ne travestit pas ses sentiments qui évoluent. S’il déplore cette banalisation de cette violence, hors des règles de la guerre jusque dans les plus petites unités, il dit, notamment lorsqu’il a des hommes sur le terrain, comprendre ces méthodes pour obtenir des renseignements le plus vite possible.
De juillet 1960 à février 1961, Michel Bur suit son régiment (le n° n’est pas indiqué, mais il s’agit du 30e dragons) dans le sud de Sétif, au pied du Hodna, dans un secteur « pourri ». Il évoque la peur des mines, comment ses hommes compensent par un entretien fébrile de leurs chars, mais aussi les représailles aveugles lorsqu’une mine explose et fait des victimes en queue de convoi. De l’incendie d’un douar, à titre d’avertissement, les sanctions-exactions croissent envers les Algériens en fonction du nombre d’attaques à l’aide de cette arme sournoise déjà présente, bien avant l’Afghanistan. Des maisons sont ensuite pillées et détruites, le bétail volé, des hommes bastonnés à coup de manches de pelle jusqu’à briser jambes et bras (le supplice de la roue en plein bled !). Et de reconnaître, in fine, là encore sans corriger son texte, pour le secteur de Beida-Bordj : « A l’intérieur de nos limites, il n’y eut plus jamais de mines ».
D’autres avant Michel Bur ont décrit ces débordements propres à la contre-insurrection lorsque le commandement laisse faire. Mais ce qui rend encore plus attachant le témoignage « à chaud » de l’auteur, c’est que le médiéviste en devenir qu’il est alors donne la une clef précieuse : en l’absence du rétablissement de l’autorité de l’Etat, l’insécurité restaure la féodalité du IXe siècle en pleine anarchie postcarolingienne où de petits seigneurs locaux luttaient contre Normands et Hongrois. Il se rend compte que, chef de poste surveillant un carrefour, il se comporte en juge, lève l’impôt, confisque au profit de sa troupe l’argent des collecteurs de fonds du FLN qu’il a capturés et que tout un village de regroupement lui obéit parce qu’il détient la force. Lui-même devient le vassal de son colonel qui se taille un fief dans son quartier, tandis qu’il constate que de simples brigadiers-chefs, laissés un peu trop libres, considèrent les prisonniers qui les servent comme des esclaves. Enfin, l’analyse de l’historien pointe déjà dans cette réflexion qui résume à elle seule tous les malentendus de la guerre d’Algérie : « Forte de la justice et du droit, elle (la France) s’accusait de n’avoir pas assez fait pour une population qui la trahissait tous les jours un peu plus et, dans les chambres de torture, elle se livrait à des actes que réprouvaient sa consciences et sa tradition. Cette contradiction ne pouvait, à la longue, que lui être fatale ».En bref, ce récit est à verser au dossier des grands témoignages qui empêchent de commémorer en rond, en cette année du cinquantième anniversaire du drame de 1962 où l’asepsie mémorielle l’emporte trop souvent chez les différents porteurs de mémoires qui redoutent de se confronter, à nouveau, à ce que fut la rude réalité d’une guerre sordide.
SOURCE : http://www.confluences-mediterranee.com/ALGERIE-60-Mascara-Setif-1er

(Photo : Stephane Harter /Agence VU / POUR LA CROIX)
Michel Bur : une parenthèse dans une vie
Michel Bur, sous-lieutenant, a participé à la protection des populations et vu le renseignement par la torture se répandre « comme une gangrène » .
Comme un certain nombre d’appelés exerçant déjà un métier et ayant fondé une famille – ce fut aussi le cas des rappelés –, Michel Bur partit en Algérie avec l’espoir que cela dure le moins longtemps possible. Jeune marié et enseignant agrégé en histoire dans un lycée de Metz, il se sentait, comme il l’affirme sans détour, « déjà engagé dans la vie civile ». Il ne souhaitait pas que la vie militaire vienne interférer avec un destin déjà tracé : il ambitionnait de se consacrer à l’enseignement universitaire et à la recherche sur le Moyen Âge et allait être père d’un garçon.
C’est donc par devoir que, après une brève préparation à Saumur, l’agrégé est à pied d’œuvre avec le grade de sous-lieutenant en terre algérienne pour quatorze mois, à partir du 1er janvier 1960. À l’instar de la plupart des appelés, Michel Bur n’est pas engagé politiquement. Mais observateur, assurément. À son retour dans l’Hexagone, début 1961, il éprouve le besoin de mettre ce qu’il a vu et entendu sous la forme d’un récit, en se reportant au journal de marche de son peloton.

Cinq mois d’écriture pour « fermer la parenthèse », sans se départir du souci de véracité que peut avoir un historien. Il a ensuite enfoui le manuscrit dans une cantine au fond de sa cave. Et n’a plus jamais reparlé de la guerre d’Algérie, jusqu’à ce jour de mars 2011, lorsque l’aînée de ses petites-filles l’a interrogé à ce propos. Il a alors ressorti le document et décidé de le publier (1).
À la tête d’un peloton où des appelés nord-africains étaient intégrés, Michel Bur a accompli toutes les missions, de la surveillance à l’embuscade, en passant par la protection des villages et les regroupements de populations, auxquels l’armée procédait pour tenter d’isoler la rébellion et qui bénéficiaient de l’encadrement sanitaire et éducatif des Sections administratives spécialisées. De Mascara à Sétif, celui qui a fait ensuite une thèse sur la formation du comté de Champagne entre l’an 950 et l’an 1150, et qui est membre de l’Institut depuis 2005, a ramené une vision sociologique de la complexité de l’Algérie de 1960.
Toutes les missions, enfin presque. Car il y en a une que Michel Bur n’aurait pas acceptée si on avait voulu la lui imposer : le renseignement par la torture, qui s’était répandu « comme une gangrène ». « Je n’ai tué personne, peut-il assurer. Et, si je n’ai pas été tué, c’est dû au hasard. »
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 15 Septembre 2014 à 08:34
Châtenoy-le-Royal
La FNACA réalise son bilan
Les responsables FNACA ont animé la réunion. Photo J. S. (CLP)
Lundi, devant un auditoire nombreux, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA), du secteur de Châtenoy-le-Royal, a accueilli, à la salle Berlioz, les délégués du secteur 9 de la FNACA de Saône-et-Loire. Une dizaine de comités locaux se sont réunis pour une réunion de bilan de la période écoulée, ainsi que pour lancer celle allant jusqu’en 2015.
Cette assemblée Fnaca a été animée par les membres du bureau départemental, Jean-Claude Arnoux, Jean-François Drillien et Monique Becouze, et par les responsables de Châtenoy, Jean-Marie Moutier et Daniel Courtitarat.
La réunion a débuté par une analyse des effectifs au 31 août, totalisant 1 130 adhérents dont 198 veuves pour ce secteur 9. « Le nombre subit fatalement une érosion due à l’âge mais son niveau reste encore conséquent », a constaté le bureau.
Résultats des activités de l’année 2014
Concernant la souscription départementale, seulement un adhérent sur quatre y a participé. « En conséquence, l’aide apportée aux membres dans une situation de grande précarité a été limitée », a déploré la commission.
Les cérémonies du 19 mars ont été belles mais les animateurs de la réunion ont souligné : « Il faudra conserver cette même amplitude l’an prochain afin de montrer l’attachement de la FNACA à cette date. »
De plus, le Congrès national à Caen, les 17, 18, 19 octobre, aura lieu pour défendre les revendications de la FNACA. Il y aura également un appel à la participation.
Le conseil départemental aura lieu, à Sanvignes, le 9 octobre, ainsi que la journée de solidarité des combattants à Chalon puis, le 20 novembre, se tiendra le congrès de Louhans.
Communication aux veuves : voir les coordonnées des responsables de chaque comité.
Génelard
Pré rentrée pour la FNACA
Le comité prépare son assemblée générale Agnès JAFFRE (CLP)
Le Comité de Génelard de la FNACA, présidé par Jean Laupin, s’est réuni mardi pour préparer l’assemblée générale, qui aura lieu le 7 octobre. Le président était heureux d’annoncer l’arrivée des nouvelles cartes d’adhésion. Si, de manière générale, les effectifs diminuent, du fait des décès ou de l’état de santé de certains, le taux de renouvellement sur le secteur 5, regroupant Génelard, Palinges, Perrecy, Ciry, Sanvignes et Toulon, est meilleur qu’au plan départemental. Le comité de Génelard se réunit une fois par mois et organise entre six et huit manifestations par an, en assurant une présence assidue aux différentes commémorations. Tous les adhérents sont attendus à la réunion générale qui aura lieu le 16 septembre prochain. Photo A. J. (CLP)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 14 Septembre 2014 à 09:52
Jacques Pradel
« Mes parents étaient foncièrement anti racistes »
Photo Robert Terzian (c) Copyright Journal La Marseillaise
1954-2014 : souvenirs d'Algérie
Itinéraire d’un pied-noir progressiste
Natif de Tiaret, Jacques Pradel réside aujourd’hui dans l’Est marseillais. Après une vie de militant débutée en 1968, ce chercheur retraité du CNRS se bat pour faire connaître une autre mémoire des rapatriés.
Sourire facile sous son épaisse moustache blanche, Jacques Pradel a gardé de sa naissance outre Méditerranée un sens certain de l’accueil. Sur sa table, un plat de tomates et un pichet estampillé Cristal Limiñana attendent ses hôtes à l’ombre d’un figuier. De quoi étancher la soif et rafraîchir une mémoire remontant à plus d’un demi-siècle.
Né en 1944 à Tiaret, capitale antique des Rostémides assoupie depuis bien longtemps au temps de la colonisation, il y conserve tous ses souvenirs de jeunesse. Issu d’une « famille de colons », il a reçu de son ancêtre chassé du Tarn par la misère en 1849 son prénom, Jacques, commun à tous les premiers-nés mâles de la famille. « Moi je suis Jacques V », s’amuse-t-il avant de narrer l’essor progressif des propriétés des Pradel. Dans les années trente, elles s’étendaient sur 5 000 hectares. « Mon père a été élevé dans l’opulence mais a fait des mauvaises affaires, si bien qu’à l’Indépendance, il ne nous restait pas grand chose », confie-t-il.
Le sang sur les trottoirs d’Oran
De son enfance, il retient avant tout sa bande de copains. Ouadah Kaïli, un musulman, Samuel Selam, un juif parti en Israël à l’Indépendance et Jacques Deloche dont le père ouvrier gazier peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Pas un paradis perdu mais l’image d’une Algérie plurielle qui aurait peut-être pu advenir. Un mélange qui tranche avec ses années d’internat au lycée Lamoricière d’Oran. « Je n’ai pas souvenir d’avoir eu un arabe dans ma classe, pas même un fils de notable », témoigne Jacques Pradel.
L’orage de la guerre gronde de plus en plus fort et les souvenirs du rapatrié s’assombrissent. Peu de temps après la rentrée de janvier 1962, son lycée est fermé. Avec d’autres élèves, le jeune homme demeure encore trois semaines dans son internat. Une période difficile à évoquer : « Je me souviens des cadavres d’Algériens abattus par l’OAS parce qu’ils se trouvaient du mauvais côté de la rue. Je me vois encore éviter de marcher dans les flaques de sang ». Ses sentiments confusément pro-Algérie française en prennent un coup. Autre scène indélébile : une voiture siglée OAS entre rue de Mostaganem, une des artères les plus fréquentées d’Oran. « Ils ont éjecté un type du véhicule dans la foule en disant : "il faut le liquider". Il a été lynché », raconte Jacques Pradel. Pétrifié par « toute cette horreur », il voit dans le massacre d’européens du 5 juillet 1962 à Oran « une sorte de vengeance » aveugle, une forme d’aboutissement de la spirale de la violence, « même si elle ne peut tout expliquer ».
Avant cela en février 1962, il rentre en car à Tiaret. L’atmosphère y a radicalement changé. Trois gamins arabes lui sautent dessus. « J’étais bagarreur, je n’ai pas eu de mal à les maîtriser. Mais j’ai vu mon ami Ouadah Kaïli non loin. Il n’a pas bougé. Ni pour me défendre, ni pour les aider. J’ai compris que plus rien ne serait comme avant », rapporte Jacques Pradel.
Peu de temps après un bruit court à Tiaret selon lequel l’OAS chercherait à enrôler des jeunes pour un maquis dans le Ouarsenis, un massif montagneux. Immédiatement son père l’expédie direction la métropole. « Il n’aidait pas ouvertement le FLN mais s’est occupé en secret de la femme et des enfants d’un commerçant devenu responsable de l’ALN », a-t-il appris par la suite. « Mes parents étaient foncièrement anti racistes », se remémore-t-il. Le car qui le conduit à Oran suit une ligne « neutre » entre quartiers arabes et européens. Lorsque ses occupants musulmans en descendent, le car qui poursuit sa route reçoit des pierres.
Jacques Pradel parvient à prendre un avion destination Marignane. « Je n’avais rien. Je suis allé à Paris en stop rejoindre mes soeurs et mes grands parents maternels ». Trou noir. Hébergé dans une chambre de bonne, il y reste sonné plusieurs semaines sans sortir.
Lorsque le code de la nationalité mis en place par Ben Bella proscrit la double nationalité en 1963, son père fait le choix de la métropole et achète une ferme dans le Berry. « La pluie ne cessait de tomber », se souvient-il. Une fois le bac en poche, autre ambiance : direction la fac d’Orsay et la cité universitaire de Bures-sur-Yvette. « Il y avait le bâtiment A avec les étudiants d’Île-de-France et le bâtiment B avec les gens du Sud, les arabes, les juifs et les pieds-noirs. » Un état de fait qui l’éveille à la politique. « Mais l’ambiance était formidable, comme en Algérie, je me suis toujours senti à ma place parmi les métèques », sourit-il.
Étudiant en 68, il participe activement aux événements de mai dans la mouvance gauchiste.
Entré dans un laboratoire de biochimie, c’est pourtant au PCF qu’il adhère l’année suivante, « motivé par l’analyse que je me faisais de la société française » et non vis-à-vis de la position de ce parti sur l’indépendance de l’Algérie, marquée au demeurant par des « atermoiements », juge-t-il rétrospectivement. Débute une vie militante syndicale et politique intense, « une très chouette période ».
Il rejoint le CNRS et s’installe en 1977 dans l’Est de Marseille où il réside toujours. Militant d’entreprise, il goûte peu le sectarisme qui a cours dans sa cellule locale et vit très mal le rôle d’inquisiteur qu’on veut lui faire jouer dans les débats internes qui l’animent. Sans animosité, il s’éloigne peu à peu du PCF et ne reprend pas sa carte en 1981.
« Ca suffit, ne parlez plus en notre nom »
Travaillé par son origine pied-noire, il retourne en Algérie avec un frère et un cousin en 2006-2007. Et lorsque les nostalgiques de l’OAS inaugurent à Perpignan leur « mur des disparus » sur lequel figure le nom de Gaston Donnat, militant communiste et anti colonialiste d’Algérie, c’est le déclic. « Des pieds-noirs progressistes de toute la France ont décidé de se regrouper pour dire "ça suffit, ne parlez plus en notre nom" », et nous avons fondé l’association.
Contre-manifestations, initiatives pour l’amitié franco-algérienne, voyages de l’autre côté de la Méditerranée, l’association nationale des pieds-noirs progressistes et leurs amis (ANPNPA) ne chôme pas. Elle inaugurera en décembre à Marseille une première rencontre autour des livres d’expression française édités en Algérie mais introuvables en France.
Investi parallèlement dans les différentes expériences de la gauche alternative, Jacques Pradel participe au Collectif anti libéral de Marseille Est (Calme) qui s’inscrit désormais dans le Front de gauche à travers sa troisième composante «Ensemble !». Et comme depuis plusieurs années, il organisera en septembre avec ses amis du Calme un... Méchoui républicain. On ne se refait pas.
Léo Purguette
SOURCE : http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/30654-itineraire-d-un-pied-noir-progressiste
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 14 Septembre 2014 à 09:22
Charnay-lès-Mâcon
C’est la reprise à la FNACA
Rendez-vous le 4 octobre à la Maison de Champgrenon pour l’assemblée générale. Photo M. P. (CLP)
Le comité FNACA a repris ses réunions mensuelles mardi à la Maison de Champgrenon, où 19 de ses adhérents étaient rassemblés autour du président Roger Perrard.
La séance a débuté par une minute de silence à la mémoire de Nicole Debarbouillé décédée le 28 août, puis, les activités de l’année écoulée ont été évoquées (manifestations diverses, sorties, achat d’un nouveau drapeau, distribution des cartes et calendriers 2015 lors de la réunion du 22 août à Vinzelles…).
Le trésorier Pierre Louis a fait état, à son tour, d’un bilan financier positif.
L’heure était ensuite aux projets pour le comité qui compte 128 adhérents dont 21 veuves. Il souhaite mettre en place une exposition au Vieux temple sur la guerre d’Algérie-Maroc-Tunisie à destination des écoliers charnaysiens.
Le 20e thé dansant se déroulera le 1er mars 2015, à l’Espace la Verchère. Il sera animé par l’accordéoniste Pascal Michaud. Un voyage à la découverte de la Baie de Somme réunira les adhérents du 5 au 9 juillet. D’ici là, rendez-vous samedi 4 octobre à 10 heures à la Maison de Champgrenon où se tiendra l’assemblée générale. Le président souhaite la présence du plus grand nombre.
618 adhérents dans le secteur 8
Le secteur 8 était bien représenté à la réunion qui s’est ponctuée par le verre de l’amitié. Photo M. B. (CLP)
Avant de lancer l’année FNACA 2015, le secteur 8 (Buxy – Chagny) de la Fédération a tenu mardi, son assemblée générale en mairie de Chagny. Ce secteur regroupe les communes de Buxy, Demigny, Givry, Rully, Sennecey-le-Grand, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup Géanges, La Vallée de Vaux et bien sûr Chagny et compte 618 adhérents dont 64 pour Chagny.
Au niveau départemental, les 8 491 affiliés sont regroupés en dix comités (secteurs). Au niveau national, ils sont 328 606 membres à faire partie de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
Au cours de la réunion, présidée par Lionel Brochot et Gilbert Tournier, tous deux membres du bureau départemental, il a été fait un point complet sur les effectifs, un bilan des activités 2014 avec les souscriptions départementales et sur les cérémonies du 19 mars.
Les questions d’actualité ont principalement porté sur les aides pouvant être attribuées aux veuves d’adhérents en fonction de leur situation financière et aux adhérents dans le besoin.
Le conseil départemental aura lieu à Sanvignes, jeudi 9 octobre.
CHAROLLAIS-BRIONNAIS
Le nombre d’adhérents est en érosion naturelle
Les responsables de la Fnaca et une grande partie des adhérents.
Photo A. L. (CLP)
Vendredi, le bureau départemental de la FNACA était réuni au relais-emploi. Le président de la section locale, accueillait Gérard Lagru, vice-président départemental et Lucien Chalumot, responsable du secteur de l’ouest du département.
Cérémonie du 19 mars
Les adhérents ont affiché leur entière satisfaction quant à la cérémonie du 19 mars.
Les effectifs départementaux
Les effectifs départementaux, quant à eux, continuent naturellement à s’éroder, passant de 8 647 en 2013 à 8 491 en 2014. Les 204 décès (dont dix veuves) expliquent naturellement cette évolution.
Service social
Les adhérents bénéficient d’un service social, nécessaires pour venir en aide aux personnes qui sont dans une situation de grande précarité et notamment les veuves. Une souscription a été lancée en ce sens.
Dates à retenir
Le conseil départemental se déroulera, jeudi 9 octobre, à Sanvignes, avec l’élection du comité, du bureau et de la présidence. Enfin, le congrès à Louhans est fixé au jeudi 20 novembre. Il comprend la séance plénière, cérémonie et repas à Branges. Les inscriptions rapides sont souhaitées, les places étant limitées.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 13 Septembre 2014 à 10:40
Jean-Michel parle de sa guerre d’Algérie pour la première fois. Un « besoin d'écrire ». De parler de l'horreur des combats, mais aussi et surtout de cette vie au quotidienne. De la camaraderie, des doux instants comme des plus difficiles.
« Besoin d'écrire, de dire ce que l'on ressent après les événements d'Algérie. Jamais je n'ai parlé de ces 28 mois passés loin de la famille, de celles et ceux que l'on aimait.
19 ans, appelé un 2 juillet, direction Amiens, lieu de rassemblement. Direction ensuite Rentlingen durant treize mois pour la formation, sachant que parti pour 28 mois, j'ai opté pour les pelotons 1 et 2. Au mois de mars nommé brigadier, au mois de juin brigadier chef. J'ai durant ce séjour occupé divers postes. Le 10 septembre direction Marseille. Plusieurs jours pour aller de Rentlingen à Marseille. Arrivé au célèbre camp Sainte-Marthe, baraquements, bouffe... mieux vaut ne pas en parler. Le 12, direction Alger. Arrivée sous la chaleur, de nouveau rassemblement avant d'être dirigé vers Loverde (près de Médéa). Arrivé éreinté, logement une baraque pour six, trois lits superposés : armoire, une table, six chaises. Heureusement nous avons rapidement lié connaissance.
Trois jours après, service de garde à l'entrée du village : fusil et cartouchière entourée de sparadrap. Eh oui, la nuit, les bruits sont doublement perceptibles. Quelle trouille ressentie, vous ne pouvez pas savoir. Le 1er mars, j'ai accédé au grade de maréchal des logis. Rien de changé à l'égard des copains. Après tout, nous étions dans la même galère. Seul changement, la solde.
Cette chaleur, nous n'étions pas habitués. Cela n'empêchait pas les patrouilles. Mon souci toujours présent durant ce séjour en Algérie : revenir avec les copains, c'était ma hantise. Mesurant 1,62 mètre j'avais devant moi de grands gaillards avec qui je pouvais compter. D'ailleurs, ils me le rendaient bien. Quand il y en avait un qui déconnait un peu trop, ma seule remarque : « Je vais demander ton changement de section. » C'était tout et ça rentrait dans l'ordre. Après avoir obtenu la médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre avec agrafe "Algérie" j'ai par la suite refusé toute distinction.
Trois cas m'ont particulièrement marqué :
Un maître-chien qui avait mangé avec nous à midi et qui s'est fait descendre l'après-midi, au cours de l'opération dans le maquis. Tué avec son chien par une rafale de fusil mitrailleur.
Le deuxième, un télégramme reçu à remettre à un de mes copains : « Retour urgent, soeur décédée. » Pas facile à annoncer. Bref, à son retour, je n'ai plus retrouvé le Francis d'auparavant. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Toujours est-il que quelques jours après, il a demandé à me parler : il a alors sorti de sa poche une feuille de journal qui titrait « Une femme tuée à coups de couteau par un amant ». J'avais vu juste dans son comportement, cela est toujours resté entre nous.
Le troisième un petit parisien, disons ma taille, toujours plaisantin, souriant, serviable. Réception du courrier : sa fiancée lui annonce sa rupture, je ne vous dis pas le cinéma. Il s'est mis à boire, à se saoûler, devenir méchant. C'était au mois de décembre, nuit très froide, l'on avait d'ailleurs allumé le feu, tous à ses côtés pour essayer de le consoler. D'un seul coup, d'un bond, il se lève et va s'asseoir sur le feu. A six nous l'avons maîtrisé et ligoté, jusqu'au lendemain. Quel calvaire, il n'a plus jamais été le même et je n'ai jamais voulu qu'il parte de la section.
Vous savez il y en a eu beaucoup dans ce cas là. 28 mois c'est long. Personnellement, j'avais une amie avec qui j'ai rompu avant de partir. J'ai d'ailleurs bien fait parce que j'ai appris que, peu après, j'avais été remplacé. Il est vrai qu'à cet âge dur de résister, c'est la vie.
A quoi ont servi ces 28 mois d'armée, cette guerre inutile, qui a changé bien des projets? Pratiquement 30 000 morts. Qui a pu organiser cela ? Tout cela pour percevoir à 65 ans environ 1,50 € de retraite d'ancien combattant? Qui de nos jours offrirait ses 28 mois de jeunesse (éphémère) pour si peu ? Mon groupe est revenu complet, cela a été ma plus grande joie. Ce qui n'a été malheureusement pas le cas de tous.
Ce témoignage est une manière de rendre hommage à ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir vivants.
Il m'est arrivé de demander à tous les maires de la commune qui se rendent assez souvent au monument aux morts, combien y a-t-il eu de morts en Algérie dans la commune. Je n'ai jamais eu de réponse exacte.
Jean-Michel Vancompernolle - Pecquencourt
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 12 Septembre 2014 à 11:40
Réunion de rentrée autour de Monique Bécouze, Jean-François Drillien et Jean-Claude Arnoux. Photo C. P. (CLP)
La première réunion du comité directeur représentant les 327 adhérents de la FNACA Chalon ville s’est tenue mardi soir à l’Espace Jean-Zay, sous la présidence de Jean-François Drillien.
Après une minute de silence en mémoire des trois membres décédés ces trois dernières semaines, Jean-Claude Arnoux, secrétaire, a fait le point sur le nombre d’adhérents en Saône-et-Loire et en France. Des nouveaux arrivent, mais le nombre total diminue quand même avec l’âge. Il a été rappelé comment pouvoir profiter des transports gratuits à Chalon. Une rencontre avec le maire a permis de mettre au point l’emplacement de la stèle, sur la place du 19-Mars, à la mémoire des 41 Chalonnais morts en Afrique du Nord.
Des mises au point ont été faites sur la présence de bénévoles aux diverses assemblées, et au congrès départemental, le 9 octobre, à Sanvignes, et au Congrès de Louhans, le 20 octobre.
Un compte rendu du Congrès national de Caen sera fait avec les revendications débattues, en particulier le maintien des ONAC dans les départements, que l’aide différentielle soit équivalente au seuil de pauvreté et qu’elle soit proposée aux anciens combattants.
Le président a annoncé qu’une Journée départementale de la solidarité sera organisée le 9 novembre, à la Maison des syndicats. La FNACA va mettre un tableau et sera représentée.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 12 Septembre 2014 à 10:42

J’ai reçu ce commentaire, ce matin, vendredi 12 septembre 2014 c’est la raison pour laquelle je remet en ligne cet article :
Interviews en longueur de Laurent Laot, Yvon Cuzon et Jean Miossec. Ils témoignent sur l'importance de "libérer la parole" des appelés de la guerre d'Algérie.
A partir de 11'51'' jusqu'à 21'21'' Yvon Cuzon qui est arrivé dans l'Algérie indépendante, après le 5 juillet 1962, dans un hôpital d'Oran a vu passer de nombreux morts d'appelés français victimes principalement d'accidents suite à des "beuveries du samedi soir" des camions qui tombaient dans les ravins (pire qu'à Palestro, dit-il) à des problèmes psychologiques qui ont conduit certains appelés au suicide, d'autres refusaient de se soigner et en sont morts... Yvon Cuzon a donc vu des cadavres "sans raison" mais officiellement "Morts pour la France".
A ceux qui nous parlent sans arrêts des 534 victimes d'appelés d'après le 19 mars, accusant, sans preuves, le FLN, voilà quelques éléments de réponses.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 12 Septembre 2014 à 09:54
Meyrueis : inauguration d’une stèle commémorant la fin de la guerre d’Algérie
Sur la rue du 19-Mars-1962 à côté du gymnase de Meyrueis, inauguration d'une stèle commémorant la fin de la guerre d'Algérie
C'est avec émotion que les familles, les élus, avec les représentants du canton, et départementaux de la FNACA, se sont réunis devant le gymnase, sur la rue du 19-Mars-1962, pour dévoiler la plaque de la stèle à la mémoire de Dominique De Lapierre, de Roger Maurin et de Joseph Passebois enfants du canton de Meyrueis tués en Algérie. Elle immortalise le sacrifice de leur vie, leur dévouement à la patrie, et sera pour les générations futures une borne repère pour éviter les conflits.
La guerre coloniale d'Afrique du Nord de 1952 à 1962 a mobilisé et privés de leur jeunesse 3 millions d'hommes qui ont effectué 26, 28, et 30 mois de service militaire, elle a fait 30 000 tués dont 42 Lozériens. Dominique et Roger de la commune de Meyrueis et Joseph de la commune de Hures-la-Parade ont fait partie de cette génération baptisée « 3e génération du feu » jeunes victimes d'un conflit économique qui les dépassait.
Cette stèle à côté du gymnase, symbolise le dépassement de soi par le sport, plutôt que par le sacrifice de sa vie pour des causes obscures.
Meyrueis (Lozère) Panorama
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 22:19
Martine Timsit, souvenirs et engagements intacts. PHOTO ROBERT TERZIAN
Née d’un père juif algérien et d’une mère parisienne, Martine Timsit grandit à Bône, l’actuelle Annaba. À contre-courant, elle choisit en 1962 de participer avec son mari à la construction d’une Algérie nouvelle.
« Il y a une crypte dans l’âme, où murmurent les fantômes. » Si Martine Timsit cite spontanément Boris Cyrulnik pour évoquer ses souvenirs enfouis, c’est qu’elle est elle-même psychiatre. Autour d’une tasse de café et de quelques dattes -d’Algérie forcément- elle accepte de revenir sur sa vie mouvementée, étroitement liée au pays qui l’a vue grandir.
Ses parents, mariés chacun de leur côté, se rencontrent à Bône, l’actuelle Annaba, une ville de l’Est Algérien où est né un certain maréchal Juin. Son père, commerçant juif algérien, a 20 ans de plus que sa mère, une parisienne. C’est le coup de foudre. Leur histoire fait désordre et ils décident de s’installer à Paris où naît Martine en 1937, petite dernière d’une fratrie qui compte deux garçons. Dès l’année suivante, les accords de Munich sont signés. « Mon père a tout de suite senti le vent mauvais », rapporte-t-elle. Retour immédiat de la famille à Bône. Mais à la fin 1940, le décret Crémieux qui donnait la nationalité française aux juifs algériens est aboli par Vichy. « Mon père s’est battu comme un beau diable, il a même intenté un procès à l’État français, mais rien n’y a fait », témoigne Martine Timsit. Les enfants juifs sont exclus de l’école et le commerce de son père, une bijouterie vendant également des objets précieux, est placé sous la tutelle d’un administrateur temporaire. Un coup dur.
« J’étais si naïve »
« Beaucoup de pieds-noirs de Bône étaient d’origine italienne. En 40 certains sont allés acheter à ma mère des coupes pour trinquer au champagne après la prise de Paris. Nous n’en parlions jamais. Il y a des paroles gelées, des temps cristallisés », confie-t-elle. Une institutrice juive interdite d’exercer vient alors faire la classe à ses grands frères. « J’ai appris mes déclinaisons latines avec eux avant d’en avoir l’âge », se souvient-elle avec une pointe de fierté.
Les troupes américaines libèrent Bône en 1942 mais n’abolissent pas les mesures antisémites de Vichy, le décret Crémieux ne sera rétabli qu’en octobre 1943 par le comité français de Libération nationale.
De cette période trouble, Martine Timsit se rappelle surtout les bombardements « mon père avait fait creuser un abri » et les longues journées passées sur la plage « à jouer avec des petits arabes du quartier. On avait un pneu de camion en guise de bouée ». La mère de l’un d’entre eux viendra après guerre faire la lessive de la famille. « Entre nous il y avait plus un clivage de classe que de race. Moi j’étais une fille de riches mais je me suis rendue compte il n’y a pas si longtemps que la langue maternelle de mon père, c’était l’arabe », souligne-t-elle.
La Libération de la France arrive comme « un immense soulagement », la petite Martine intègre enfin l’école et accomplit une brillante scolarité. Dans le même temps, elle ressent de plus en plus péniblement la distorsion entre la France des droits de l’Homme exaltée dans les livres et la réalité vécue. Son journal intime commencé à l’époque garde la trace de ce trouble.
Elle rêve de devenir médecin mais commence des études de philosophie à Paris en 1954, « sans rien m’interdire, mon père estimait que c’était un métier d’homme ». Difficile pourtant de réprimer sa vocation : un an plus tard, c’est en médecine qu’elle s’inscrit.
La guerre s’installe en Algérie. À Paris, l’Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugéma) organise une première réunion. Martine Timsit s’y rend. Lorsque la colonisation est vilipendée, elle lève la main. « Je leur ai dit : "ça n’est pas vrai, les Français ont asséché le lac de Fetzara, c’est un bien : il y avait plein de moustiques". J’étais si naïve », rit-elle aujourd’hui. Renvoyée à l’histoire destructrice de la conquête, elle comprend par ses lectures à la bibliothèque Sainte-Geneviève, « les mensonges » qu’on lui avait appris. C’est l’électrochoc.
Avec une poignée d’amis, elle fonde « l’union des étudiants algériens d’origine européenne ». « Nous étions pour une Algérie indépendante, multiculturelle, plurielle », se remémore-t-elle.
Plus le conflit s’exacerbe, plus le nationalisme algérien se fait étroit. Mohamed Khémisti, un dirigeant de l’Ugéma qui deviendra le ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement algérien, lui dit un jour : « l’Algérie sera arabe et musulmane ». Une phrase qui claque comme une porte au nez. « Je n’en ai pas tenu compte. Le processus de déni est très puissant », analyse celle qui deviendra psychiatre.
En 1960, de Gaulle libère des prisonniers politiques. Parmi eux, Meyer Timsit,un médecin membre du Parti communiste algérien (PCA), frère de Daniel Timsit, également détenu et dont les carnets de prison témoignent de la dureté de l’époque.
Meyer et Martine se plaisent, ils se marient et participent en 1961 à la fondation du centre de santé mutualiste de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Leur premier enfant arrive, ils le prénomment Youri. Un clin d’oeil au premier homme dans l’espace.
Lorsqu’au printemps 1962, entre le cessez-le-feu et l’Indépendance, les pieds-noirs quittent l’Algérie en masse, les Timsit font « le chemin inverse ». Le besoin de médecins est criant, ils n’hésitent pas un instant. Arrivés à l’hôpital El Kettar d’Alger, ils vivent la période de terreur imposée par les ultras. « L’OAS tuait tout le temps, elle tuait au faciès et en pleine rue », se remémore Martine Timsit avant d’évoquer « ce patient mélancolique qui cherchait absolument à mourir. Il s’est présenté place des trois horloges à Bab El Oued, fief de l’OAS mais lui, ils ne l’ont pas tué ».
La nationalité algérienne
Vient l’Indépendance. « Depuis l’hôpital nous voyions un camion avec un drapeau algérien arriver dans le bas d’Alger. Puis deux, puis des centaines qui convergeaient de tout le pays. De toutes parts s’élevait le son des derboukas. Nous sommes montés sur les camions, nous avons crié "tahia El Djazaïr !" (vive l’Algérie ! ndlr) Ce fut trois jours inoubliables », rapporte-t-elle avec émotion.
Martine Timsit et son mari obtiennent la nationalité algérienne « il a fallu batailler car en théorie il fallait être musulman » et s’investissent sans compter dans une clinique psychiatrique nationalisée baptisée Drid Hocine du nom d’un infirmier abattu par l’OAS. Les patients affluent des campagnes et jusqu’en décembre 1962, ils ne sont pas payés. « C’était une période très dure mais nous avons vécu le bonheur pendant quelques mois de ne pas avoir d’État », estime la psychiatre.
Très vite cependant les espoirs que placent les Timsit dans l’Algérie nouvelle se fissurent. En juin 1965 le couple est à Paris où Martine subit une opération avant de donner naissance à son second fils David quand a lieu le coup d’État de Boumediène. « C’est fini », Henri Alleg directeur d’Alger républicain les dissuade de rentrer.
Convaincus que le peuple algérien ne supportera pas longtemps la tutelle de l’armée, les Timsit décident d’aller temporairement parfaire leurs connaissances médicales en Belgique. « Nous y sommes en fait restés 31 ans et les militaires sont toujours aux commandes en Algérie ».
Aucune amertume chez Martine Timsit mais une réelle déception. « J’y suis retournée quelques fois mais la situation des femmes et du monde de la culture me mettent hors de moi, nous voulions faire d’Alger le phare de l’Afrique », soupire-t-elle.
Depuis sa retraite elle a retrouvé l’azur méditerranéen dans le Var et parle avec douceur de ses cinq petits-enfants.
Léo Purguette
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 14:12
(Ah si tu pouvais refaire ta figure. Ceux destinés à l'abattage sont plus beaux et plus purs que toi !!!)
La 1° femme au monde à avoir montré ses fesses au monde. Elle devrait repasser aussi bien son corps que son visage au lieu de faire l’intéressante.
Avec elle, la cause animale a trouvé sa Madone incontestée et la France sa virulente pasionaria islamophobe, Brigitte Bardot, l’icône sacralisée de l’émancipation de la femme en dépit des ravages du temps, ne pouvait pas décemment fêter ses 80 ans sans faire à nouveau parler d’elle dans la presse, et se rappeler au bon souvenir d’un gouvernement qu’elle maudit cordialement en fervente militante frontiste qu’elle est.
Familière des coups de com’ dégoulinant de haine anti musulmans qui ont non seulement entaché son image déjà flétrie de star du septième art, instillé la suspicion sur son association de défense des animaux, mais l’ont également traînée à cinq reprises devant le Tribunal correctionnel de Paris, la « BB nationale » s’est fendue d’une lettre ouverte adressée à François Hollande, Manuel Valls, Claude Bartolone, Jean-Pierre Bel, et à l’ensemble de la représentation nationale, afin que ses vœux les plus chers soient exaucés au moment de souffler les bougies, le 28 septembre prochain.
Adoratrice de Marine Le Pen, dans laquelle elle voit l’incarnation de la "Jeanne d’Arc du XXIème siècle", l’exhortant avec emphase à "sauver la France", la grande prêtresse de la cause animale qui ne rate jamais une occasion de porter l’estocade à l'islam et au Halal avec une rage noire, notamment lorsqu’elle lançait sur les ondes d’Europe 1 "Je m’en fous, le ramadan, je m’assieds dessus", et une plume trempée dans l’acide, à l’instar de sa pique incendiaire "les pratiques de l’Aïd-el-Kebir feront couler dans quelques mois plus de sang encore sur nos terres", a donc demandé à la République en guise de cadeau d’anniversaire, outre "le changement du statut du cheval", "la remise en application immédiate de la loi française et européenne exigeant l'étourdissement des animaux d'abattoir avant la saignée, sans dérogation pour les abattages halal et casher."
Jouant sur le registre de l’émotion en ancienne actrice qui connaît toutes les ficelles pour susciter l’empathie, Brigitte Bardot n’a pas fait dans la demi-mesure en écrivant : "Voilà les deux cadeaux que je demande au gouvernement depuis trente ans. Si je ne les obtiens pas, j'aurai raté ma vie."
Elle se dit "française de souche et fière de l’être", la star évanescente des années 60 se targue d’avoir trouvé le rôle de sa vie en ardente partisane de l’extrême droite française, ce qui ne devrait pas être du goût du gouvernement socialiste, et ce même si elle n’exige pas de Rolex pour ne pas avoir l’impression d’avoir totalement "raté sa vie"...
Un ami d’Alger
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 11:23
Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour vous remémorer la commémoration du 19 mars 1962 à Paris en 2014 que j'avais mis en ligne sur l'un des mes blogs. Je renouvelle mes remerciements à Michel Dailloux qui m'avait fait parvenir en priorité et en exclusivité deux vidéos


 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 07:12
Photo RT
DANIÈLE MALLEY-CHAMPEAUX. Après une enfance passée dans la région de Tizi Ouzou et des études à Alger, elle devient institutrice dans le Sud algérien. En 1970, elle quitte un pays qui, lui, ne l’a pas quitté.En 1954 débutait la guerre d’Algérie. Pendant 8 ans elle allait bouleverser la vie de l’autre côté de la Méditerranée et déboucher sur l’Indépendance, poussant les pieds-noirs au « retour » dans un pays souvent inconnu : la France. Déracinés, nombreux sont ceux qui ont trouvé un nouveau port d’attache dans le Sud de l’hexagone.
Une part de ces rapatriés qui a soutenu l’Organisation de l’armée secrète (OAS) dans son recours au terrorisme pour maintenir la domination coloniale, a progressivement confisqué la mémoire et la parole pieds-noires. D’autres ont suivi un tout autre cheminement.
La silhouette noire et blanche d’une Algéroise dans une rue de la Casbah. Un souvenir comme figé sur un carreau vernissé accueille les visiteurs de Danièle Malley-Champeaux dès le portail donnant sur son jardin.
Des souvenirs cette retraitée établie à Vitrolles en a bien d’autres, tellement vivants, qu’elle a parfois du mal à les formuler. La main serrée sur la poitrine, son regard bleu se voile et dès le début de son récit, elle prévient : « parler de l’Algérie, c’est une telle émotion qui remonte en moi ». Puis d’une voix blanche, Danièle Malley-Champeaux se livre. Ses parents, des instituteurs métropolitains incités à enseigner en Algérie se rencontrent et se marient. En 1937, sa mère lui donne naissance à Genève et retourne trois mois après en Kabylie où elle et son mari son en poste à Arassa. Quelques temps plus tard, ils sont affectés dans une école du petit village d’Ighil Bouzerou, où l’arrivée de soeurs jumelles complète la fratrie. « Nous étions les seuls européens, il n’y avait pas de colons. Autour de Tizi Ouzou il n’y avait que des bleds », sourit Danièle Malley-Champeaux. Au milieu de la population berbère, la petite Danièle grandit. La révolte de Sétif, réprimée dans le sang en 1945 contraint la famille à séjourner quelques jours à l’hôtel à Tizi Ouzou « quand nous sommes rentrés chez nous sans mon père, le caïd a assuré que nous ne risquions rien mais a confié un fusil à ma mère. J’ai compris dans ma tête d’enfant que quelque chose de grave s’était passé ».
Néanmoins l’événement n’occulte pas des années d’enfance paisible dans sa mémoire. « J’allais à la classe de mes parents, il n’y avait que des petits garçons. Je parlais couramment leur langue. Jusqu’à l’âge de 9 ans, j’étais une petite Kabyle », confie-t-elle.
Ses parents sont en effet nommés en 1946 à Azazga, une localité située quelques dizaines de kilomètres à l’Est de Tizi Ouzou. Dans la petite ville, elle découvre les européens et le regard porté sur « les autres ». « Je parlais comme les Kabyles, les autres enfants européens se moquaient de moi. À 9 ans c’est dur » Deuxième rupture : Danièle Malley-Champeaux est envoyée en 6e au lycée Fromentin d’Alger. C’est le début de 9 ans d’internat qui lui pèseront malgré le cadre exceptionnel : « un hôtel mauresque somptueux, des jardins magnifiques ».
1er novembre 1954 à Azazga
Lorsque le 1er novembre 1954 une vague d’actions armées à l’appel du FLN marque le début de la guerre d’Algérie, elle est à Azazga dans sa famille. « Nous avons entendu des claquements. Nous avons laissé mes petites soeurs au lit pour aller voir dehors, le dépôt de liège brûlait », se remémore-t-elle. Le lendemain, on apprendra que la gendarmerie avait été visée par des tirs et que l’incendie du dépôt était volontaire.
Revenue au lycée, « j’entendais toujours le même discours. A grands traits c’était : "il y a nous, les meilleurs, nous avons tout fait et eux, les autres, qui veulent tout nous prendre" », rapporte-t-elle. Difficile de s’y retrouver lorsqu’on est si jeune. Un jour, elle lance une phrase de cet acabit à la table de ses parents à laquelle été convié le médecin de famille, un Kabyle. « Il m’a prise à part. Il m’a parlé comme à une adulte. J’étais prête à comprendre des choses, je les ai comprises », résume pudiquement Danièle Malley-Champeaux.
Plus la guerre avance dans l’horreur, plus ses convictions s’affirment. « J’ai vu des villages brûlés au napalm. Que pouvait-on faire ? C’est terrible. Comment a-t-on pu supporter cette douleur ? » interroge-t-elle, avant de marquer un silence, le souffle coupé par l’émotion.
Un jour au lycée, le débat s’anime entre jeunes filles en cours de philosophie autour des injustices et des bidonvilles. « Je ne pouvais plus me taire. Je me rappelle avoir dit à une camarade "toi qui va à la messe tous les jours ça ne te fait donc rien ?" Elle m’a répondu : "humainement oui, politiquement non" » ? Danièle Malley-Champeaux n’en revient pas, décidément ce n’était pas son monde.
Quand de Gaulle prononce son discours place du Forum en 1958, elle n’y va pas : « Tout Alger s’est déplacé. Tout n’était qu’un grand carnaval ». Quelque mois plus tard pour son premier vote, lors du référendum sur les institutions de la Ve République elle glissera le bulletin Non « avec fierté » et un certain sens du défi : contrairement au bulletin Oui qui était blanc le Non était de couleur et se devinait sous l’enveloppe, se souvient-elle.
L’année suivante elle entre à l’école normale et se marie. Arrive son premier enfant, Frédéric. « Il y a eu le putsch en avril 1961. C’était la peur, la guerre et je n’ai pas senti de soutien à cette tentative à l’école normale », témoigne-t-elle.
Alors que Danièle Malley-Champeaux et son mari terminent leur formation, on les incite à partir dans le Sud de l’Algérie. « On nous a fait miroiter la maison, les vacances, nous étions jeunes. Nous sommes partis ». Direction El Atteuf, une localité proche de Ghardaïa, aux portes du désert. « Nous étions deux couples d’européens au milieu des Mozabites », se remémore Danièle Malley-Champeaux. Si loin de tout, ils vivent préservés du vacarme qui a accompagné les derniers jours de l’Algérie française. « Nous avons compris que c’était l’Indépendance quand nous avons vu les drapeaux algériens arriver et la liesse. Nous jouions aux boules. On a continué », s’amuse-t-elle avant d’ajouter : « J’étais contente, c’était un juste retour des choses ».
Les instituteurs décident de passer les vacances d’été en France pour éviter à leur jeune fils les chaleurs sahariennes mais cette année les départs se font au compte-goutte. Sans se poser trop de questions, ils reprennent leur poste à la rentrée. « Nous avons vu arriver des enseignants Algériens, Syriens, Libyens pour donner des cours d’arabe. C’était un peu chaotique au début mais nous n’avons jamais senti d’animosité ».
Le couple a un deuxième puis un troisième bébé. « C’était un noir qui s’occupait de mes enfants, il avait conservé de la seconde guerre mondiale une énorme balafre sur le corps », se rappelle Danièle Malley-Champeaux. En 1970, c’est pour eux que la décision est prise de quitter le Sud algérien. « Je ne voulais pas qu’ils connaissent comme moi l’internat ».
Le couple formule des voeux dans le réseau de la Coopération sans succès puis demande à être affecté « dans la moitié Sud de la France ». Mais voilà Danièle Malley-Champeaux et son mari, nommés dans un collège de l’Oise, à Compiègne. « On ne savait même pas où c’était... » L’accueil n’est pas chaleureux. Pas plus que le logement insalubre qui leur est réservé.
Son retour la chavire
15 ans plus tard, Danièle Malley-Champeaux obtient sa nomination au poste de principale du collège Joliette Vieux-Port de Marseille. « Les noms des élèves m’étaient plus faciles à lire que les noms polonais de Compiègne », rit-elle aujourd’hui. Elle est ensuite nommée à Vitrolles où elle prend sa retraite en 1994. Travaillée par son passé, elle va jusqu’à engager un détective pour retrouver ses anciens amis d’Algérie. Puis à l’occasion d’une projection de film, elle rencontre une dizaine d’année plus tard l’association des pieds-noirs progressistes. C’est le déclic qui lui permet d’envisager un voyage en Algérie. Au début, elle n’ose le dire à sa famille et finit par laisser parler son coeur.
Fin 2013 le retour dans ce pays « qui m’a faite », la chavire. Odeurs, souvenirs, chaleur humaine... Danièle Malley-Champeaux se promet de réapprendre le berbère et de conduire bientôt ses six petits-enfants sur les traces de son passé : « J’étais tellement heureuse quand j’ai touché la terre d’Algérie. Ce pays est en moi, ce pays c’est moi ».
Léo Purguette
SOURCE : http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/societe/30881-l-algerie-a-fleur-de-peau
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 10 Septembre 2014 à 09:14
" Mon meilleur copain s’appelait Farouk, on a fait les 400 coups ". Photo Robert Terzian (c) Copyright Journal La Marseillaise
D’une médersa fréquentée en douce à son travail de cheminot à la gare Saint-Charles en passant par Cambrai, Alain Filliard raconte une vie menée tambour battant et l’amour qu’il voue à sa terre natale.
Volets baissés, Alain Filliard natif d’Aïn Séfra dans l’Atlas saharien tient à recevoir ses hôtes à l’abri de la chaleur estivale. La parole facile, ce retraité qui réside aujourd’hui à Vitrolles évoque volontiers le parcours qui l’a conduit des portes du désert à la région marseillaise.
Petit dernier d’une fratrie de quatre enfants, il voit le jour en novembre 1946. De son père, cheminot, il hérite d’un patronyme venu de très loin. « Filliard c’est savoyard, j’y tiens, j’ai même effectué des recherches généalogiques qui m’ont conduit à Chambéry ! » lance-t-il d’emblée. Son ancêtre paternel est arrivé en 1843 en Algérie, poussé par des conditions de vie très rudes. Plus tard mais pour des raisons semblables, sa grand-mère maternelle a quant à elle quitté Fiñana en Andalousie pour s’établir en Oranie.
En 1954 débutait la guerre d’Algérie. Pendant huit ans elle allait bouleverser la vie de l’autre côté de la Méditerranée et déboucher sur l’Indépendance, poussant les pieds-noirs au « retour » dans un pays souvent inconnu : la France. Déracinés, nombreux sont ceux qui ont trouvé un nouveau port d’attache dans le Sud de l’hexagone. Une part de ces rapatriés qui a soutenu l’Organisation de l’armée secrète (OAS) dans son recours au terrorisme pour maintenir la domination coloniale, a progressivement confisqué la mémoire et la parole pieds-noires. D’autres ont suivi un tout autre cheminement. 60 ans après le déclenchement de la guerre, La Marseillaise est allée à leur rencontre.
À Aïn Séfra -la source jaune en arabe- Alain Filliard se souvient d’une enfance « passée avec les petits musulmans », même si la ville était coupée en deux par un oued. D’un côté les quartiers européens, de l’autre « ce qu’on appelait le village nègre, c’était péjoratif, aucun doute là dessus ». Et à proximité de celui-ci le siège d’une compagnie méhariste, Aïn Séfra était ville de garnison.
Une bombe
En 1954, son père est muté à Tlemcen. « Dès le premier jour, nous n’avions pas encore défait les valises que les vitres ont volé en éclats », se remémore-t-il. Une bombe qui visait des dépôts d’essence implantés à proximité des installations ferroviaires venait d’exploser. L’atmosphère s’alourdit. Pas de quoi décourager néanmoins les enfants de jouer ensemble.
Alain Filliard qui parlait arabe avec ses amis d’Aïn Séfra, se lie à nouveau avec des petits musulmans. « Mon meilleur copain s’appelait Farouk. On a fait les 400 coups ! », sourit-il. Fils du riche propriétaire d’une fabrique de tapis, le jeune garçon passait chaque jour à la médersa où l’on apprend le Coran avant d’aller à l’école. « Il me disait à chaque fois : "Alain tu m’attends !" Moi je ne voulais pas l’attendre mais entrer. Problème : je refusais d’enlever mes chaussures », s’amuse-t-il. Un beau jour, il se décide à les retirer « mais je les ai quand même gardées sous le bras ». Discipline de fer et coups de bâton « il ne fallait pas se tromper d’une virgule... Cela dit en arabe, il n’y en a pas », rit Alain Filliard aujourd’hui.
Farouk et lui n’en disent pas un mot. « Nous étions des enfants comme les autres. Il goûtait souvent chez nous, on se régalait avec les confitures de ma mère », se remémore-t-il. Insouciants et parfois inconscients, ils bravent les mises en garde et passent par les chemins interdits. Les adultes, eux, basculent de l’inquiétude à l’effroi. Une nuit d’août 1957, le beau-frère d’Alain, un gardien de la paix est tué à 27 ans dans l’exercice de sa fonction, laissant sa grande sœur seule avec deux enfants en bas âge.
La guerre s’intensifie, les enterrements se multiplient et sont autant d’occasions de manifestations de colère. « Il y avait des mouvements de foule, il ne fallait pas pour un européen se trouver à côté d’un enterrement musulman. Mes parents n’étaient pas haineux, ils étaient surtout très inquiets pour mon frère, allé faire son service militaire en Kabylie en 1959 », témoigne Alain Filliard.
Par la force des choses, les liens qui l’unissent à ses amis musulmans se distendent. Fin 1960, le jeune Alain assiste au discours de de Gaulle en visite à Tlemcen. « Il disait encore "Algérie française" mais avec une bouche un petit peu plus serrée », ironise-t-il.
Tout s’enchaîne très vite, l’Indépendance approche. Un matin sa mère lui dit de ne pas aller à l’école. « Elle a ficelé quelques valises et nous sommes partis, elle, mes neveux et moi pour Sidi Bel Abbès », rapporte-t-il. Sur le quai de gare, en attendant le train, « un voleur de poules déguisé en soldat de l’ALN », demande à la famille d’ouvrir ses bagages. Un garde mobile le met en fuite. « Je ne l’ai su qu’après, ma mère avait caché dans une valise un 6,35 mm qui avait été confié à mon père », soupire Alain Filliard.
« À Sidi Bel Abbès où vivait ma famille maternelle, j’ai vu la bêtise, humaine, les manifs de l’OAS. Je les ai vu désarmer un soldat qui faisait son service, le pauvre... », dit-il en pinçant ses lèvres. Le mari de sa seconde sœur, qui « s’est fait entraîné dans cette saloperie d’organisation qu’était l’OAS » disparaîtra le jour de l’Indépendance.
Quelques temps plus tôt, Alain Filliard, à 15 ans et demi avec ses deux neveux âgés quant à eux de 7 et 5 ans, prennent le car pour Oran. « Je me souviens du chauffeur qui à tout moment criait "couchez-vous !" », rapporte-t-il, non sans émotion.
Ils embarquent sur le Lyautey, un paquebot spécialement arrivé à Oran pour absorber l’afflux de rapatriés. Direction Marseille pour rejoindre sa sœur aînée, la mère de ses deux neveux, qui s’y était établie avec son second mari.
Catastrophe : le couple parti à Sainte-Maxime pour le week-end ne reçoit pas le télégramme qui annonce leur arrivée imminente. Sur le port de Marseille, les neveux sont en larmes. C’est le dilemme : rester pour ne pas rater le rendez-vous ou se rendre à Endoume à l’adresse de sa sœur. Un taxi refuse le trio : leurs billets sont en francs algériens. Finalement, un couple marseillais les accompagne et ils sont reçus par des voisins de sa sœur très prévenants.
C’est le début d’une nouvelle vie. Quand sa sœur tente de l’inscrire au lycée Colbert, le principal la raccompagne « vous n’avez pas de dossier scolaire ? Je ne veux pas le savoir. Ne vous en faites pas, à son âge, il saura casser des cailloux » . Rejoint par sa mère, Alain Filliard s’installe à la Belle-de-Mai « mon voisin c’était Francis le Belge, j’avais quitté l’Algérie pour le Far West... », plaisante-t-il.
Il apprend le métier de plombier auprès d’un patron qui finira aux Baumettes et se découvre une passion pour la batterie. Son père, relevé de ses obligations professionnelles en Algérie est à deux ans de la retraite. Par fierté, il demande une nouvelle affectation. Ce sera Cambrai. Les immenses dunes de Aïn Séfra sont bien loin. « Mais tout comme le service militaire à Kaiserslautern, ce fut une période formidable », assure Alain Filliard. De retour à Marseille, il rencontre Yvette, une employée des PTT, en 1967. « On s’est marié pendant la guerre, en 1968 », dit-il dans un éclat de rire.
« Bienvenue chez vous »
Devenu cheminot « par hasard », il passe de gare en gare jusqu’à Marseille Saint-Charles. Il y restera jusqu’à sa retraite.
En 2012, 50 ans après l’Indépendance, ses deux fils le poussent à revenir aux sources, à sa source : Aïn Séfra. Dans l’avion qui conduit la famille à Tlemcen, Alain raconte son histoire au passager voisin. « Quand nous nous sommes posés deux femmes voilées qui étaient assises devant moi se sont soulevées. Elle m’ont dit : "Monsieur, bienvenue chez vous". Ça prend aux tripes », confie-t-il avant de s’interrompre pour passer la main sur ses joues humides. Son voyage le bouleverse. Il croise la route du frère d’un de ses anciens camarades de classe. Coup du destin, Farouk qui a repris l’activité de son père, est au même moment en France pour son commerce. À Aïn Séfra, Alain Filliard est reçu en frère. « Nous allons y retourner, ils nous attendent », promet Alain Filliard, fier de ne pas avoir versé dans le ressentiment et le racisme comme une partie des siens avec lesquels il a rompu les liens. Fier aussi de ses enfants « c’est grâce à eux et à ma femme que j’ai franchi le pas ». Chez les Filliard on a le rail comme la musique dans le sang. Ses deux fils sont eux aussi cheminots et le dernier, Tony, chante dans le groupe marseillais Rascal riddim reggae.
Léo Purguette
SOURCE : http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/31202-alain-filliard-ne-savoyard-au-creux-des-dunes
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 10 Septembre 2014 à 07:45
Algérie : le lourd héritage du colonialisme
http://www.4acg.org/Algerie-le-lourd-heritage-du
samedi 6 septembre 2014, par Michel Berthelemy
Parmi les « bienfaits » généreusement accordés par la France à l’Algérie, dont les effets se font sentir aujourd’hui encore, figurent en bonne place les millions de mines antipersonnel laissées par l’armée française, et les conséquences humaines des essais nucléaires dans le sud-algérien.
Les mines antipersonnel implantées par la France durant la guerre d’indépendance ont fait depuis 1962 plus de 4000 victimes, la dernière en date étant un enfant de 10 ans, dont la famille réside dans la wilaya de Biskra. A ce jour, les démineurs algériens en ont neutralisé 9 millions. Combien en reste-t-il ? Personne ne le sait. Chaque mois, plus de quatre mille de ces engins de mort sont détruits. Plus de 60000 hectares ont été nettoyés, principalement sur les lignes Challe et Morice. Le chantier est prévu jusqu’en 2017.
Le jour de l’indépendance, l’Algérie a brutalement été confrontée à ce drame : où sont les mines ? Comment les détruire ? Avec quels spécialistes ? Aucun plan n’avait été remis par la France avant 2007. A l’arrêt de 1988 à 2004, notamment du fait de la « décennie noire », les opérations de déminage ont repris après la ratification par l’Algérie de la convention d’Ottawa. Cette convention, qui engage 164 États membres, dont l’Algérie et la France, interdit l’emploi, le stockage, la production et le commerce des mines antipersonnel. Elle les oblige au déminage et à la destruction des stocks. Seul défaut : la convention ne prévoit pas de pénaliser les pays responsables de la pose des mines. Aujourd’hui, les victimes handicapées ne reçoivent aucune aide de la France, faute d’une reconnaissance officielle de sa responsabilité. Et la modeste pension versée par le gouvernement algérien reste largement insuffisante en regard des traumatismes et des handicaps subis par les victimes.Le désastreux bilan des essais nucléaires français
Autre « bienfait » de l’héritage colonial : les décès et maladies dus aux essais nucléaires français dans le sud-algérien de 1960 à 1966. Aujourd’hui encore, des personnes contaminées meurent de cancer. Vingt femmes, hommes et enfants sont décédés à Tamanrasset dans le seul mois de juillet de cette année. L’association AVEN de Taourirt se bat pour faire reconnaître par la France le droit des victimes. En vain jusqu’à ce jour, la loi Morin de 2010 ne s’intéressant qu’aux victimes françaises, qui plus est de la manière la plus restrictive qui soit.
L’AVEN a élaboré en mai dernier une plate-forme de revendications, soumise à l’ensemble des autorités compétentes. Principaux points soulevés : l’indemnisation des victimes, la décontamination des sites et l’amendement des lois actuelles, qui évitent soigneusement de parler des victimes algériennes, en occultant la présomption d’origine et en limitant le seuil d’exposition et le nombre de pathologies radio-induites.Une plainte contre la France ?
Une plainte contre la France devrait être déposée auprès du Tribunal européen des droits de l’homme, pour demander non seulement la modification de la loi Morin, mais aussi le droit à dédommagement pour tous les habitants du Sahara algérien concernés par le problème.
Faute d’un recensement précis, on évalue à peu près à 500 le nombre de personnes touchées dans les seules localités relevant de la commune de Tamanrasset. Plus de 20% des femmes seraient atteintes du cancer du sein, et 10% du cancer de la thyroïde. Le représentant local de l’AVEN souhaite vivement la réalisation par la France de structures sanitaires spécialisées, destinées à prendre en charge les personnes impliquées, ainsi que leur descendance. Il demande enfin à la France d’assainir les zones polluées, de délimiter les endroits à risques, de déterminer les lieux d’enfouissement des déchets nucléaires, et d’évaluer les niveaux de radiation dans les régions contaminées.
Souhaitons qu’il soit entendu.Michel Berthelemy
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 9 Septembre 2014 à 08:04
Miss Algérie
Vive l'Algérie algérienne!
Ce qui se passe autour de la soirée Miss Algérie est complètement hallucinant. Pour un petit mot de travers, on m'accuse d'être « Algérie française » ? Mais enfin, on ne peut se méprendre sur mes opinons. Tout le monde sait que je suis à gauche !
À Alger, tout s'est très bien passé. Beaucoup de monde est venu faire des photos avec moi, on a passé une très belle soirée et avant la proclamation finale, j'ai dit quelques mots. J'ai parlé des polémiques en France sur le port du foulard : je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en porter ! Quand c'est un foulard Dior ou Hermès, personne ne dit rien... Et j'ai bien entendu fait des photos avec des jeunes filles qui portaient le foulard. C'était la deuxième année consécutive, après Oran en 2013, et j'étais très fière d'honorer cette élection.
J'ai bien entendu également dit que maintenant, en France, nous avions dans nos concours des jeunes filles d'origine maghrébine, et je serais très heureuse qu'une Miss Prestige nationale soit d'origine nord-africaine. C'est ça le rapprochement entre les peuples. Comme je le dis souvent, il faudrait que les canons de la beauté remplacent ceux de la guerre.
J'ai également eu un mot de mise en garde aux médias qui venaient de passer en boucle cette terrible image du jeune journaliste américain décapité. Deux jours plus tard, un homme était décapité en France... et j'ai voulu sensibiliser sur la diffusion en boucle de ces images dans les journaux.
On m'a quelque peu pressé pour mon discours, en me disant « allez vite il faut conclure », et mes mots on dépassé ma pensée. J'ai conclu en voulant dire « vive l'Algérie, et vive la France », et malheureusement ma langue a fourché. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je dis « Vive l'Algérie algérienne » ! Vive l'Algérie algérienne, et vive les collaborations avec les autres pays.Il y a eu quelques sifflets et puis c'est tout. Depuis, j'entends dire que certains notables présents sur place auraient souhaité qu'il s'agisse de la dernière édition que l'élection ne se fasse plus à l'avenir. Est-ce que ce malheureux lapsus a été utilisé comme excuse pour s'élever contre ce concours ?
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 8 Septembre 2014 à 08:59

Discours du 6 septembre 2014
par la conseillère générale Andrée Oger
"Mes chers Camarades,
Je crois pouvoir utiliser cette formule car je suis de votre génération, celle qu’on a envoyée « maintenir la paix » en Afrique du Nord, élégant moyen de ne pas dire « faire la guerre » là-bas.
Comme si on pouvait, par la force, empêcher un peuple d’obtenir son indépendance !
Quel a été le résultat ? des milliers de morts, des souffrances insoutenables de part et d’autre, un pays dévasté, des rancœurs difficilement surmontables.
Un vrai gâchis !
On vous a demandé des sacrifices incroyables, on a exigé de vous de participer à une guerre inutile et meurtrière qui soulevait la réprobation de nombreux pays et de nombreux français. Je me souviens des journaux de l’époque, censurés : une bonne partie de la première page avec des blancs à la place d’articles révélant des choses que nous ne devions pas savoir !
Mais c’est le passé et si nous devons vous rendre hommage, il faudrait surtout que les gouvernants tirent des leçons de ce passé.
Or que voyons-nous ? Partout dans le monde, plus que jamais , il y a la guerre et nous nous octroyons le droit d’aller faire les gendarmes sur toute la planète.
Au lieu de prôner la négociation, la diplomatie, on arme ceux-là pour combattre ceux-ci avant de s’apercevoir que les premiers étaient aussi dangereux que les seconds. Mais on a vendu des armes !
Car c’est bien nous les occidentaux qui avons armé ces djihadistes pour qu’ils renversent les gouvernants qui ne nous plaisaient pas, ces djihadistes qui se révèlent aujourd’hui les pires extrémistes qui soient.
C’est ainsi qu’on est intervenu en Afghanistan.
Grâce à Chirac la France n’est pas allé en Irak mais nous voilà en Libye, au Mali, en Centrafrique.
On veut aller en Ukraine et nous menaçons au travers de l’OTAN, la Russie.
Arrêtons, arrêtons toutes ces guerres !
Nous avons bien d’autres choses à faire : utilisons plutôt tous nos moyens pour lutter contre la maladie ! Pensons à la fièvre ébola par exemple où les malades et les soignants, en Afrique, manquent de tout! Pensons au cancer !
Nos moyens devraient servir aussi pour intervenir en cas de grandes catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre etc… dans de grandes actions de solidarité.
La France serait alors en accord avec sa devise Liberté Egalité et Fraternité, elle pourrait jouer un grand rôle pour le maintien des valeurs qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas un grand pays par notre taille ni par notre nombre de population. Restons un grand pays par le respect de nos valeurs humanistes qui ont fait notre renommée.
Voilà ce qui me semblait important de dire en ce jour de commémoration."
Andrée OGER, conseillère générale,
Saint-André, le 6 septembre 2014 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 7 Septembre 2014 à 14:17

Dans le cadre des commémorations de la Guerre de 14/18, une manifestation miltaire, présidée par Pierre de Villiers, Chef d'Etat Major des Armées s'est déroulée à Versailles le samedi 6 février 2014. A cette occasion, es-qualité de Président de l'ARAC des Yvelines l'ai remis en main propre au premier militaire de France cette lettre ouverte :
Objet : Assassinat de Maurice Audin
Mon Général,
Notre association regroupant de nombreux Anciens Combattants de la Guerre d'Algérie reste très sensible aux questions de mémoire, de vérité sur cette triste période pendant laquelle de nombreux camarades ont tant souffert.
Personnellement, affecté de fin juin 1961 au 12 mars 1962 à la Villa Susini à Alger, ce centre qui a eu ce triste privilège d'être un centre où s'est pratiquée la torture pendant toute la Guerre d'Algérie, je reste profondément marqué par ces odieuses barbaries. Ce passé me rend d'autant plus sensible à tout ce qui concerne la torture pratiquée pendant la Guerre d'Algérie. J'ai témoigné publiquement à de nombreuses reprises. Alors la question de "Maurice Audin" reste donc, pour moi, comme pour sa famille et de très nombreux Français humanistes soucieux des droits de l'homme, une affaire qui n'a pas encore été réglée depuis ce 11 juin 1957, jour de sa "disparition".
Je profite donc de votre venue à Versailles en ce 6 septembre 2014 pour vous remettre directement cette lettre que je vais rendre publique pendant le week-end, comme je publierai évidemment votre réponse dès qu'elle me parviendra.
Lors de l'exposition officielle réalisée à l'Hôtel des Invalides à Paris (entre le 16 mai et le 29 juillet 2012) "Algérie 1830-1962", pour la première fois, l'Armée avait reconnu, de fait, discrètement, ce qu'elle avait toujours nié jusqu'alors : la pratique de la Torture et des Viols. Aucun des autres crimes commis dans cette période n'ont été à ce jour ni reconnus, ni donc condamnés. Les plus hautes autorités de la France sont restées muettes. A quelques semaines du 60ème anniversaire du déclenchement de la Guerre d'Algérie, il serait plus que temps que ce silence soit enfin rompu.
Le cas de Maurice Audin est emblématique dans ce domaine. Jusqu'au 17 juin 2014, la seule version officielle restait une "évasion" de ce mathématicien. A l'occasion de la remise du "Prix de Mathématiques Maurice Audin" le Président de la République François Hollande diffusait le 18 juin 2014 ce communiqué : "Aujourd’hui est remis le Prix AUDIN de mathématiques, en mémoire de Maurice AUDIN, jeune professeur et militant de l’Algérie indépendante. Depuis mon entrée en fonction, j’ai fait de l’exigence de vérité la règle à chaque fois qu’il est question du passé de la France. C’est cette exigence qui m’a guidé quand, à l’occasion de mon voyage à Alger en décembre 2012, j’ai rappelé notre devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. C’est cette exigence qui m’a conduit à ordonner que soient engagées des recherches sans précédent dans les archives du ministère de la Défense, afin de découvrir si des documents officiels permettaient d’éclairer de façon définitive les conditions de la disparition de M. AUDIN en juin 1957. Ces recherches n’ont pas permis de lever les incertitudes qui continuent d’entourer les circonstances précises de la mort de M. AUDIN, que la Justice n’a plus les moyens d’éclairer. C’est aux historiens qu’il appartient désormais de les préciser. Mais les documents et les témoignages dont nous disposons aujourd’hui sont suffisamment nombreux et concordants pour infirmer la thèse de l’évasion qui avait été avancée à l’époque. M. AUDIN ne s’est pas évadé. Il est mort durant sa détention. C'est ce que j’ai voulu signifier en me rendant le 20 décembre 2012 place Maurice AUDIN à Alger, devant la stèle qui honore sa mémoire. C’est ce que j’ai dit à Mme AUDIN en la recevant le 17 juin 2014, 57 ans après la disparition de son mari à l’égard duquel un devoir de mémoire et de vérité nous oblige."
Enfin, la thèse de l'évasion, à laquelle personne n'a jamais sérieusement cru, vient de se voir rangée au tiroir des affabulations. Mais l'expression "Il est mort en détention" reste affligeante : dans quelles conditions est-il mort pendant sa détention ? Il est effectivement très probable que l'Armée a délibérément effacé toutes les preuves formelles dans ses archives, dès l'assassinat de Maurice Audin, pour "justifier" la mascarade d'une pseudo évasion.
Cependant, ce communiqué proviendrait "des recherches sans précédent dans les archives du ministère de la Défense, afin de découvrir si des documents officiels permettaient d’éclairer de façon définitive les conditions de la disparition de M. AUDIN en juin 1957". Ainsi, d'après le Président de la République, c'est donc sous votre responsabilité que cette "enquête" a été menée. Ce communiqué précise "que des documents et des témoignages dont nous disposons aujourd’hui qui sont suffisamment nombreux et concordants…." prouvent que Maurice Audin ne s'est pas évadé et est mort en détention. Comment se fait-il alors que Josette Audin, au près de qui François Hollande s'était engagé à lui transmettre TOUTES les archives concernant cette affaire, n'en a pas été destinataire, y compris lors de sa rencontre avec le Président de la République du 17 juin 2014 ? C'est donc, par déduction, les nombreux témoignages "concordants" qui ont permis cette conclusion. Le 26 janvier 2014, j'envoyais une lettre ouverte au Ministre Jean-Yves Le Drian (toujours sans réponse), dont je vous joins une copie avec ce courrier. Ce courrier résumait l'essentiel de ce dossier, mais aussi expliquait que l'Armée disposait encore d'assez de témoins de cette époque, encore vivants, capables de "révéler" la vérité sur cette question.
La hiérarchie militaire dispose de tous les moyens d'établir la liste des militaires encore vivants qui ont été des témoins directs de cet assassinat et de recouper les divers éléments, témoignages de ce puzzle pour qu'enfin la vérité soit connue. Le Général Maurice Schmitt (qui occupa les mêmes fonctions que vous actuellement, il y a quelques années) était capitaine à l'époque des faits, dans les fonctions d'officier de renseignements. Il rencontrait donc quotidiennement au QG de l'Etat Major d'Alger tous les autres officiers de renseignements du secteur ? Ils se retrouvaient pour faire le point sur leurs "résultats". Le cas de Maurice Audin (comme celui de Henri Aleg) a donc été obligatoirement commenté très largement étant donné l'importance de tels "détenus". Le lieutenant Jean-Marie Le Pen, lui aussi officier de renseignement opérant à la Villa Susini, venait de quitter Alger, mais il ne pouvait pas ne pas avoir gardé des contacts suffisants pour savoir comment se poursuivait sa mission "casser du bougnoule" comme il aimait tant à le dire, et donc savoir ce qui était advenu de Maurice Audin. Il y a aussi le témoignage écrit du Colonel Godard (découvert à Stanford en Californie – Hoover Institution- par la journaliste du Nouvel Observateur Nathalie Funès) qui affirme que l'agent d'exécution de Maurice Audin serait le propre aide de camp du Général Massu : le sous-lieutenant Garcet de l'infanterie coloniale. Or cet officier est encore vivant. Il devrait donc, lui aussi, pouvoir confirmer la vérité concernant cet assassinat. Il semble donc, d'après ce communiqué présidentiel que de nombreux témoignages ont été effectivement collectés, alors, pourquoi les conditions de cet assassinat ne sont-elles pas données publiquement ? Combien de temps vont-elles rester "secret défense", ou "secret d'état" ?
L'exécution de Maurice Audin, résulte-t-elle d'une double décision : celle du Général Massu et celle du gouvernement, comme l'affirme le Général Aussaresses, dans les confidences faites à la fin de sa vie à Jean-Charles Deniau ?
Il est également très important de savoir ce que l'armée a fait du corps de Maurice Audin. En quel lieu s'en est-elle "débarrassé" ? Est-ce dans un charnier de la banlieue d'Alger, comme le laissent entendre les confidences du Général Aussaresses ?
Il est de votre autorité, mon Général, que l'Armée Française s'honore à ne pas rester la "grande muette" mais révèle, enfin, sa responsabilité sur ce plan et que toute la vérité soit enfin connue.
En attendant d'avoir votre réponse à cette lettre, je vous prie d'agréer, Mon Général, mes plus sincères salutations.
Le Président
Henri POUILLOT
PS. Dès que je recevrai la réponse, je la publierai
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 7 Septembre 2014 à 08:38
Lors de la lutte de Libération en 1960, la France procédait à des essais nucléaires en Algérie, cinquante-deux ans après, la France tourne toujours le dos à son passé, et refuse de parler justice avec les victimes algériennes, sacrifiées comme des cobayes pour assoupir la soif tortionnaire des généraux criminels français. Plus d’un demi-siècle après, il lui a fallu la réplique des familles des victimes des soldats français pour que ce scandale sorte de l’opacité via la justice française.

C’est ainsi que le prestige de la France comme puissance nucléaire, branle sous les menaces des familles des militaires français qui ont servi leur pays dans la zone d’essai nucléaire en Algérie durant la période coloniale , qui accusent la France de la destruction de la vie , ‘’ nous allons, cette fois, lever le voile sur un épisode tragique: les essais nucléaires par des scientifiques qui étaient loin de mesurer les conséquences de leurs expériences, jouant de ce fait aux apprentis sorciers avec la vie des autres, martèlent la veuve d'un pilote de l'Armée française victime d’essai nucléaire dans le Sahara Algérien.
La France épinglee par ses anciens militaires !
Cette veuve, demande réparation aujourd'hui devant le tribunal administratif de Besançon. Elle estime que le décès de son mari est la conséquence des essais nucléaires pratiqués en Algérie. En effet, le dossier des indemnisations pour les militaires français exposés aux essais nucléaires français en Algérie refait surface après que la veuve de ‘’Si Jean Leu ‘’, un militaire de carrière est décédé, réclame réparation et surtout reconnaissance par l'Etat français. Une affaire qui se trouve actuellement sur le bureau du juge au tribunal administratif de Besançon. Notons que, Gerboise bleue, c'est le nom de code qui avait été donné au tout premier essai nucléaire aérien effectué dans le Sahara le 13 février 1960 sur ordre du général de Gaulle. Cette explosion, quatre fois plus importante que celle d'Hiroshima, avait permis à la France de devenir une puissance nucléaire. Suivront Gerboise blanche, puis rouge, puis verte. Puis 13 autres essais, souterrains cette fois-ci. En tout, la France procèdera à 17 essais nucléaires dans le Sahara jusqu'en 1966.
Crime contre l’humanité…
C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que la France a lancé son programme nucléaire pour obtenir le statut de puissance mondiale aux côtés des USA, de l’Angleterre et de l’ex-URSS. Le 8 mai 1945, un Commissariat à l’énergie atomique a été créé par le général de Gaulle, qui avait pour mission principale la conception de la bombe atomique. Conséquences : Les essais nucléaires aériens ou souterrains effectués au Sahara algérien ont produit beaucoup de déchets, enfouis seulement à quelques centimètres de profondeur et fait beaucoup de victimes. Le premier site d’essais français au Sahara se trouvait à côté de Reggane, une région, comportant une population nomade qui se trouvait au nord de Reggane et dans la vallée du Touat. C’est là qu’ont eu lieu les quatre premiers tirs atmosphériques du 13 février 1960 au 25 avril 1961. Outre dans tout le Sahara algérien, les retombées radioactives ont été enregistrées jusqu’à plus de 3000km du site. Les six (06) premiers tests ont eu lieu à l’époque où l’Algérie était sous l’occupation française et les autres essais au nombre de onze (11) se sont déroulés après l’Indépendance du 5 Juillet 1962 et ce, jusqu’en février 1966.
La France accusée par 30 000 victimes algériennes !
Alors qu’en France, 300 personnes seulement, affirment avoir contracté des pathologies radio-induites, c’est-à-dire des maladies provoquées par l’exposition aux radiations telles que des cancers et leucémies, en Algérie, le nombre des victimes algériennes de ces essais nucléaires a dépassé les 30 000, selon le président de l’Association des victimes des essais nucléaires, M. Abdelhak Bendjebbar. Pour maquiller ces crimes, la France vote une loi sur l’indemnisation des victimes des 210 essais nucléaires français, déclarés en Algérie et en Polynésie, mais elle classe les victimes algériennes en seconde position, ce qui a poussé les associations des victimes algériennes a rejeté l’indemnisation, la considérant comme une humiliation, pour l’Algérie qui demande la vérité, celle de la reconnaissance des crimes commis par la France de ‘’Dé gaulle’’. L’Algérie exige donc, « la levée du secret défense sur toutes les archives concernant les expérimentations afin qu’elles servent de document de référence aux experts ». Pour les victimes algériennes, la question n’est pas une affaire d’indemnisation des victimes irradiées, mais plutôt celle de la reconnaissance des crimes commis contre des populations innocentes. Bien que les crimes de la France sont pourtant réels et historiquement les victimes font tout pour amener la France à reconnaître ses crimes et prendre ses responsabilités, l’Etat Français refuse toujours de voir la réalité en face et reconnaître ses crimes pour enfin indemniser les victimes algériennes. Faut t-il attendre la fin du procès des victimes françaises, pour que le gouvernement français reconnaisse son crime envers les victimes algériennes ?SOURCE : http://www.reflexiondz.net/_a31088.html
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 6 Septembre 2014 à 20:35
Geneviève de Fontenay, vendredi, à Alger. AFP / FAROUK BATICHE
Une jeune femme du quartier populaire de Bab El Oued, à Alger, a été élue vendredi miss Algérie lors d’une cérémonie marquée par une apparente gaffe de Geneviève de Fontenay...
L’ex-directrice du concours Miss France a en effet provoqué un incident dans les salons feutrés du palace algérois où a eu lieu l’élection, quand sa langue a fourché en parlant d’"Algérie française" alors qu’elle rendait hommage aux candidates de cette deuxième édition du concours algérien...
La ministre des Télécommunications Fatla-Zohra Derdouri a précipitamment quitté la salle, imitée par des artistes et d’autres personnalités.
Interrogée après la cérémonie, Mme de Fontenay s’est défendue et a indiqué qu’il n’y avait "aucune confusion" possible.
Le jury, présidé par le réalisateur Djaaffar Gacem et comprenant notamment l’ex-championne d’Afrique de judo Salima Souakri, marraine de cette édition, et la journaliste de la télévision publique Soraya Bouamma, a donc choisi Mlle Chouib parmi 20 candidates, qui ont défilé sur scène en tenues traditionnelles et en robe de soirée. La lauréate est ingénieur en informatique. L’Algérie sera représentée pour la première fois à la cérémonie de Miss monde en 2015.AFP
En complément lisez la presse algérienne
qui est très sévère
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 6 Septembre 2014 à 10:56

Jean-Yves Boursier vit à Chalon-sur-Saône. Il est membre du Comité du souvenir Jean Pierson. Il était professeur des universités à Paris, puis à Nice. Photo F. P
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Les réflexions du professeur Jean-Yves Boursier sur le rôle des commémorations. Une « fièvre commémorative »
70e anniversaire de la Libération oblige, les cérémonies s’enchaînent aux quatre coins du Bassin minier. Mais que commémore-t-on exactement ? Éléments de réponse avec J.-Y. Boursier.
Spécialiste de la mémoire de la guerre, Jean-Yves Boursier a publié plusieurs ouvrages sur les politiques mémorielles, la construction du passé, et du récit historique.
Plusieurs grandes commémorations marquent cette année 2014. Que cela vous inspire-t-il ?
Cette fièvre commémorative date d’une trentaine d’années environ, et qui fait que l’on commémore tout. En 2014, c’est le 70e anniversaire de la Libération. Mais en quoi est-ce plus important que le 68e ou le 69e ? On commémore aussi le début de la Grande Guerre, mais si on était logique, on commémorerait aussi le 60e anniversaire du début de la guerre d’Algérie…
Pourquoi ce choix dans les événements célébrés ?
Parce que la commémoration n’est pas utile pour le passé, mais pour le présent. C’est plus facile de produire du grand spectacle sur 14-18, quand il n’y a plus d’acteurs vivants. Alors que pour la guerre d’Algérie, vous avez encore beaucoup de monde, toute la classe 42. À mon sens, si on fait du grand spectacle, c’est parce qu’on pense avoir affaire à un passé apaisé, donc on peut se promener sans risques sur les champs de ruines. Le terrain est encore miné sur l’Algérie.
Que commémore-t-on aujourd’hui ?
C’est toute la question. Qu’est-ce que la Libération ? L’arrivée de l’armée de De Lattre ? La lutte des maquisards ? La Libération, c’est une foule en liesse et le départ des Allemands. Mais pendant ce temps-là, les camps de concentration fonctionnaient à plein. On n’a pas, avec 39-45, une date unique de commémoration, comme l’État l’a imposé avec le 11-Novembre. Pour la Seconde guerre, on a le 8-Mai, la journée de la Résistance, celle de la Déportation, il n’y a pas de consensus général. Après 39-45, les plaques, les stèles, ont été installées à l’initiative des familles, comme à Collonge-en-Charollais. On n’a pas, à Montceau-les-Mines, de plaque qui rend hommage aux Montcelliens qui étaient dans les maquis du coin. Il n’y a pas de politique de l’Etat dans ce domaine. Cela tient aussi au fait que les Allemands ont mené plusieurs guerres en 39-45 (contre les Juifs, les Tsiganes, les maquisards, etc.). Du coup, on assiste à une déclinaison des mémoires que chacun veut récupérer une mémoire qui a été oubliée dans la mémoire officielle.
N’y a-t-il pas quelque chose qui transcende toutes ces mémoires ?
En créant un apparat, la commémoration donne un lieu pour se retrouver ensemble. Mais n’est-ce pas une apparence qu’on utilise avec les opérations à grand spectacle, avec le tourisme de mémoire ? S’agissant de la Libération, que peut-on mettre en valeur, à part l’aspiration à la liberté d’une partie de la population ? Et quelle partie ? On n’a pas vu beaucoup de foule dans la Résistance, et c’est ce qui fait sa grandeur. S’il y a quelque chose à commémorer, c’est le combat des Résistants et des Forces françaises libres contre l’occupant et contre Vichy.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 6 Septembre 2014 à 09:06
Quatre ans après la fin de la guerre d’Algérie, un commando d’extrême droite tente d’arrêter la représentation des Paravents. Jean-Louis Barrault tient bon, la pièce sera jouée.
Le 30 avril 1966, un commando de « paras » se livre à un coup de main en plein Paris. Les «rebelles» à déloger sont une troupe de théâtre, et pas n’importe laquelle : Jean-Louis Barrault a regroupé autour de lui une quarantaine de comédiens dont certains sont déjà des gloires de la scène, Madeleine Renaud, Maria Casarès, Amidou, Gabriel Cattand, Marie-Hélène Dasté. La « guérilla » qu’ils jouent est une guérilla de l’art. Elle a un titre, les Paravents. Un auteur, Jean Genet. Les paras en question, en fait éternels énergumènes d’extrême droite, anciens combattants toujours en mal d’une guerre, élèves zélés de Saint-Cyr, n’ont rien compris à ce qui se passe à l’Odéon-Théâtre de France, comme ils n’ont rien compris à la guerre d’Algérie, terminée il y a déjà quatre ans. Ils sont autant ridicules que dangereux. Faute de se « payer » un Arabe, arrivés au sommet du « djebel », ils se font la « main » sur la grande Casarès, à qui ils disent de « foutre le camp ». Le rideau est baissé, mais le spectacle reprend un quart d’heure plus tard, et les représentations, commencées le 12 avril, iront jusqu’à leur terme.
Un « chef-d’œuvre dans la célébration du mal »
Comme on le dit du train, un scandale peut en cacher un autre. Ce n’est pas la prise de parti de Genet qui fait scandale, le vrai scandale, c’est son art de la provocation, du retournement des apparences. Genet dit, dans une interview donnée à Playboy : « Je crois que l’action, la lutte directe contre le colonialisme, fait plus pour les Noirs qu’une pièce de théâtre. » Et d’ajouter, faisant allusion à une autre représentation, les Bonnes : « De même que le syndicat des gens de maison fait plus pour les domestiques qu’une pièce de théâtre. » Jusqu’au bout, jusqu’à sa proximité avec les Palestiniens, Genet tiendra cette position. Le scandale Genet est dans la vérité de l’art, de « la scène qui s’oppose à la vie », dit-il dans ses fameuses lettres à Roger Blin, qui restera comme le metteur en scène faisant découvrir deux révolutions dans le théâtre : En attendant Godot, de Beckett, et ce Genet. Les Paravents, à partir d’un douar, de la « chierie-misère », de Saïd, voleur et traître, sont un parcours pour gagner le royaume des morts, le seul où l’on comprend tout. La scène emblématique du scandale est celle du blasphème contre l’armée : au-dessus de l’officier mourant, les légionnaires accroupis lui envoient des gaz pour lui faire respirer « l’air du pays »… Le scandale des Paravents s’inscrit dans les suites de la guerre d’Algérie, de ses passions, de ses folies, de ses extrémités. Genet vivra les événements qui voient la police le protéger, lui et sa provocation, avec le sourire malicieux et réjoui de celui qui a joué un bon tour à ceux qui le détestent. Contre la véhémence de la presse de droite, les critiques dramatiques de l’époque s’accordent tous à saluer la puissance de la représentation. Guy Leclerc parle d’un « chef-d’œuvre dans la célébration du mal ». L’ultime note est donnée par le ministre de la Culture qui n’est autre qu’André Malraux, à qui il est demandé d’interdire les représentations et qui, à l’Assemblée nationale, a ces mots : « Genet n’est pas plus anti-français que Goya est anti-espagnol. »
Les paravents de Jean Genet scandalise : les forces de l'ordre interviennent.
30 avril 1966
Fumigènes, cris, jets de chaises et d’objets blessants, hier soir au Théâtre de l’Odéon, le spectacle était… dans la salle !
Quinze jours après la première de la pièce de théâtre Les Paravents de Jean Genet mis en scène par Roger Blin, dans la presse et les esprits, la grogne ne fait que monter avec en chef de file Jean-Jacques Gautier, rédacteur de la page théâtre au Figaro. Mais hier soir, ça n’était plus des mots : la douzième représentation a été violemment interrompue par des « paras » qui commencent par crier : « Un scandale ! », « Une insulte faite aux morts et à l’armée ! », « Une pièce immorale ! Une honte pour la France qui se laisse insultée ». Et des mots, naturellement, ils en sont venus aux mains. Les forces de l’ordre ont du intervenir pour que la pièce puisse reprendre.
Les Paravents c’est 110 rôles servis par 65 comédiens dont Maria Casarès, Germaine Kerjean, Madeleine Renaud et, bien sûr, Jean-Louis Barrault; c’est 17 tableaux pour quatre heures de spectacle avec des changements de décor quasi continuels. Ce qui fâche ? Le langage cru de Genet et le pays où se déroule la pièce : en Algérie… Cinq ans après la fin de la guerre, les blessures sont encore sensibles.
Jean-Louis Barrault, directeur du théâtre, vient de répondre à une longue interview où il défend point par point ce texte qu’il juge majeur et dénonce la bêtise de ses détracteurs. Mais il est fort probable que le Ministre de la Culture, André Malraux, ne doive aussi intervenir puisqu’un premier député vient d’exiger que les sommes versées pour la subvention de la pièce soient rendues.
Dorénavant, les forces de l’ordre sont réquisitionnées chaque soir pour que le spectacle ait bien lieu… sur scène.http://www.live2times.com/1966-les-paravents-de-jean-genet-par-roger-blin-e--10339/
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 4 Septembre 2014 à 08:37
Sur cette carte qu'il a conservée, les consignes de « sécurité » : dérisoires face à une explosion atomique et aux radiations consécutives. Photo DDM Laurent Dard.
http://www.ladepeche.fr/article/2010/02/25/784710-odos-j-ai-servi-de-cobaye-humain.html
Il n'en a jamais parlé à ses fils. Mais le 13 février 1960, il était là-bas, en Algérie, lorsque Gerboise Bleue a explosé. Gerboise bleue ? C'était il y a 54 ans. La première bombe atomique française, 70 kilotonnes, quatre fois Hiroshima. « Et aujourd'hui, il faut que ça sorte », résume Pierre Metge, au terme d'un demi-siècle de silence, parce que « j'entends parfois n'importe quoi à la télé, que j'ai 72 ans et que je m'en fous désormais. Ils peuvent me retirer ma pension militaire, pour les 400 € (article écrit en 2010) par an qu'ils me payent en deux fois, hein… », lâche-t-il. Ne voulant rien demander à l'armée. Ne revendiquant aucun statut d'ancien combattant. N'appartenant à aucune association d'irradiés, non plus. Désirant juste témoigner du sort « d'un pauvre couillon » en Algérie pour que d'autres langues se délient. Lui qui fut pris dans une guerre qui n'était pas la sienne. Avant de finir son temps désarmé en première ligne face à LA bombe.
Sale guerre
Son histoire ? Le livret militaire et l'album photo la racontent à présent, sur la table du salon dans son petit pavillon d'Odos. Qui disent : « Pierre Metge, né le 28 octobre 1937 à Toulouse, marié en 1956, appelé le 1er novembre 1957, brevet militaire parachutiste n° 140 341 le 30 avril 1958 à Pau », puis le départ pour l'Algérie, le 4 juillet suivant. Là-bas, « je me suis retrouvé spécialiste en explosifs, détaché au 1er régiment étranger parachutiste, la Légion, à Zéralda », poursuit-il. Et cette guerre-là, qui le réveille encore aujourd'hui, il ne voulait pas la faire. Faire sauter des civils, accompagner les « corvées de bois »… lui qui n'était pas soldat de métier, juste appelé. Qui se rêvait footballeur pro à Paris, avant de partir se faire voler ses 20 ans. « Je leur ai dit que combattre l'ennemi en face, des gens qu'on voit, je voulais bien, mais pas ça. » Le 19 octobre 1958, « ils m'ont alors envoyé dans le territoire du sud ». Concrètement ? « On s'est retrouvés à Reggane, des gars d'un peu tous les régiments, sous les tentes, un peu à l'abandon et à rien faire d'autre que jouer au foot, à la pétanque, aux cartes, pendant des mois. » Plus d'armes. Pas d'autre uniforme qu'un short et une vareuse. Pratiquement aucun contact avec les officiers et les sous-officiers. Et pas une seule fois le nom du centre d'essais atomiques sur ses papiers… « En fait, on était au secret », poursuit-il. Mais en décembre 1959, le voilà enfin libérable. Il devait faire 14 mois, il en est à 24. « Seulement, ils nous ont gardés. La première explosion qui devait avoir lieu en décembre ayant raté, ils nous ont dit qu'on resterait jusqu'au premier tir. » Le 13 février 1960.
Balayé par le souffle
Pierre Metge se lève à présent. S'allonge à plat ventre dans le salon, replie son bras sur ses yeux. Rejoue la consigne d'il y a 50 ans. Et explique : « Ils nous ont envoyé près du lieu de l'explosion en treillis et en rangers, sans combinaison, avec juste un dosimètre photo autour du cou, rouge et noir, je m'en souviens, c'était les couleurs du Stade toulousain ». Et puis « il y a eu le bruit et la lueur, on avait 20 ans, on a sauté en poussant un cri de joie comme des gosses et le souffle nous a balayés à 5 mètres de là ». De retour au camp, ils ont été consignés sous la tente. Gardé par un planton armé. « Le lendemain, ils ont ramassé les dosimètres, sans même les identifier et on n'a passé aucune visite médicale, rien. Juste 12 jours après, on nous a dit de faire nos paquetages. » Son livret dit qu'il est rentré en bateau. Lui affirme être rentré en avion, depuis Colomb Béchar au Bourget. Et avoir de nouveau demandé des examens à Paris avant d'être libéré. En vain. Après? Il a perdu toutes ses dents. Comme des dizaines d'autres. « Pourquoi on nous a pas équipés de combinaisons ? Pourquoi on nous a gardés? », interroge-t-il aujourd'hui. Connaissant déjà la réponse… «En fait, à Reggane, j'ai servi, on a servi de cobayes humains. » Reggane « où il y avait une palmeraie, un village, des gens… on allait y boire le thé de temps en temps… ils sont devenus quoi, ces gens-là ? », interroge-t-il encore, la voix cassée.
Pierre Challier.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 4 Septembre 2014 à 08:19
Ils ont souffert, certains ne voulaient plus en parler, ne pas s'en souvenir. Pourtant, pendant deux ans, la journaliste Anne-Sophie Chilard a recueilli les témoignages de 21 habitants de Magny-les-Hameaux ayant participé à la guerre d'Algérie (1954-1962). De ces entretiens, elle a tiré un livre*. Les vingt et un témoins y livrent leur ressenti sur ce qu'on a longtemps nommé les « événements » et sur cette période sombre de leur vie.
*« Appelé d'Algérie, 50 ans pour défaire mon paquetage », Yvelinedition, 128 pages, 19 EUR. Disponible en commande sur Yvelinedition.fr ou bien à la mairie de Magny-les-Hameaux et au centre social.Parution 20 septembre 2014
Témoignages recueillis par Anne-Sophie Chilard
Depuis Napoléon III, la France s'écrit un « roman » avec l'Histoire : censures, oublis, déformations, lois et décrets... Et la période 1954-1963 est certainement celle qui cristallise tous les défauts. Ce que l'on a nommé jusqu'en 1974 « les événements d'Algérie » est une période de notre Histoire que l'on a cherché à enfouir, d'autant plus que, dès 1954, la Métropole avait tourné la page. Indochine, Maroc, Tunisie, Algérie, Madagascar, que d'obstacles à abattre pour que démarre les trente glorieuses. Les « engagés », qui ont enchaîné 39-45, l'Indochine et l'Algérie, ont apporté leurs témoignages, leurs révoltes.
Quant aux appelés du contingent, la « Nation en armes », cela a été la chape de plomb dès leur retour. La Nation, à ce moment-là, préférait déambuler sur les Champs Elysées ou découvrir Saint-Tropez plutôt que de porter les armes. Interdit de se souvenir ! De commémorer ! Un petit noyau d'appelés ont commencé à bouger. Les événements d'Algérie sont devenus Guerre d'Algérie, des monuments aux morts ont été érigés. Ce que l'on appelle aujourd'hui travail de mémoire se met en route, avant qu'il ne soit trop tard, que cette génération ne disparaisse.
En 2004, Jacques Lollioz, alors maire de Magny-les-Hameaux, et Gaëtan Pellan, Responsable des affaires culturelles, à cette époque, ont souhaité créer un monument aux morts qui permettrait de travailler, avec les enfants de la Ville, sur les notions de guerre, de paix et plus largement sur le devoir de mémoire.
Cela a été le point de départ d'un travail de mémoire sur la Guerre d'Algérie. Dans ce mouvement, ce livre permet de faire resurgir des mémoires la nostalgie et l’histoire d’une jeunesse. Une jeunesse volée à la vie de 21 Magnycois qui se souviennent…
La mémoire nécessite un travail en profondeur, en particulier avec les enfants. Ce livre, comme le lieu de mémoire de Magny-les-Hameaux, en sont des traces concrètes. Le devoir, ou « plaisir » de mémoire que nous agitons tous les ans avec les enfants des écoles de la ville de Magny-les-Hameaux, en créant un livre infini au fil des ans, inscrit cette trace dans la lumière.
Cet ouvrage constitue une étape importante dans ce travail de mémoire. D'un abord facile, il permet à chacun des 21 anciens que la journaliste Anne-Sophie Chilard a interrogé de témoigner de cette période sombre de leur vie, de dire leur ressenti. Il vous sensibilisera aux conséquences d'une guerre si mal fichue.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 4 Septembre 2014 à 07:17
Pierre Daum
http://blog.lefigaro.fr/algerie/2012/01/decouvrez-les-autres-pieds-noirs-ceux-restes-en-algerie.html
Ni valise ni Cercueil, les pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance, le livre du journaliste Pierre Daum, publié chez Actes Sud, est un ouvrage inédit. Comme le souligne Benjamin Stora dans la préface, «aucune étude approfondie n’avait jusqu’à présent été entreprise sur le sort des Européens et des Juifs restés en Algérie après 1962». S’il en fallait d’autres, voici cinq autres bonnes raisons de le lire…
Pierre Daum rappelle que les pieds-noirs
ne sont pas tous des rapatriés
"Pour mener une étude fine sur les pieds-noirs, il faut les interroger dans leur diversité. Or depuis cinquante-deux ans, un seul discours domine : celui d’un petit groupe de rapatriés qui monopolise les récits sur les pieds-noirs. Et ce discours écrasant repose sur deux idées piliers : «Nous sommes "tous" partis en 1962» et «Nous n’avions pas d’autre choix». Cette argumentation a permis à tous ces rapatriés, à la fois de se maintenir dans la position confortable de la victime innocente et d’éviter qu’on leur pose la question : «Pourquoi êtes-vous partis ?». Mon travail fait vaciller ces deux piliers. Car à la fin de 1962, ils étaient un peu plus de 200000 pieds-noirs à être restés en Algérie. Et tous les témoignages concordent : ceux qui ont choisi de rester disent qu’ils ne risquaient absolument rien, les violences s’étant subitement arrêtées à la fin de l’été 1962."
Comment obtient-on le chiffre de 200 000 pieds-noirs restés en Algérie ?
Pierre Daum par melanimes
L’auteur revient sur le massacre du 5 juillet 1962 à Oran, peu connu
"Il y a un lien entre cet événement et l’histoire générale. Si le massacre du 5 juillet 1962 à Oran est une date familière chez tous les pieds-noirs, il reste inconnu en dehors de ce milieu. Avec la fusillade de la rue d’Isly, ces deux événements sont des points forts de la construction du discours des rapatriés. Dans le cas du massacre d’Oran, ces derniers disent : «Nous ne pouvions pas rester, c’était la valise ou le cercueil ! Regardez ce qui s’est passé à Oran !» Alors qu’en réalité, les rapatriés étaient déjà revenus en masse en avril, mai et juin. La violence du 5 juillet 1962 n’était pas le fait de tous les Algériens mais d’une foule hystérique et s’explique par les six mois qui ont précédé le drame. Les Algériens d’Oran, victimes de la folie meurtrière de l’OAS, vivaient depuis des mois les pires pressions, les pires atrocités. En ce début juillet, alors qu’ils défilent pour fêter l’indépendance, des coups de feu sont tirés contre des manifestants sans que l’on sache d’où ils viennent. Pensant que c’est l’OAS, des manifestants se lancent alors dans une chasse à l’Européen, une chasse au faciès, dans laquelle plusieurs Algériens sont tués. Bilan : au moins 150 personnes, peut-être jusqu’à 400, en quelques heures."
Pour en savoir plus sur cet événement : lire le reportage "Chronique d'un massacre annoncé. Oran, 5 juillet 1962".
Il fait tomber une idée reçue : les pieds-noirs restés en Algérie ne sont pas tous des personnes âgées ou des militants de la cause algérienne…
"Les quelques travaux qui ont été faits sur les pieds-noirs restés en Algérie sont passés inaperçus et ont eu tendance à véhiculer l’idée que ces pieds-noirs s’étaient engagés aux côtés des Algériens pour l’indépendance. Mon travail m’a permis de découvrir l’extrême diversité de leurs profils. D’abord une diversité idéologique : on trouve des pieds-noirs impliqués auprès du FLN -même s’ils sont minoritaires, d’autres qui n’avaient pas une idée arrêtée sur le sujet, d’autres encore clairement en faveur d'une Algérie française, voire même des sympathisants forts de l’OAS. Il y a ensuite une diversité géographique : les pieds-noirs ne sont pas concentrés dans les grandes villes (une autre idée reçue), ils sont nombreux à être restés dans de petites villes et des villages. C’est l’intérêt de la liste des 150 personnes publiée dans le livre, pour lesquels j’ai indiqué notamment le lieu de résidence après 1962. Enfin, on relève aussi une grande diversité sociologique et professionnelle. Avant l’indépendance, les pieds-noirs n’étaient pas tous des colons ! La classe moyenne était bien représentée, il y avait aussi des pauvres. On retrouve aujourd’hui toutes ces catégories sociales.
Voir le témoignage d'un chef de gare
Il nous fait partager des récits intimes de personnes peu habituées
à se dévoiler
"Un des aspects fondamentaux de ce métier est de faire parler les gens : cela fait partie de ma façon de pratiquer le journalisme –car ce livre est une livre de journaliste et pas d’historien. J’ai procédé de la même manière pour mon premier livre sur les travailleurs Indochinois, des gens qui n’avaient jamais raconté leur histoire. Et pour cela, il faut prendre du temps ! Je porte ce projet depuis deux ans et demi, trois ans. J’avais identifié une cinquantaine de pieds-noirs restés en Algérie. Après être entré en contact avec une trentaine d’entre eux, j’en ai sélectionné une quinzaine en fonction de différents critères, l’objectif étant de donner un éventail de profils le plus complet possible. Mais il est vrai que la tendance générale chez les pieds-noirs restés en Algérie est de ne pas parler…"
Il nous fait découvrir l’Algérie algérienne
"Je voulais, à travers le récit de ces pieds-noirs restés en Algérie, faire connaître des bouts de cette Algérie algérienne, via des sujets comme le cinéma, le combat des femmes, l’agriculture... En France, les articles, les livres, les documentaires sur l’Algérie française ne manquent pas mais il n’existe rien sur ce qui s’est passé après l’indépendance. Comme si la porte de l’intérêt pour l’Algérie s’était refermée en 1962…"
Français d'Algérie : deux soeurs, une mer
Alors que des centaines de milliers de pieds-noirs ont quitté l'Algérie en 1962, Germaine, ici à Arzew en février 2012, a décidé de rester.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/francais-d-algerie-deux-soeurs-une-mer_1094027.htmlIl y a cinquante-deux ans, après les accords d'Evian, des centaines de milliers de pieds-noirs quittent l'Algérie. Parmi eux, Yvette, qui vit aujourd'hui à Palavas, dans l'Hérault. Sa cadette, Germaine, a choisi de rester à Arzew, près d'Oran. Rencontres entre deux rives.
J'espère que cela ne sera pas de sitôt, mais, quand mon heure arrivera, c'est là-haut que je veux être enterrée. Face à la mer, pour la regarder, comme au premier jour, se balancer d'une crique à l'autre. Je suis née dans ce pays, je lui ai toujours appartenu. C'est logique que ma dernière demeure soit ici". Germaine montre du doigt le vieux cimetière marin, construit en terrasses sur la Méditerranée et peuplé de sépultures chrétiennes dont certaines sont en piteux état. Il n'est qu'à quelques minutes en voiture du modeste pavillon que la vieille dame occupe depuis les premiers jours de l'indépendance algérienne, au lieu-dit de la Fontaine-des-Gazelles, non loin d'Arzew. Française d'Algérie depuis quatre générations, Germaine tient avec son fils, Pierre, sur la place centrale de cet ancien port de pêche devenu après l'indépendance la grande ville pétrolière de l'Ouest algérien, un restaurant aux nappes à carreaux rouges et blancs, la Germainerie. Elle l'a ouvert au début des années 1960, à la place du bar acheté en 1930 par ses parents.
Les Pieds-noirs
L'expression désigne les Européens et les juifs d'Algérie, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivaient en Algérie au moment de l'indépendance. Tous jouissaient en 1962 de la pleine nationalité française.
Germaine Ripoll, 87 ans, est l'une des quelque 200.000 pieds-noirs qui ont fait le choix en 1962, au moment de l'indépendance, de rester en Algérie. Cette année-là, sa soeur Yvette, de deux ans son aînée, s'est installée avec sa famille en France, où leur mère l'a rejointe peu après. Aujourd'hui, Yvette coule ses vieux jours, elle aussi, au bord de la Méditerranée, mais sur l'autre rive. Elle et son mari habitent depuis quelques années un appartement dans une petite résidence à l'entrée de Palavas-les-Flots (Hérault). Yvette confie que le port de Palavas, "avec les pêcheurs qui vendent leurs poissons sur les quais", lui rappelle celui d'Arzew - avant la raffinerie construite dans les années 1970 par la Sonatrach et l'alignement des tankers dans la rade... "Arzew, se souvient pour sa part Germaine, était ouverte sur la mer. Il n'y avait que le soleil, la plage, les criques, le phare et les pêcheurs". Les photos qu'elle conserve des années 1946-1947 la montrent en pin-up, souriant à la vie et au bleu du ciel et de l'eau. "Ma mère m'a tricoté le maillot deux-pièces que je portais. Mouillé, il était lourd. Mais il m'allait bien".
Yvette, à Palavas-les-Flots
Yvette et Germaine descendent d'une vieille famille catalane, installée en Algérie peu après la conquête du territoire par l'armée française en 1830. Leurs quatre grands-parents comme leurs parents sont nés dans cette partie du littoral oranais qui s'étend d'Arzew à Gdyel, l'ex-Saint-Cloud. Leur grand-père paternel dirigeait à El-Guessiba, à 4 kilomètres d'Arzew, une ferme qui appartenait à un colon français; converti à l'islam, il était devenu un marabout respecté. C'est là que les deux soeurs voient le jour, l'une en 1923 et l'autre en 1925. Un frère, Vincent, né en 1922, sera engagé volontaire et mourra à la guerre, à 21 ans, en 1943.
Lorsque leurs parents s'installent à Arzew, Yvette et Germaine ont 5 et 3 ans. Inscrites aux Enfants de Marie, un patronage, elles apprennent leurs premiers mots de français, avant de rejoindre l'école communale. L'une et l'autre donnent ensuite un coup de main à leurs parents, qui tiennent, outre le bar, un entrepôt de vins et liqueurs. Yvette rêve déjà d'aller en métropole. A l'époque, cependant, une jeune fille ne voyage pas seule... Au milieu des années 1940, elle fait la connaissance d'Alain Chauderlot, un fusilier marin, de trois ans son aîné, alors basé à Arzew avec son régiment. C'est en jeune mariée qu'elle découvrira peu après l'Hexagone, et d'abord les Ardennes, dont il est originaire. Mais le couple décide de rester en Algérie. Alain entre aux Affaires maritimes, devient syndic des gens de mer. Trois enfants naissent, un garçon et deux filles.
Amoureuse de la mer, excellente nageuse, Germaine réussit à se faire accepter dans un club d'aviron où, précise-t-elle, "il n'y avait que des hommes". Elle y rencontre celui qui deviendra son mari, un Français de métropole, originaire du Creusot et descendant d'une famille russe ayant fui la révolution de 1917. "Il était beau, il m'a plu et nous nous sommes mariés au cours de l'été 1950". Ensemble, ils auront un fils unique, Pierre. Né en 1956 et aujourd'hui marié à Leila, native d'Oran et originaire d'une famille berbère du Maroc, ce père de quatre enfants, deux garçons et deux filles, dirige désormais la Germainerie.
Jeunes mères de famille, les deux soeurs traversent les années de guerre sans vraiment s'en rendre compte. "A Arzew, il n'y avait pas de problèmes, affirme Yvette. Juste quelques Français de souche qui se poussaient un peu du col... Nous nous entendions bien avec les Arabes, comme avec les Juifs. Les violences, ce sont des Arabes venus de Tunisie [l'armée des frontières] qui les ont commises". A l'époque, pour les deux soeurs, l'Algérie, c'est la France. Et elle doit le rester. L'une et l'autre auront le sentiment d'avoir été trahies par le général de Gaulle.
Yvette n'est revenue qu'une fois après l'indépendance

Germaine, à son mariage en 1950.
Le 18 mars 1962, le gouvernement français et la rébellion algérienne signent les accords d'Evian, premier pas vers l'indépendance. Le texte précise que les droits et les biens des Européens d'Algérie seront respectés. Mais tout se précipite au cours de l'été: l'OAS bascule dans un combat de plus en plus désespéré. Face à cette "politique de la terre brûlée", les chefs du FLN ne parviennent pas à empêcher de sanglantes représailles. Faut-il partir? Peut-on rester? Les 6000 pieds-noirs d'Arzew, comme tous les autres, s'interrogent.
Yvette et son mari, Alain, sont inquiets. Lui qui parcourt tous les jours la route qui sépare Arzew d'Oran, voit monter l'insécurité. Des Arabes sont tués par des pieds-noirs, pêcheurs d'Arzew. Des Français sont enlevés. "Tout le monde s'en prenait à tout le monde", résume Yvette. Et puis il y a les journaux, de plus en plus alarmistes. Le couple décide de mettre les enfants, alors âgés de 12 à 16 ans, à l'abri chez leurs grands-parents, dans les Ardennes. Yvette les accompagne. Aujourd'hui encore, elle se souvient du bateau pour Marseille, bondé, des familles entassées sur le pont, des gens malades... Le retour, en avion, est plus facile. Mais la situation, sur place, est de plus en plus tendue.
Début juillet, à Oran, des coups de feu sont tirés contre des Algériens qui défilent pour fêter l'indépendance. Convaincus qu'il s'agit de l'OAS, ils se lancent dans une sanglante chasse aux Européens. Au lendemain de cette tuerie, Yvette et Alain décident de partir, pour toujours. "J'aimais ce pays. Si j'avais été seule, je serais restée. Mais il y avait les enfants. Leur sécurité et leur avenir étaient en jeu." Le couple prend place dans un petit convoi en direction de l'aéroport d'Oran, manque les deux premiers vols, pour Bordeaux et Toulouse, et finit par embarquer à bord d'une Caravelle pour Paris. Après des semaines dans les Ardennes, Alain obtient un poste à Marennes, en Charente-Maritime. Il sera ensuite muté à Fouras, près de La Rochelle. "J'ai souffert de l'humidité et du froid", confie Yvette, heureuse d'avoir, quelque trente ans plus tard, retrouvé sa chère Méditerranée. Aujourd'hui, ses trois enfants ont fait leur vie, en France. Et elle est une grand-mère comblée.
Germaine n'a toujours "ni compris ni digéré"
l'exode massif des pieds-noirs
La Grande Bleue, Germaine ne l'a jamais quittée. Lorsque survient l'indépendance, elle est sur le point de divorcer et décide d'envoyer son fils, pour un temps, chez son père, qui a trouvé refuge à Toulon. Elle restera. "Bien sûr, il y avait l'OAS, les représailles et les morts... Mais ça se passait à Oran, qui nous semblait à des milliers de kilomètres. A Arzew, la vie était plutôt tranquille. Quand l'indépendance a été proclamée, des Arabes sont descendus de leurs quartiers vers le centre-ville européen, mais ils n'ont rien fait. Ils avaient presque peur d'y mettre les pieds, et ne voulaient pas que les Européens partent et abandonnent leur pays! Certains se sont dirigés vers mon restaurant. Je suis sortie sur le trottoir. Nous nous sommes regardés, puis embrassés. Je me souviendrai toujours de cet instant". Un demi-siècle plus tard, Germaine avoue qu'elle n'a toujours "ni compris ni digéré" l'exode massif des pieds-noirs.
Accords d'Evian
Signés le 18 mars 1962, les accords d'Evian aboutissent à la proclamation d'un cessez-le-feu dès le lendemain sur tout le territoire algérien. Ils prévoient l'organisation d'un référendum d'autodétermination permettant aux Algériens de choisir l'indépendance.
Après son départ, Yvette n'est revenue qu'une seule fois en Algérie, trois ans après l'indépendance: la jeune femme est retournée à Arzew pour récupérer un chien de chasse que son mari avait dû laisser en 1962. L'ancien facteur, devenu maire d'Arzew, lui a offert un poste d'institutrice. Elle a poliment décliné.
Germaine, elle, a envisagé un temps de partir, à la fin des années 1960. Sa soeur lui avait trouvé un bar non loin de Fouras. Elle a fait le voyage et a même versé des arrhes. Mais elle a rapidement compris qu'elle ne se ferait pas à cette nouvelle vie et a repris le chemin d'Arzew. En 1993, pendant les années de sang, elle a reçu une lettre de menaces, la sommant de quitter l'Algérie. Les services consulaires français lui ont alors conseillé de faire ses bagages. Elle a refusé. "Je ne pouvais pas abandonner mon pays. Ni cette mer que je regarde chaque matin".
Ceux qui sont restés
Le témoignage de Germaine Ripoll figure en bonne place dans un ouvrage publié en 2012 par le journaliste Pierre Daum. Son livre est le premier entièrement consacré aux pieds-noirs qui ont choisi, en 1962, de ne pas gagner la France et de tenter le pari de l'indépendance. Au total, quelque 200.000 Européens et juifs sont restés après l'été 1962, soit pour y finir leurs jours, soit pour finalement quitter le pays, peu à peu, au cours des décennies suivantes. Leurs motivations, comme leurs opinions, étaient diverses. Une réalité trop passée sous silence. Aujourd'hui encore, quelques centaines de pieds-noirs vivent en Algérie. La plupart ont conservé leur nationalité française. Pour le journaliste, 15 d'entre eux ont accepté de témoigner. Leur histoire permet de découvrir un aspect méconnu du passé colonial de la France.
Ni valise ni cercueil. les pieds-noirs restés en Algérie après l'indépendance, par Pierre Daum.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 1 Septembre 2014 à 08:17
Que me chantez-vous là ?
Cela fait plus de trente-neuf ans que Boris Vian est mort, et sa chanson « Le déserteur » demeure vivante. Traduit en plus de quarante-trois langues, cet hymne pacifiste, s'il appelle à la désertion, invite surtout à la paix et à la non-guerre.
« Monsieur le Président/ Je vous fais une lettre/ Que vous lirez peut-être/ Si vous avez le temps/ Je viens de recevoir/ Mes papiers militaires/ Pour partir à la guerre/ Avant mercredi soir/ Monsieur le Président/ Je ne veux pas la faire/ Je ne suis pas sur terre/ Pour tuer des pauvres gens. »
Il s'agit donc d'une lettre adressée à « Monsieur le Président » par un homme ayant reçu un ordre de mobilisation en raison d'un conflit armé. L'homme y explique qu'il ne souhaite pas partir à la guerre et qu'il préfère déserter.
Nous sommes en 1954. La contre-offensive française face aux troupes du général Võ Nguyên Giáp avait conduit à la défaite française de Diên Biên Phu où 1 500 soldats avaient été tués. Boris Vian écrit alors cette chanson alors que la guerre d'Indochine n'était pas finie et que celle d'Algérie allait commencer. Des paroles qui vont choquer la société française. De tous ceux que Vian sollicite, seul Mouloudji, acceptera de l'interpréter, et il l'enregistrera le 14 mai 1954. Mais ce dernier propose une version adoucie de la chanson originale. Au lieu de cette phrase « Si vous me condamnez/ Prévenez vos gendarmes/ Que j'emporte des armes/ Et que je sais tirer », Mouloudji suggérera de remplacer les deux derniers vers par : « Que je n'aurai pas d'armes/ Et qu'ils pourront tirer ». Il demande son avis à Vian qui répond : « Tu fais comme tu veux Mouloud, c'est toi qui chantes. » Malgré cela, l'air est immédiatement censuré sur les ondes, et le disque, un 45 tour sorti en avril 1955 en pleine guerre d'Algérie, sera, quelque temps plus tard, retiré du commerce pendant de longues années. L'interdiction ne sera levée qu'en 1962. Mais la censure n'empêche pas Mouloudji de continuer à la chanter. Plus tard, il reviendra sur la polémique entourant la chanson : « En 1954, beaucoup de journalistes m'ont reproché d'avoir édulcoré Le déserteur. Mais ils n'avaient qu'à venir au moment où je l'ai créée : ils auraient vu que je m'appelais Mouloudji, que j'avais un nom arabe et que j'ai créé cette chanson le jour de la prise de Diên Biên Phu ! »
Depuis, la chanson a été très largement traduite (en 45 langues) et reprise par de nombreux interprètes comme Richard Anthony, Marc Lavoine, Juliette Gréco, Serge Reggiani, Johnny Hallyday, mais aussi Joan Baez ou Peter, Paul et Mary qui la chanteront durant la guerre du Vietnam. Le texte a également été détourné en 2012, en accord avec les héritiers de Boris Vian, et des militants antinucléaires chantaient : « Monsieur le Président/ Je ne peux plus me taire/ L'énergie nucléaire/ Peut tuer nos enfants. »
En 1967, Jean Ferrat, critique ceux qui ont pris le train en marche de la mode pacifiste :
«Il paraît que Le déserteur/Est un des grands succès de l'heure/Quand c'est chanté par Anthony», dira-t-il dans Pauvre Boris.
Aujourd'hui, Le déserteur demeure cet hymne antimilitariste entonné par tous ceux qui n'aiment pas la guerre.
Mais Dieu ! Qu'ils ont devenus rares !SOURCE : http://www.lorientlejour.com/article/883670/y-a-t-il-encore-un-deserteur-sur-cette-terre-.html
Printemps des poètes : LE DESERTEUR par Waitv votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 27 Août 2014 à 09:11
Madeleine Riffaud
Considérée comme une des plus jeunes résistantes pendant la seconde Guerre Mondiale, Madeleine Riffaud est connue pour avoir abattu un officier nazi en plein Paris. Arrêtée, torturée puis condamnée à mort, elle est miraculeusement sauvée par un échange d'otages au début de l'insurrection parisienne.
Marquée à jamais par cette période à la fois intense et dramatique de sa vie, Madeleine Riffaud devient correspondante de guerre et grand reporter ! Ses engagements la mènent en Europe, en Asie et en Afrique où elle couvre différentes guerres jusqu'en 1973.
Résistante, militante anticolonialiste, puis journaliste, repoussant toujours plus loin les limites de l’investigation, Madeleine Riffaud a fêté ses 90 ans, ce 23 août 2014. L’occasion de revenir sur un parcours exceptionnel.
Ce 23 août 2014, Madeleine Riffaud – mais elle est, elle reste, pour des milliers de ses amis, Madeleine, tout simplement – a 90 ans. La connaissant, nous savons déjà que nous allons subir ses foudres, pour ne pas dire plus, de rappeler ce simple fait. « Je n‘ai jamais fêté mes anniversaires, ce n’est pas maintenant que je vais commencer ! » Et pourtant, Madeleine doit l’accepter : son destin appartient un peu à la grande communauté de ses amis, de ses camarades. Et nous avons bien le droit, nous, de saisir chaque occasion pour lui dire combien nous l’aimons, nous l’admirons. Un jeune cinéaste franco-vietnamien, Philippe Rostan, avait réalisé, il y a quelques années, un film remarqué, les Trois Guerres de Madeleine Riffaud (Résistance, Algérie, Vietnam). Nous pourrions ajouter : … et tout le reste, alors ? Elle a 18 ans lorsqu’elle établit le contact avec la Résistance à la faculté de médecine de Paris. Elle y adopte le nom de guerre de Rainer (clin d’œil internationaliste au grand poète allemand Rainer Maria Rilke). Et son courage amène ses camarades de lutte à lui confier des missions de plus en plus périlleuses. En 1944, alors que la Wehrmacht est partout en recul, la Résistance décide de franchir un cran dans la lutte armée dans la capitale, avant l’arrivée des troupes alliées. « Nous voulions que Paris se libère elle-même », rappelle-t-elle (Madeleine Riffaud toujours en Résistance, film de Jorge Amat). Elle est volontaire pour une mission périlleuse : abattre un officier allemand. Elle passe à l’acte sur le pont de Solferino. « Neuf balles dans mon chargeur / Pour venger tous mes frères / Ça fait mal de tuer / C’est la première fois / Sept balles dans mon chargeur / C’était si simple / L’homme qui tirait l’autre nuit / C’était moi. » Arrêtée par un milicien, livrée à la Gestapo, torturée, condamnée à mort, elle échappe in extremis au peloton d’exécution grâce à un échange de prisonniers. Cela se passe le 19 août, au moment précis où commence l’ultime combat pour la libération de Paris. Madeleine, rejoint son groupe, Saint-Just (quel plus beau nom trouver ?), commandé par le capitaine Fénestrelle, dont elle prend le commandement d'un détachement et sera élevée au grade de lieutenant FFI. Le 23 août, ce groupe prend d’assaut et bloque un train blindé allemand au tunnel des Buttes-Chaumont. 23 août 1944 ? Le jour de ses 20 ans. Mais pour elle, pas de trêve : le 25, elle est, toujours à la tête de sa compagnie, à l’assaut du tout dernier bastion allemand, la caserne de la place de la République. C’est ce jour-là que de Gaulle prononce sa célèbre phrase : « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré !... » Libéré par son peuple, oui. Mais à ce moment, Michel Tagrine, jeune héros FTP de 22 ans, compagnon d’armes de Madeleine, vient d’être fauché, l’un des derniers martyrs de la Libération. Ce soir-là, raconte Madeleine, alors que tout Paris riait, nous, ses compagnons d’armes, pleurions comme des gosses… Cette première expérience exceptionnelle, cette Résistance d’une très jeune femme, sera plus tard contée par elle sous le titre « On l’appelait Rainer ».
« Ta place est en France, pour y éclairer ton peuple, pour y participer aux luttes »
C’est ensuite, après la Libération, une nouvelle vie, le tourbillon un peu fou de la victoire, d’un début de célébrité. « Je suis tombée dans la légalité comme on plonge les fesses dans un seau d’eau froide », dit-elle (film Jorge Amat). Elle rencontre les dirigeants du PCF, fait la connaissance d’Éluard, de Picasso (qui fera plus tard son portrait), d’Aragon, de Vercors, à qui elle voue depuis une grande admiration. Elle devient l’épouse de Pierre Daix, un autre héros de la Résistance, dont elle se séparera dès 1947. Madeleine dit : « À cette époque, je ne savais que manipuler les armes. » Trop de modestie ! Il n’y a pas que cela : elle écrit. Des poèmes. Et magnifiquement. Son premier ouvrage, le Poing fermé, est préfacé par Paul Éluard. Simultanément, elle choisit la carrière journalistique. Elle entre à Ce soir, alors l’un des grands quotidiens progressistes français, dirigé par Aragon. Elle y croise une grande, grande dame, qui sera d’une influence déterminante sur le cours de sa vie : Andrée Viollis, naguère auteure de SOS Indochine (1935). Andrée Viollis lui présente alors Hô Chi Minh, en visite officielle en France pour tenter d’éviter le déclenchement de la guerre d’Indochine – ce qu’il ne parviendra pas à faire. Madeleine a gardé un souvenir ému de cette première rencontre (il y en eut tant d’autres !). L’oncle Hô lui dit : « Ma fille, le journalisme est un métier. Apprends, apprends, puis ensuite viens me voir dans mon pays. » Ce qu’elle fit dix ans plus tard. Entre-temps, de Ce soir, elle est passée à la Vie ouvrière, où elle participe, par la plume, aux campagnes de la CGT (appel de Stockholm, luttes contre la guerre d’Indochine, notamment lors de l’affaire Henri Martin). Elle trouve pourtant, toujours, le temps de poursuivre une carrière littéraire (le Courage d’aimer, recueil de poésies, les Baguettes de jade, récit romancé des rencontres faites avec la délégation vietnamienne, notamment du poète Nguyen Dinh Thi, lors du festival de Berlin, en 1951). La guerre « française » d’Indochine, justement, s’achève. Madeleine avait été de ceux qui, depuis le début, avaient soutenu l’indépendance du Vietnam, avaient prédit les impasses tragiques de la politique française. Diên Biên Phu leur donna raison. Madeleine est volontaire pour partir, toujours pour la VO, couvrir les tout premiers temps de l’existence du nouvel État indépendant vietnamien, installé à Hanoi. Mais aussi, pourquoi le masquer, pour retrouver Nguyen Dinh Thi. Elle passera là, sans doute, les plus belles années de sa vie, au milieu de ce peuple qui alors commence la reconstruction, croyant éviter une seconde guerre, contre les États-Unis cette fois. Sa proximité avec Hô Chi Minh est une chose connue de tous. Pour beaucoup, Madeleine est un peu « la fille française de l’oncle ». Épisode heureux, épisode trop court. « Ta place est en France, pour y éclairer ton peuple, pour y participer aux luttes », lui dit alors Hô. Grandeurs et douleurs de l’engagement…
Elle échappe miraculeusement à un attentat de l’OAS mais est gravement blessée
Nous sommes alors en 1956. Depuis deux ans, une nouvelle épreuve vient de commencer. L’aveuglement colonialiste, qui n’a aucune limite, amène les dirigeants français à engager le pays dans une nouvelle guerre, en Algérie. C’est pour l’Humanité, cette fois, que Madeleine va reprendre le combat. Elle intègre l’équipe prestigieuse de la rubrique internationale, dirigée par Pierre Courtade, où elle se fera des amitiés définitives, les si regrettés Yves Moreau, Robert Lambotte, Jean-Émile Vidal, François Lescure… Madeleine va partager tous les combats de ce journal. De Paris, elle écrit des pages émouvantes (qui a pu oublier son « Adieu aux martyrs de Charonne » ? ses polémiques, elle, l’ancienne résistante, avec l’ex-collabo Papon devenu préfet de police ?). Mais ce diable de femme n’aime que le terrain. Avec l’accord de son journal, elle part, clandestinement, en Algérie, avec les dangers encourus que l’on imagine, en cette période où les « ultras » de l’Algérie française haïssent les journalistes de métropole et tout ce qui ressemble à la gauche. Alors, une journaliste communiste… Elle échappe d’ailleurs miraculeusement à un attentat de l’OAS mais est gravement blessée. La guerre d’Algérie se terminant comme la précédente, en Indochine, par l’accès à l’indépendance du peuple colonisé, Madeleine est de retour à Paris. Pas pour longtemps. Le cycle infernal des guerres menées par l’Occident contre la liberté des peuples ne cessant pas, c’est de nouveau sur le Vietnam que l’actualité braque ses projecteurs. Là, les États-Unis, prenant le relais de la France coloniale – c’est l’époque où le monde ne voit que le beau sourire de Kennedy, oubliant un peu vite l’impérialisme américain –, ont décidé d’ériger une barrière « contre le communisme », en fait d’interdire au peuple vietnamien de s’unir et de choisir son destin. Madeleine, qui a évidemment gardé le Vietnam au cœur, y repart, toujours pour l’Humanité. Ce journal aura alors sur place un tandem d’exception : Charles Fourniau, historien devenu un temps journaliste, pour les analyses de fond, les éclairages indispensables ; Madeleine Riffaud, pour le vécu, la sensibilité. Madeleine l’intrépide est sur le terrain, parmi ses sœurs et ses frères vietnamiens, au sud, Dans les maquis viêt-cong (titre d’un ouvrage paru en 1965 reprenant ses reportages) ou Au Nord-Vietnam : écrit sous les bombes (autre ouvrage, 1967). Ses reportages d’ailleurs dépassent largement le lectorat habituel de l’Huma. Ses textes sont traduits dans plusieurs langues, les micros se tendent vers elle à chaque nouvelle étape de la lutte du peuple vietnamien. Enfin, Madeleine ne sait pas seulement écrire : elle parle. Tous ceux (une génération entière !) qui sont venus l’écouter à la Mutualité raconter, toujours avec des détails choisis, significatifs, teintés souvent d’humour, le quotidien de la résistance du Vietnam, n’ont pu oublier la sensation de cette femme, apparemment frêle, à l’héroïsme (elle n’aime pas, mais pas du tout, le mot) tranquille, parlant simplement des dangers encourus.
« Trois guerres de Madeleine Riffaud », « trois victoires partagées »
Cette phase américaine de la guerre du Vietnam s’achève en 1975. Madeleine, à sa place, celle d’une journaliste-écrivain-témoin d’exception, y a contribué. Les « trois guerres de Madeleine Riffaud » s’achèvent. On pourrait plus précisément dire les « trois victoires partagées »… Madeleine continue ensuite ses combats humanistes de mille manières. L’une d’entre elles est de se couler incognito, durant plusieurs mois, dans la peau d’une aide-soignante, de connaître là encore de l’intérieur le travail, les luttes, les espoirs et parfois les désespoirs du personnel hospitalier. Au terme de cette expérience naîtra un livre choc, lu encore aujourd’hui, sur la vie quotidienne de ces autres héroïnes, les Linges de la nuit. Même si les années ont passé, elle est encore et toujours active. L’un des derniers témoins de la Libération de Paris, elle est très sollicitée, en ce 70e anniversaire de ce grand événement. Et le Vietnam, toujours, la taraude… On l’a vue, il y a quelque temps, sur le parvis des Droits-de-l’Homme, aux côtés d’Henri Martin, dénoncer les effets terribles de l’agent orange, aujourd’hui encore, sur les enfants de ce pays. Elle était présente, parlant debout, droite, une heure durant, lors de la soirée d’hommages qui fut rendue récemment au Centre culturel vietnamien, à elle-même, à Raymonde Dien, elle aussi présente, et à Henri Martin. Alors, oui, nous savons que nous allons nous faire houspiller. Mais nous prenons le risque de dire, avec tant d’autres : « Bon anniversaire, Madeleine. »
SOURCE : http://www.humanite.fr/tous-les-combats-de-madeleine-riffaud-549826
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 26 Août 2014 à 09:15

http://www.henri-pouillot.fr/spip.php?article15&lang=fr
C’est le premier témoignage que j’ai rendu public sur la Guerre d’Algérie, et mon séjour au sein de la Villa Susini, témoignage qui fut donc très remarqué
Voici le premier texte rendu public le 12 janvier 2001
Transmis à l’Humanité et au Monde, Charles Silvestre et Florence Baugé, en publieront chacun de larges extraits.
A partir de la publication de ce témoignage, ce furent de nombreux contacts, des demandes de compléments de témoignages.
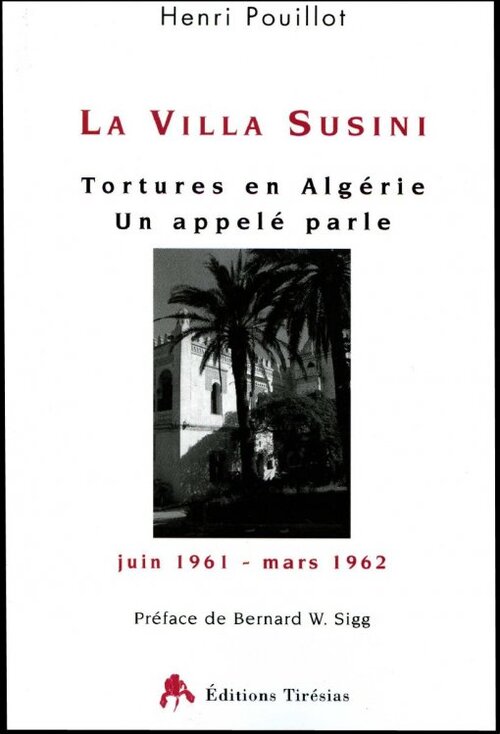
Pour le respect de la Vérité Historique - La Torture en Algérie : Une horreur, une honte pour la France
Jeune, comme la majorité de l’époque, je n’avais pas envie de "faire" cette guerre d’Algérie. Mon père ayant "fait" celle de 14/18, gravement blessé, gazé, il en avait gardé de lourdes séquelles. Gamin à la fin de la guerre 39/45, j’avais conservé les souvenirs des bombardements des ponts de la Loire avec ses bombes qui tombaient plus nombreuses à quelques kilomètres de l’objectif que sur le point prévu avec son lot de maisons détruites et même de morts civils. J’avais également été marqué par le comportement des soldats allemands "occupants" lorsqu’ils passaient "réquisitionner" les pommes de terre, les fruits… J’avais été traumatisé en apprenant qu’un ami de la famille, fut exécuté comme otage en représailles contre des actes de la Résistance. Et puis les récits de personnes qui sont revenus par miracle des camps de la mort, commentant les tortures qu’elles avaient subies, m’avaient "vacciné" pour penser qu’il n’était pas admissible que cela puisse se reproduire.
Alors, probablement à partir de cette expérience, simplement à partir de mon cœur, sans appartenance ni engagement politiques, j’ai participé à des manifestations pour dire non à la guerre d’Algérie, je me suis fait arrêter plusieurs fois : j’ai été fiché comme "subversif". Comme beaucoup de jeunes j’ai tenté de prolonger mon sursis d’incorporation pour ne pas y aller. Malgré tout, j’ai fait presque 27 mois, dont une dizaine à Alger, juste à la fin de cette guerre.
Ce que je rends public aujourd’hui, par ce texte, je ne l’avais encore jamais dévoilé, même pas à mes plus proches : frères, sœurs, femme, enfants, amis. J’avais seulement évoqué, que j’avais vu des actes de torture, que mon séjour en Algérie avait été très dur, mais j’avais toujours fui les questions à ce sujet. C’est un miracle que j’en sois revenu, mais au fond de moi, j’avais une très profonde honte de ce qui s’était passé. Souvent j’ai repensé à cette période et tenté d’analyser comment des actes aussi odieux pouvaient se dérouler.
Ce qui est surprenant, c’est que mon "passé" de "subversif" (terme employé par l’officier me justifiant que je ne pouvais pas prétendre concourir aux E.O.R. après mon action contre la guerre) ne m’a pas suivi en Algérie, et je me suis retrouvé affecté bizarrement dans le service d’officier de renseignement du 184ème bataillon du Train à la Villa SUSINI d’Alger. Ce service était chargé de "collecter" toutes les informations possibles sur les activités du FLN en particulier à ALGER.
Mon "baptême", si j’ose dire, c’est le surlendemain de mon arrivée : un appelé à 4 jours de la quille se fait tuer à Belcourt parce qu’il avait, seul, demandé dans la rue ses papiers à un algérien qu’il ne connaissait pas comme habitant le quartier. Cela à provoqué des représailles : les militaires de ce régiment sont partis, en commando "venger" le copain. Le bilan effectué au retour de cette "opération" punitive par les différents groupes y ayant participé était de plus de plus de 400 personnes exécutées. Cela avait duré presque tout l’après-midi : tous les hommes trouvés dans les logements (c’est-à-dire de 14 à 80 ans) étaient abattus devant les femmes et les jeunes enfants. Nous écoutions bien évidemment EUROPE 1 (à l’époque c’était la radio "branchée" pour les jeunes que nous étions) et c’était un des liens essentiels pour savoir ce qui se passait en métropole. Au bulletin d’information du soir, le journaliste a évoqué ce fait, en gros de la façon suivante : un jeune appelé ayant été tué une opération de bouclage a eu lieu, de nombreux tirs ont été entendus tout au long de l’après-midi et 4 algériens ont été tués en tentant de fuir.
La semaine suivante, un dimanche, j’ai une permission pour aller dans une famille algéroise. Il était environ 10h, j’y allais pour déjeuner. Il n’était pas question de rester en uniforme, seul, pour traverser le quartier de BELCOURT même avec un pistolet à la ceinture. Comme chaque militaire dans ce cas, dans les premières toilettes je me change en civil (cette pratique bien que non autorisée théoriquement était tacitement très vivement conseillée), mais j’avais été repéré, je me suis trouvé avec une arme sur la tempe, j’ai entendu le clic : la balle n’est pas partie, mon geste de défense a fait fuir ce jeune combattant FLN. Je suis rentré dans le café européen tout à côté, je suis resté sans doute plus d’une heure assis tremblant, hagard, incapable de sortir un mot. J’ai enfin pu prévenir par téléphone ces amis que j’étais bloqué au dernier moment et que je ne pouvais pas venir. Mais j’étais conscient de l’état où j’étais, et que si je rentrais au cantonnement, je ne pourrais pas cacher ce traumatisme et que cela allait très certainement déclencher de nouveau une expédition punitive, dès que j’aurais expliqué les raisons de mon état. Moralement, pour moi, il n’était pas concevable que plusieurs centaines d’innocents soient encore exécutés de cette façon, même si j’avais échappé de très peu, et par miracle, à la mort. Je suis donc resté une bonne partie de l’après-midi dans ce café, dans une sorte d’état second. Quand je suis enfin rentré, j’étais encore totalement impuissant à camoufler mon état, j’ai dû reconnaître ce qui s’était passé, j’ai failli de plus, être lynché, parce que certains sont allés jusqu’à considérer que mon attitude était une allégeance au FLN, parce que la seule réponse à un tel acte était l’expédition "corrective". Sans l’intervention d’un officier supérieur que j’ai pu obtenir assez vite, par chance, je ne sais pas ce qui se serait passé.
Si je cite ces 2 faits, c’est bien pour tenter d’expliquer le climat vécu par le contingent à ALGER à ce moment là (fin juin, début juillet 1961).
Par rapport à la torture proprement dite, je pourrais rapporter des dizaines, des centaines même de faits auxquels j’ai assisté comme témoin "privilégié". C’est vrai que mon affectation à ce service d’officier de renseignement m’avait tout spécialement placé à la pointe de ces pratiques. J’étais basé à la Villa SUSINI, "célèbre" par ses exactions. A la période où j’y étais, les cuves d’acide où les corps se dissolvaient tout seuls avaient disparues, cela ne restait qu’une "plaisanterie" souvent reprise comme un peu de nostalgie.
Fort d’être considéré comme l’intellectuel (baccalauréat en poche) du groupe (une vingtaine) j’ai obtenu assez facilement d’être plutôt affecté de préférence à des tâches de secrétariat, téléphone, chauffeur, pouvant ainsi éviter de participer directement à ces pratiques ignobles. "Notre" vocation était de "collecter" tous les renseignements possibles sur les activités du FLN à Alger, et de fait par tous les moyens.
Dès qu’il y avait un attentat nous étions appelés, et les témoins étaient embarqués à la Villa pour être questionnés. Toute personne présente sur les lieux était, a priori, suspecte de sympathie à l’égard du FLN. A partir de là une "arrestation" était "logique" et devait permettre de glaner des informations. La remise en liberté était envisagée quelques heures plus tard ou après quelques jours quelque fois plus d’une semaine sans aucune formalité administrative : la seule systématique était le fichage. Les interrogatoires dans un bureau, c’était le début. Ils étaient généralement "musclés" : les ecchymoses, voire les mâchoires ou membres cassés, étaient classiques. Pour frapper, il y avait parfois le poing mais plus souvent le gros ceinturon de cuir ou la crosse du pistolet. Très rarement ces personnes arrêtées livraient des informations. Si elles n’avaient jamais été raflées auparavant, ne figuraient pas sur les fiches, n’étaient pas homonymes ou membres présumés de la famille de terroristes recherchés, elles étaient relâchées assez vite.
Dès qu’une personne était suspectée d’être membre du FLN ou d’avoir aidé un partisan, son cas devenait bien plus sérieux et la tournure des interrogatoires pouvait durer des semaines. Le sous-sol de la Villa comprenait une très grande salle une ou 2 plus petites et de multiples pièces (du type des caves des HLM, un tout petit 2m sur 2 m) qui servaient de cellule pour une à six personnes. Il n’y avait pas de point d’eau, évidemment pas de WC, juste une couverture par personne, jamais lavée, comme seul mobilier pour dormir à même le sol. Ces détenus n’avaient que la possibilité de faire leurs excréments dans ces cellules, il était très rare qu’ils soient autorisés à utiliser les toilettes. Il leur fallait ensuite ramasser, souvent avec leur main les excréments pour les porter dans les W-C. Un coup de jet d’eau terminait le ménage. Autant dire que, avec la chaleur de l’été à Alger, (même un peu modérée par le sous-sol) les odeurs étaient souvent insoutenables. Il n’était pas question que ces détenus puissent se débarbouiller, se raser, … leur seule toilette était la mise à nu et le jet d’eau. Comme nourriture, rarement plus d’un quart de baguette par jour, pour ceux qui étaient là depuis quelque temps, parfois un peu de semoule, un peu d’eau de temps en temps.
Il y avait généralement moins de femmes retenues, mais leur traitement était identique à ce sujet, et très souvent elles étaient dans des cellules avec des hommes. La question des menstruations n’était surtout pas prise en compte. La culture musulmane, et la promiscuité avec les hommes détenus, et les sévices subis font que ces femmes ont du être traumatisées à un degré difficilement admissible.
Théoriquement, les détenus dans cette villa ne l’étaient que pour un court moment : une sorte de garde à vue sans avoir besoin de la moindre justification, avec une durée très souple entièrement laissée à l’appréciation de l’officier commandant le service. Celui qui avait été pris dans ce filet pouvait être purement relâché si vraiment aucun soupçon ne pouvait être retenu ou envoyé à Maison Carrée s’il y avait un infime doute pour être incarcéré afin de poursuivre l’instruction sur son "rôle" dans l’activité FLN.
Les interrogatoires qui se passaient dans cette grande salle du sous-sol de la Villa étaient généralement horribles. Il y avait 2 ou 3 tables, l’une pour celui qui conduisait les interrogatoires afin de pouvoir consigner quelques notes, quelques chaises. Généralement le détenu devait se mettre nu. L’état major ayant expliqué que de cette façon, celui qui était interrogé ne pouvait que se sentir inférieur et plus facilement contraint à parler. Le traitement était identique pour les femmes. La plupart des interrogatoires qui se passaient en sous-sol étaient fait sur la table souvent trop courte pour que la personne soit complètement allongée, souvent attachée aux pieds de la table par les membres. Et là l’horreur pouvait durer des heures, reprendre chaque jour que durait la détention. Entre les coups en tout genre (poing, bâton, pistolet, ceinturon,..) sur toutes les parties du corps, les cheveux arrachés, le jet d’eau, les viols par bâtons, pistolets dans l’anus.. les séances de l’électricité "gégènes" bricolées, où le 110 volts (à l’époque le 220 n’était disponible en domestique) manipulé avec les 2 fils touchant 2 parties du corps, ou un fil fixé à la table métallique et l’autre se "promenant" sur tout le corps. Le raffinement pouvait aller très loin. Les parties sexuelles étaient très souvent des cibles privilégiées comme les seins des femmes. Les blessures avec les lames de couteaux étaient aussi très nombreuses. Par contre les consignes étaient rappelées de temps en temps : pas de problèmes à l’intérieur de la Villa (il n’y avait pratiquement pas d’interdictions), mais dès qu’un algérien passait la porte vers l’extérieur, il ne devait pas porter de marques trop suspectes afin qu’il n’y ait pas de risque de réaction de la commission de la Croix Rouge ou d’avocats qui tentent de "faire du bruit" pour rien.
Très rares sont les femmes qui en plus n’ont pas été violées par des soldats. Les plus âgées y échappaient parfois, par contre les plus jeunes et surtout si elles avaient un joli corps, mariées ou non devaient subir l’outrage. De nombreuses n’ont été arrêtées que pour assouvir les "besoins" sexuels de quelques-uns. Il arrivait alors que ces femmes passent la journée dans la cave et quelques nuits dans des chambrées avec peut-être une trentaine de rapports dans cette période et ce pendant plusieurs jours puis soient relâchées simplement. Quand on connaît la culture musulmane avec ses lois de rigueur : nécessité de la jeune fille d’être vierge pour pouvoir être mariée, la possibilité d’être répudiée si elle a été "touchée" par un autre homme que son mari.. alors ces victimes l’étaient encore plus que si de tels actes s’étaient produits en Métropole à l’encontre de femmes de culture judéo-chrétienne. En effet, en plus du traumatisme terrible du viol, elles devenaient des proscrites dans leur société, obligatoirement rejetées, dans l’impossibilité de pouvoir trouver une aide, un réconfort moral, de créer un foyer ou de reprendre la vie de couple précédent. Et le témoignage (dans le journal Le Monde) de ce fils "né Français par le crime", à la suite d’un viol collectif de sa mère par des soldats français n’est pas surprenant : sa mère survit depuis, dans un cagibi qu’elle s’est fabriqué avec une bâche et de la tôle, à demi enfoui sous terre entre 2 tombes dans un cimetière.
Il y a eu de temps en temps quelques algériens d’origine européenne qui ont été arrêtés : les interrogatoires pouvaient être très musclés, mais l’officier était toujours présent, mais je ne me souviens pas de séances de torture. Ils n’étaient pas enfermés non plus dans la cave, et étaient généralement très rapidement déférés à la prison/caserne de Maison Carrée.
La corvée de bois existait aussi à Alger. L’expression était reprise même si l’exécution sommaire sans procès était pratiquée également un peu différemment : généralement le rapport concluait que lors d’une d’un déplacement en vue de reconstitution du déroulement d’un attentat le présumé auteur avait tenté de s’évader en sautant du véhicule qui le transportait vers les lieux de reconnaissance et qu’il n’avait pas répondu aux sommations. Pendant les 9 mois passés dans ce service, j’ai du rédiger une quinzaine de ces rapports, mais il y a sûrement eu des accidents de ce genre qui n’ont pas eu de conclusion officielle. Je me souviens d’une fois où 2 jeunes hommes sont venus demander des explications : ils voulaient savoir comment il se faisait qu’officiellement leur frère était mort en voulant s’évader et que le corps qu’on leur avait rendu était mennoté et les chevilles liées. Leur curiosité leur a coûté une bonne semaine d’enfermement et de traitements "classiques" de la Villa pour leur apprendre à ne pas oser avoir des pensées subversives et leur faire comprendre qu’ils étaient désormais repérés comme des suspects de premier plan, certainement des meneurs FLN, à qui il pourrait arriver la même chose qu’à leur frère, s’ils étaient rencontrés dans des circonstances douteuses.
Le Service de cette Villa SUSINI gérait également le fort de Diar el Mahçoul tout proche. Cet endroit permettait en particulier de stocker les rafles importantes (150 / 200 parfois) qui étaient faites, par exemple quand des sifflets ou you-you accueillaient des soldats en patrouilles dans le secteur, près des marchés. Cela permettait un premier filtre : la Villa ne pouvait, même en tassant bien, "héberger" qu’une petite centaine de personnes. A ce sujet, je ne peux que rapporter un témoignage que je n’ai pu contrôler personnellement à l’époque. A la suite d’une de ces types de rafles une cinquantaine de personnes ont été descendues dans une sorte de salle en sous-sol dont le seul accès était une échelle mobile. Cette salle devait faire environ 50 m2 à 4/5 m de profondeur, avec juste une ouverture ronde de 1,5m de diamètre : la seule lumière et pas d’eau, pas de W-C. Pendant la semaine passée où tout le monde est resté au fond, hommes et femmes ensemble avec les excréments, la seule nourriture a été quelques quignons de pain. Un seau d’eau était descendu de temps en temps pouvant servir pour la toilette et boire. Quand il y avait trop de cris c’était un coup de jeu d’eau. Tout le monde a été relâché (mais fiché) parce qu’il a eu plusieurs malaises assez sérieux et la peur de décès qui se seraient peut-être su.
Il faut aussi parler des enquêtes à domicile. La majeure partie des arrestations, perquisitions se faisaient de nuit, pendant le couvre feu. La visite étant effectuée, à priori au domicile de suspects FLN, il était "possible" de tout faire. Tout le logement était complètement "fouillé" c’est à dire totalement mis sans dessus dessous. Il était "autorisé" (au moins tacitement) de prendre ce qui plaisait : objets de cuivre, beaux tapis, bijoux… L’argent liquide était généralement considéré comme le résultat de collectes du FLN, d’où confisqué et preuve complémentaire d’allégeance au FLN. Tout le monde homme, femme, enfant était fouillé et généralement en faisant mettre tout le monde nu. La plupart du temps les hommes étaient embarqués. Il n’était pas rare que une femme ou jeune fille soit violée à cette occasion, et devant tout le reste de la famille.
Comme le dit l’éditorial de l’Ancien d’Algérie, la torture n’était pas l’apanage de toutes les unités opérationnelles en Algérie, mais très répandue, et un certain nombre avaient par contre la triste vocation d’être spécialisées dans cette besogne. Il est vrai que, principalement dans les montagnes, hors d’Alger, des grandes villes, des militaires pris lors d’embuscades étaient également victimes de faits similaires. Le Commandement de l’Armée, qui est responsable selon moi du comportement des soldats, n’avait souvent pas besoin d’être très présent, il agissait souvent dans l’ombre et laissait faire, entretenant seulement le climat d’insécurité, de peur des appelés. Une question vient naturellement à l’esprit : pourquoi ce "travail" de la torture dont je porte témoignage était-il généralement et prioritairement réalisé par des appelés ? Ceux-ci n’étaient à priori par prédisposés à être des tortionnaires, mais de simples citoyens comme la majorité des français de l’époque. Par rapport à la conscience, la morale de ces actes, j’analyse le comportement des appelés de la façon suivante : Je serais tenté de dire qu’il y avait 5 catégories :
 Ceux qui avaient fait un choix "politique" dès le début, en refusant de porter les armes, en "désertant", je les admire, il fallait un courage considérable et sans doute déjà un engagement militant assez organisé.
Ceux qui avaient fait un choix "politique" dès le début, en refusant de porter les armes, en "désertant", je les admire, il fallait un courage considérable et sans doute déjà un engagement militant assez organisé. Ceux qui avaient admis, sans se casser la tête, que le commandement militaire avait certainement raison, et que pour obtenir des renseignements, des aveux, il n’y avait que la torture comme moyen d’action face à ceux qui n’étaient pas de vrais soldats de libération, mais des barbares.
Ceux qui avaient admis, sans se casser la tête, que le commandement militaire avait certainement raison, et que pour obtenir des renseignements, des aveux, il n’y avait que la torture comme moyen d’action face à ceux qui n’étaient pas de vrais soldats de libération, mais des barbares. Ceux qui se sont trouvé dans des unités où la torture n’a pas été pratiquée, au moins dans la période où ils ont effectué leur service. Ils en ont entendu parler, mais sans pouvoir se rendre compte réellement de ce que cela était, concrètement. Ils ont été nombreux. A Alger, dans la période où je peux témoigner cela devait pouvoir représenter près des ¾ des appelés, peut-être même plus.
Ceux qui se sont trouvé dans des unités où la torture n’a pas été pratiquée, au moins dans la période où ils ont effectué leur service. Ils en ont entendu parler, mais sans pouvoir se rendre compte réellement de ce que cela était, concrètement. Ils ont été nombreux. A Alger, dans la période où je peux témoigner cela devait pouvoir représenter près des ¾ des appelés, peut-être même plus. Ceux qui, les plus nombreux de ceux qui ont participé à la pratique de la torture, ont été pris dans l’amalgame. Il ne faut pas oublier qu’à 20 ans sans expérience de "combat" social, découvrant cette réalité, il est difficile de savoir comment pouvoir réagir. Il existe un effet de groupe, d’un groupe en place qui agit en fonction de règles établies par les ordres, la pratique, une "expérience"… et les jeunes arrivent un par un dans ces unités. Comment pouvoir contester quelque chose à l’armée ? De plus dans ces unités "spécialisées" un refus d’obéissance, une contestation n’auraient pu être que certainement considérés comme des actes de haute trahison militaire avec au minimum le tribunal militaire à la clé. Les officiers de carrière n’avaient même pas besoin de forcer les appelés, il leur suffisait de transmettre les informations du commandement de l’armée sur les attentats, les jeunes du contingent qui avaient été tués ou torturés (ou les 2) : la liste quotidienne était longue. Avec quelques commentaires le climat de volonté de vengeance était garanti. Il suffisait d’entretenir les braises pour que le feu ne s’éteigne pas. Et donc très vite, avec ce martelage psychologique de l’encadrement ces appelés pensaient que c’était la seule manière d’obtenir des renseignements, des aveux et que les Algériens qui étaient en face devaient leur donner les informations qu’ils attendaient. Seul dans sa conscience, dans un tel contexte, il n’était plus possible, alors, de s’opposer. Je partage tout à fait cet avis de Alice CHERKI que ceux qui ont pratiqué la torture, parmi les jeunes du contingent, dans leur très grande majorité, ils l’ont fait, entraînés à leur insu, de fait, par ce conditionnement psychologique de l’encadrement. C’est également vrai, je l’ai constaté sur place, que des "copains" de chambrée, adorables, gentils,… avec qui il était agréable de discuter de passer des heures avec eux pouvaient se montrer d’une cruauté, d’un raffinement qui n’avait de limite que la concurrence d’un autre copain, ou l’enjeu d’un pari. Il y avait souvent une sorte d’entraînement d’excitation, de surenchère morbide. Là bas, je me suis souvent interrogé pour tenter de comprendre pourquoi, des jeunes pouvaient en arriver à de tels comportements. En fait, je pense que ce climat de haine, entretenu, cultivé, entraînait ce tortionnaire occasionnel à vouloir faire aussi bien que ses copains, pouvoir montrer qu’il allait "bien" venger ses copains (qu’il ne connaissait pas) qui s’étaient fait tuer à quelques jours, semaines de la quille. Un autre facteur important, sinon capital, c’est que ces jeunes ne pouvaient bénéficier d’aucune distraction. Une "perm", c’était quelques heures à se balader, obligatoirement en groupe (par sécurité) simplement aller boire un pot dans le quartier chic, européen d’Alger, éventuellement aller au bordel (mais à la fin de la guerre les risques étaient grands). Dans ce type de balade il fallait sans cesse surveiller à droite, à gauche, devant, derrière, avoir la main prête à saisir le pistolet (presque toujours armé, même dans son étui, pour ne pas perdre de temps en cas de besoin). Le moindre moment d’inattention c’était risquer sa vie. Il n’y avait aucune distraction possible, aucun contact féminin digne de ce nom, et ce pendant des mois. Les informations de la métropole arrivaient au compte goutte : pas de journaux, seulement le courrier familial, des amis. Il y n’avait pas de télévision, seuls quelques-uns uns avaient un poste de radio et arrivaient à capter Europe1, parfois Radio-France. Alors des jeunes de 20 ans, 24 heures sur 24 sur le qui-vive (avec les gardes, les perquisitions..) désœuvrés moralement, obnubilés par le nombre de jours pour avoir enfin la "quille", conditionnés par cette psychose de l’attentat FLN, avaient, par ce moyen, l’occasion de pouvoir se défouler. Et comme leur calvaire, pour une bonne part, provenait, selon le martèlement qu’on leur faisait, des Algériens tous sympathisants du FLN, l’autodéfense personnelle par la torture devenait plausible, et une solution naturelle. Et un facteur aggravant, à Alger il fait généralement chaud, alors on boit, de préférence de la bière (parfois du vin), d’autant plus quand on a "besoin" d’oublier cet enfer, de rêver au retour à la vie en métropole avec l’amie, la femme, ses amis pouvoir enfin espérer revivre : alors, l’alcool devient facilement le paradis idéal d’évasion pour beaucoup, un refuge, un moyen de ne plus être le même, d’avoir l’excuse de pouvoir tout se permettre parce qu’on a bu.
Ceux qui, les plus nombreux de ceux qui ont participé à la pratique de la torture, ont été pris dans l’amalgame. Il ne faut pas oublier qu’à 20 ans sans expérience de "combat" social, découvrant cette réalité, il est difficile de savoir comment pouvoir réagir. Il existe un effet de groupe, d’un groupe en place qui agit en fonction de règles établies par les ordres, la pratique, une "expérience"… et les jeunes arrivent un par un dans ces unités. Comment pouvoir contester quelque chose à l’armée ? De plus dans ces unités "spécialisées" un refus d’obéissance, une contestation n’auraient pu être que certainement considérés comme des actes de haute trahison militaire avec au minimum le tribunal militaire à la clé. Les officiers de carrière n’avaient même pas besoin de forcer les appelés, il leur suffisait de transmettre les informations du commandement de l’armée sur les attentats, les jeunes du contingent qui avaient été tués ou torturés (ou les 2) : la liste quotidienne était longue. Avec quelques commentaires le climat de volonté de vengeance était garanti. Il suffisait d’entretenir les braises pour que le feu ne s’éteigne pas. Et donc très vite, avec ce martelage psychologique de l’encadrement ces appelés pensaient que c’était la seule manière d’obtenir des renseignements, des aveux et que les Algériens qui étaient en face devaient leur donner les informations qu’ils attendaient. Seul dans sa conscience, dans un tel contexte, il n’était plus possible, alors, de s’opposer. Je partage tout à fait cet avis de Alice CHERKI que ceux qui ont pratiqué la torture, parmi les jeunes du contingent, dans leur très grande majorité, ils l’ont fait, entraînés à leur insu, de fait, par ce conditionnement psychologique de l’encadrement. C’est également vrai, je l’ai constaté sur place, que des "copains" de chambrée, adorables, gentils,… avec qui il était agréable de discuter de passer des heures avec eux pouvaient se montrer d’une cruauté, d’un raffinement qui n’avait de limite que la concurrence d’un autre copain, ou l’enjeu d’un pari. Il y avait souvent une sorte d’entraînement d’excitation, de surenchère morbide. Là bas, je me suis souvent interrogé pour tenter de comprendre pourquoi, des jeunes pouvaient en arriver à de tels comportements. En fait, je pense que ce climat de haine, entretenu, cultivé, entraînait ce tortionnaire occasionnel à vouloir faire aussi bien que ses copains, pouvoir montrer qu’il allait "bien" venger ses copains (qu’il ne connaissait pas) qui s’étaient fait tuer à quelques jours, semaines de la quille. Un autre facteur important, sinon capital, c’est que ces jeunes ne pouvaient bénéficier d’aucune distraction. Une "perm", c’était quelques heures à se balader, obligatoirement en groupe (par sécurité) simplement aller boire un pot dans le quartier chic, européen d’Alger, éventuellement aller au bordel (mais à la fin de la guerre les risques étaient grands). Dans ce type de balade il fallait sans cesse surveiller à droite, à gauche, devant, derrière, avoir la main prête à saisir le pistolet (presque toujours armé, même dans son étui, pour ne pas perdre de temps en cas de besoin). Le moindre moment d’inattention c’était risquer sa vie. Il n’y avait aucune distraction possible, aucun contact féminin digne de ce nom, et ce pendant des mois. Les informations de la métropole arrivaient au compte goutte : pas de journaux, seulement le courrier familial, des amis. Il y n’avait pas de télévision, seuls quelques-uns uns avaient un poste de radio et arrivaient à capter Europe1, parfois Radio-France. Alors des jeunes de 20 ans, 24 heures sur 24 sur le qui-vive (avec les gardes, les perquisitions..) désœuvrés moralement, obnubilés par le nombre de jours pour avoir enfin la "quille", conditionnés par cette psychose de l’attentat FLN, avaient, par ce moyen, l’occasion de pouvoir se défouler. Et comme leur calvaire, pour une bonne part, provenait, selon le martèlement qu’on leur faisait, des Algériens tous sympathisants du FLN, l’autodéfense personnelle par la torture devenait plausible, et une solution naturelle. Et un facteur aggravant, à Alger il fait généralement chaud, alors on boit, de préférence de la bière (parfois du vin), d’autant plus quand on a "besoin" d’oublier cet enfer, de rêver au retour à la vie en métropole avec l’amie, la femme, ses amis pouvoir enfin espérer revivre : alors, l’alcool devient facilement le paradis idéal d’évasion pour beaucoup, un refuge, un moyen de ne plus être le même, d’avoir l’excuse de pouvoir tout se permettre parce qu’on a bu. Ceux qui, un peu comme moi, refusaient, par principe la guerre, avaient tenté de le dire à leur façon, de s’y opposer, mais non engagés, isolés, étaient un peu désemparés, face à cette torture. S’opposer seul à de telles pratiques ? C’était une pure utopie. A plusieurs reprises, j’ai eu beaucoup de mal à ne pas être mis en cause parce qu’on considérait que j’étais toujours à la traîne pour ces besognes, trop souvent avec des prétextes pour m’y soustraire. Il ne faut pas oublier que dans une unité comme celle où je me suis trouvé affecté, il n’est pas sûr que les règles officielles soient correctement appliquées (on avait tellement l’habitude de ne pas les respecter) : peut-être aussi expéditives et radicales que celles employées avec les militants du FLN identifiés. A partir de là les marges de manœuvres devenaient très difficiles entre la conscience de ces pratiques que l’on ne pouvait pas supporter, et l’obligation de passer à l’acte presque comme les autres pour ne pas se trouver taxé d’allégeance aux "Fells". Alors quand cela dure près de 10 mois, je peux vous dire que psychologiquement on ne sort pas indemne d’un tel séjour.
Ceux qui, un peu comme moi, refusaient, par principe la guerre, avaient tenté de le dire à leur façon, de s’y opposer, mais non engagés, isolés, étaient un peu désemparés, face à cette torture. S’opposer seul à de telles pratiques ? C’était une pure utopie. A plusieurs reprises, j’ai eu beaucoup de mal à ne pas être mis en cause parce qu’on considérait que j’étais toujours à la traîne pour ces besognes, trop souvent avec des prétextes pour m’y soustraire. Il ne faut pas oublier que dans une unité comme celle où je me suis trouvé affecté, il n’est pas sûr que les règles officielles soient correctement appliquées (on avait tellement l’habitude de ne pas les respecter) : peut-être aussi expéditives et radicales que celles employées avec les militants du FLN identifiés. A partir de là les marges de manœuvres devenaient très difficiles entre la conscience de ces pratiques que l’on ne pouvait pas supporter, et l’obligation de passer à l’acte presque comme les autres pour ne pas se trouver taxé d’allégeance aux "Fells". Alors quand cela dure près de 10 mois, je peux vous dire que psychologiquement on ne sort pas indemne d’un tel séjour.Mon engagement moral, mes convictions, et ma possibilité de "justifier" mon "travail" administratif m’ont permis de ne pas être contraint de pratiquer directement ces actes de barbarie. Justifiant le respect de mon amie laissée en Métropole (même si je n’en avais pas à cette époque) et prétextant, que je ne pourrais jamais faire l’amour avec une algérienne m’ont permis que je ne sois pas trop mis en cause de ne pas profiter de pouvoir me soulager sexuellement gratuitement. Pendant cette période, j’ai fait ce je pensais pouvoir faire pour limiter au maximum cette participation à ce qui me révoltait au plus fort de moi. Je ne pense pas avoir de trop lourdes responsabilités personnelles. Surtout dans ce service, il n’était pas possible, humainement, à quelqu’un, isolément, de pouvoir s’opposer directement à la torture, cela aurait été très certainement sa condamnation à coup sûr à la torture, à l’emprisonnement pour haute trahison, et même très plausible, à l’exécution, sans procès : parce qu’ayant eu accès à trop de dossiers sensibles de responsables FLN j’aurais été un individu trop dangereux, de ceux qui n’ont jamais été jugés, si possible. Mais c’est à titre collectif, que j’ai le sentiment, comme français ancré dans l’idée de la liberté, et le combat nécessaire pour la défendre, de porter une part de culpabilité de torture dans cette période.
Cette tentative d’explication n’est en rien un souhait de me disculper, de pouvoir faire penser que moi, je suis blanc dans cette opération, parce que j’étais conscient de cette ignominie, parce que je n’ai pas trouvé de solutions pour m’y opposer. Je me sens totalement, comme français, comme militaire, co-responsable de ces exactions. Je ne me sentirai moralement un peu soulagé que le jour où les autorités françaises, au plus haut niveau reconnaîtront cette torture et la condamneront.
Juste avant d’être libéré, le cessez le feu avait été signé depuis quelques jours, j’ai failli, à Sissonne, être sérieusement inquiété. J’avais dit aux appelés que maintenant j’allais pouvoir enfin diffuser à la presse mes notes consignées sur un cahier de ce que j’avais vécu : un officier de la sécurité militaire est venu demander au chef de poste que j’étais à ce moment là le commandant de la caserne pour pouvoir effectuer une fouille afin de trouver des documents subversifs. J’ai réussi à les camoufler.
Comme la majorité de mes camarades du contingent, l’enfer de ce séjour en Algérie a gravé des souvenirs tenaces qui ne s’estompent pas comme je l’avais espéré. Comme beaucoup de ceux qui ont fait cette sale guerre, mais il n’y a que des sales guerres, pendant des années, la nuit, les rêves se transformaient, se transforment encore (heureusement un peu moins souvent), en cauchemars, ramenant ces images de violence insoutenable. Je considère que je suis malgré tout un miraculé, puisque je suis revenu intact physiquement, malgré les 5 ou 6 occasions où j’ai eu la chance que les attentats (c’était le terme employé de ces actes de guerre du FLN) dans lesquels je me suis trouvé visé (individuellement ou collectivement) m’épargnent.
Je suis pleinement convaincu que les militaires du contingent ayant torturé, comme leurs victimes, ne sont pas sortis indemnes de cette péripétie. Par contre, je suis certain qu’il n’y a pas de processus de guérison possible. Il peut y avoir sans doute une assistance, une aide pour atténuer les séquelles mais les choses sont irréversibles. Le temps, à la longue, estompe légèrement l’acuité de la douleur morale, mais ne la gomme jamais.
Cette page d’histoire est l’une des racines, l’un des séquelles du colonialisme, qui fait perdurer le racisme en France avec tout ce qu’il engendre.
Il me semble urgent que le Gouvernement, le Chef de l’Etat prennent officiellement position pour condamner cette pratique de la torture dont la France s’est rendu honteusement coupable dans cette période. Pour un pays qui se targue d’être celui des droits de l’homme, il n’est pas possible de se montrer en donneur de leçons tant que l’on couvre, de fait, cette horrible période et qu’il n’y aura pas eu condamnation officielle de tels agissements.
Ce témoignage peut être publié, s’il peut servir à éradiquer ces pratiques barbares de la torture, à servir pour la paix en respect de la Vérité Historique.
P.S. :
C’est ce texte qui a été repris dans le livre collectif édité par l’ARAC "L’Algérie, nous y étions..." qui relate l’expérience différente en fonction du lieu, de la période, du commandement, des hommes... d’une vingtaine d’anciens combattants de cette guerre.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 26 Août 2014 à 08:03
Martine et Gilbert vivent aujourd’hui à Saintes, la ville qui a « changé leur destin ». Sur la photo, prise le 5 juin 1957, Gilbert est sur le point de repartir d’Étauliers. © Photo photo a.e
http://www.sudouest.fr/2014/08/26/pour-martine-l-amour-est-tombe-du-ciel-1651451-1504.php
4 juin 1957, dans l'après-midi, Gilbert est en mission avec sept autres pilotes de l'armée de terre. Ils doivent mener une escadrille d'hélicoptères Djinn, de leur hangar de construction à Cazeaux (à côté de Rochefort) vers Cognac, où les attend un cargo sur la Charente, en partance pour l'Algérie.
Alors que quatre d'entre eux ont déjà fait deux allers-retours dans la matinée pour apporter huit hélicoptères, le commandant désigne l'un des confrères de Gilbert qui prend donc la tête de l'escadrille.
Ils survolent la route départementale 137 qui relie Rochefort et Saintes. Mais aux abords de Saintes, le lieutenant se trompe de chemin et prend la direction de Bordeaux. Aucun des militaires ne s'en aperçoit aussitôt. « Nous n'avions assez de kérosène que pour aller jusqu'à Cognac, raconte aujourd'hui Gilbert. Après plus de trente minutes de vol, le niveau du réservoir était en chute libre ». Les pilotes se posent alors en « autorotation » (une manœuvre d'atterrissage d'urgence pour les hélicoptères) dans le champ du curé du village d'Étauliers, dans le Blayais. Les villageois, attirés par ce branle-bas de combat, commencent à affluer en nombre.
Relation épistolaire
À une cinquantaine de mètres de là, Martine, 18 ans ce jour-là, travaille dans la pharmacie de la commune. Comme le reste des villageois curieux, elle s'approche du champ où sont « tombés » les militaires. C'est alors qu'elle fait la rencontre de celui avec qui elle partagera sa vie jusqu'à aujourd'hui. « Je l'ai trouvé très charmant, au premier abord », admet-elle. Quant à Gilbert, il trouve même Martine « trop belle pour lui ».
Pendant ce temps, deux hélicoptères ont réussi à pomper du kérosène grâce à plusieurs habitants du village pour pouvoir repartir. Le père de Martine en fait partie et il ira même jusqu'à convier Gilbert à l'anniversaire de sa fille. Ce dernier accepte.
Le 5 juin, l'armée de l'air apporte enfin la quantité de kérosène nécessaire pour permettre à tous les hélicoptères de repartir sur le droit chemin, direction Cognac. Les adieux sont douloureux, d'autant que Gilbert doit partir quelques mois plus tard pour l'Algérie. Les deux tourtereaux s'écrivent alors chaque jour. « Martine est devenue ma marraine de guerre, assure Gilbert, c'est important d'avoir un contact extérieur lorsqu'on est dans de telles conditions. » Martine lui raconte les épisodes du «Chien des Baskerville» qu'elle voit à la télévision, ses stages en pharmacie. Il lui raconte l'enfer qu'il traverse, la chaleur, l'horreur de la guerre et bientôt la maladie qui s'empare de lui. Gilbert est atteint d'une hépatite virale qu'il a attrapée par contagion. « J'étais au plus bas à cette époque-là, reconnaît-il, Martine m'a aidé à tenir le coup car en plus d'être malade, je ne pouvais plus piloter, j'avais donc perdu mon métier ».
Un livre et des émissions
Gilbert ne peut plus rester en Algérie, il rentre donc fin 1957 et, quelques mois plus tard, il retourne à Étauliers où Martine l'attend toujours. Le 13 juin 1959, deux ans après leur rencontre, Gilbert et Martine se marient. Ils ont eu trois enfants, sept petits-enfants et ils attendent même un deuxième arrière-petit-enfant.
Mais ils n'ont pas enfoui leurs souvenirs car ils savent que leur histoire est unique. Gilbert en a écrit un livre, « Revenir pour revivre », dans lequel il raconte sa rencontre mais également sa vision de la guerre d'Algérie.
Alexia Elizabeth
La télévision intéressée
« Parfois les gens ne nous croient pas, ils trouvent que notre histoire fait trop factice », regrette Martine. Pourtant, elle a déjà intéressé les programmateurs de France 2 qui les ont conviés à l'émission « Toute une histoire », il y a quatre ans. Aujourd'hui, la chaîne souhaite réaliser un sujet sur ce que sont devenus Gilbert et Martine. Pour cela, ils auront besoin de témoignages de personnes qui auraient pu voir passer les hélicoptères, en rase-mottes dans le ciel du nord de Saintes, ce fameux 4 juin 1957.
Pour témoigner : 06 82 78 46 81 ou gilbert.toussaint@wanadoo.fr
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique