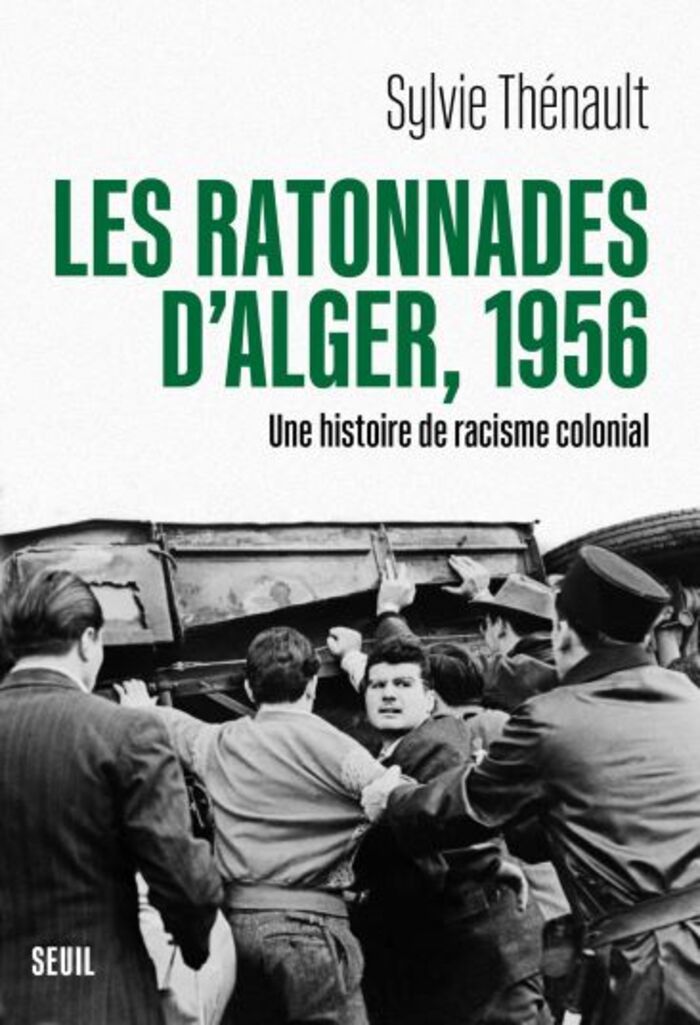-
Par micheldandelot1 le 19 Mars 2022 à 11:03

Avec une demande de droit de réponse
cet article sera envoyé à INFO-CHALON
Je reçois d’un contact que j’ai à Chalon-sur-Saône, non il ne s’agit pas de mon ami Michel Dandelot… il ne diffuse pas ce genre de document, du moins pas sans commentaire critique, un article Ils avaient 20 ans là-bas en Algérie ! - de la presse du cru. Il y est question des 30 000 soldats « morts pour la France » et de la « pacification ».
Déjà en 14-18 l’expression « Mort pour la France » était sujette à contestation. Anatole France a notamment écrit « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels » ! En Algérie c’était bien pire : que faisions-nous à des centaines de kilomètres de nos frontières ?
Eh bien on n’y défendait pas la France mais un système social, le colonialisme, qu’on avait imposé sur des terres qu’on avait conquises par la force des armes. Les soldats qui ont perdu la vie dans cette guerre anachronique ont été victimes de l’imbécillité des dirigeants politiques de l’époque qui refusaient de voir que l’Algérie française était une fiction que l’on maintenait contre le vent de l’histoire.
Le même article Ils avaient 20 ans là-bas en Algérie ! fait état de la pacification dans laquelle nos troupes étaient engagées. Avec la torture, les corvées de bois, les camps de regroupement, l’utilisation du napalm, du gaz sarin, les douars incendiés, les viols aussi ? Eh oui, la puissance coloniale avait créé les conditions d’une guerre civile en Algérie ! Il ne fallait pas s’y fier !
Il eut été mille fois préférable qu’on évite ce conflit chargé de souffrances et qu’on négocie la fin du colonialisme et la guerre menée pour tenter de le perpétuer. Finalement c’est ainsi qu’on a pu régler les questions qui se posaient. On aurait dû le faire tout de suite !
Je ne connais pas spécialement le journaliste qui a pondu cet article Ils avaient 20 ans là-bas en Algérie ! complètement déphasé par rapport au souci de paix et d’amitié entre les peuples ainsi qu’à la recherche de la vérité dans le devoir de mémoire auquel nous sommes invités en ce 60ème anniversaire du cessez-le-feu. J’estime qu’il est complètement à côté de la problématique du moment !
Un point avec lequel je suis toutefois d’accord avec lui, c’est la place qu’occupent les appelés du contingent dans cette réflexion sur notre passé. Ils sont, c’est vrai, absents du débat !
Je signale une vidéoconférence sur le sujet organisée ce samedi 19 mars à 19 h par le Mouvement de la Paix. Elle est accessible à tous, voici le lien :
Et naturellement je rappelle notre rendez-vous ce samedi 19 mars à Béziers, à 15 h, à l’entrée de la rue anciennement nommée Rue du 19 mars 1962.
Jacques CROS
Ancien appelé de la guerre d’Algérie
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 19 Mars 2022 à 08:02
Eh Pécresse ! Eh Le Pen !
Vous aussi vous occultez
l’OAS...
Vous êtes des menteuses éternelles…
Valérie Pécresse et Marine Le Pen réclament une autre date pour commémorer la fin de la d’Algérie.
Les deux candidates à la présidentielle rappellent que le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu, a été suivi de nombreuses violences. Emmanuel Macron organise une cérémonie à l’Elysée samedi.
Elles contestent le calendrier. Tour à tour, vendredi 18 mars, Valérie Pécresse et Marine Le Pen ont déploré que le 19 mars commémore traditionnellement la fin de la guerre d’Algérie. Emmanuel Macron doit d’ailleurs tenir, demain, à l’Elysée une cérémonie à l’occasion du soixantième anniversaire du cessez-le-feu.
Valérie Pécresse s’est engagée à trouver une autre date, et a promis si elle était élue d’engager « une forme de réconciliation » mémorielle sur le sujet. « A l’évidence, le 19 mars ne marque pas la fin du conflit algérien. 80 % des victimes civiles sont tombées après les accords d’Evian », a-t-elle affirmé lors d’un déplacement à Nîmes. Elle a rappelé la fusillade de la rue d’Isly, à Alger, le 26 mars 1962, dans laquelle des dizaines de partisans de l’Algérie française furent tués par l’armée, ou le massacre d’Oran du 5 juillet 1962.
Les rapatriés contestent la référence aux accords d’Evian – signés le 18 mars 1962 et qui aboutirent à la mise en œuvre du cessez-le-feu, le 19 mars – pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie, en raison des violences qui se poursuivirent jusqu’à l’indépendance du pays, le 5 juillet 1962, et se conclurent par l’exode de centaines de milliers d’entre eux vers la France.
Evoquant « les blessures enfouies que cet anniversaire ravive chaque année », Mme Pécresse a estimé qu’« on ne peut plus continuer à opposer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France durant les combats d’Algérie et d’Afrique du Nord et le souvenir de ceux qui sont tombés ou qui ont disparu, dans des circonstances parfois atroces, après le cessez-le-feu ». Si « ces huit années de guerre furent terribles » et « le système colonial injuste », elle a assuré que « les Français d’Algérie et leurs enfants n’en sont pas coupables ». « Non, on ne doit pas, comme l’a fait Emmanuel Macron, les accuser d’un crime contre l’humanité qu’ils n’ont pas commis », a-t-elle affirmé.
« Réconcilier en se flagellant »
Aux yeux de Marine Le Pen, « cette date n’a pas été la fin de la guerre d’Algérie, car il y a eu des dizaines de milliers de harkis qui ont été sauvagement assassinés ». « S’il s’agit de réconcilier les mémoires en se flagellant devant l’Algérie qui ne cesse de réclamer des actes de repentance, en ce qui me concerne, ce sera non, sauf si l’Algérie demande elle-même pardon aux harkis sur la manière dont ils se sont comportés à leur égard », a ajouté sur France Inter la candidate à la présidentielle du Rassemblement national (RN), ancien Front national, qui fut longtemps le refuge des partisans de l’Algérie française. Des maires de communes RN ou proches du RN ont débaptisé leurs rues « 19 mars 1962 ».
Emmanuel Macron a placé la cérémonie de samedi sous le signe de l’« apaisement » des mémoires et de la « main tendue » à l’Algérie. « Le 19 mars est une étape sur ce chemin mais ce n’en est pas le terme », a insisté la présidence. « Tous les événements liés à la guerre d’Algérie ne se sont pas terminés du jour au lendemain avec la signature des accords d’Evian », a concédé l’Elysée.
Le Parlement avait, par ailleurs, définitivement adopté en février, par un ultime vote très large du Sénat, un projet de loi pour demander « pardon » aux harkis, qui ouvre la voie à une indemnisation pour certaines familles.
Le Monde avec AFP
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 18 Mars 2022 à 20:10
60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

En 2022, nous commémorerons la fin d’une guerre qui a duré plus de sept ans, mais qui ne disait alors pas son nom puisque la France officielle parlait des « événements d’Algérie », et qu’il faut inscrire dans 132 ans de colonialisme. Un système social que ce conflit avait pour objectif de perpétuer.
Cette phase de notre histoire a causé bien des souffrances. Aux Algériens d’abord mais aussi aux Français, particulièrement à ceux qui ont eu le malheur d’avoir 20 ans en ce temps-là et qui se sont trouvés enrôlés dans une armée coloniale et confrontés à une situation à la fois anachronique, injuste et sans autre perspective que l’indépendance de l’Algérie.
Une donnée dont il faut tenir compte dans l’actualité de 2022 avec ce qu’il se passe en Ukraine. La guerre ne résout rien, il n’y a pas de solution militaire à un problème politique. Nous pouvons témoigner que les atrocités que génère le recours à la force armée ne font qu’aggraver les difficultés.
Cette guerre d’Algérie a marqué la vie des appelés du contingent qui arrivent aujourd’hui à la fin de leur existence. Si tous n’ont pas subi le pire, tous se sont vu voler de longs mois de leur jeunesse dont à coup sûr ils auraient fait un meilleur usage.
Il est nécessaire d’éclairer les consciences par un travail de mémoire sur ce qui s’est déroulé il y a soixante ans et plus. D’autant que les circonstances ont fait qu’un silence lourd a pesé sur ces événements. Avec la remise du rapport Stora au chef de l’État, avec diverses déclarations concernant la nature du colonialisme, les drames du 17 octobre 1961, du 8 février 1962, la reconnaissance de l’assassinat de Maurice Audin ou d’Ali Bendjamel, on a certes commencé à faire évoluer notre compréhension de ce qui a eu lieu.
Mais il subsiste des confusions, des ambiguïtés, des insuffisances, notamment à l’égard de l’OAS, cette organisation terroriste qui refusait obstinément la paix et l’amitié entre les peuples. Il est significatif que soient escamotées les raisons qui ont conduit des dizaines d’Européens d’Algérie à trouver la mort rue d’Isly le 26 mars 1962.
Dans le même esprit, il faut rendre compte de l’impasse dans laquelle on avait mis les harkis en les engageant pour combattre, les armes à la main, leurs compatriotes plus convaincus de la nocivité du colonialisme. Nous ne voudrions pas que sous couvert de réparations légitimes, on remette en question un jugement qualifié sur un système social particulièrement ségrégatif.
Au passage, on relèvera que le racisme et la xénophobie que la crise socio-économique a exacerbés touchent aussi bien les descendants de harkis que ceux dont les ascendants se sont battus contre la puissance coloniale.
Alors oui il nous faut donner à ce 19 mars 2022, 60ème anniversaire du cessez-le-feu, toute l’importance qu’il faut lui accorder. Une date choisie par le législateur pour un recueillement autour de cette affaire douloureuse. Le Mouvement de la Paix, qui a participé à la lutte contre la guerre d’Algérie, a toute sa place dans cette commémoration. Ce sera aussi l’occasion de réitérer notre proposition d’un Traité de Paix et d’amitié entre la France et l’Algérie, permettant l’approfondissement des liens d’amitié et de coopération déjà largement développés entre les deux sociétés et si importants pour construire un espace méditerranéen de Paix.
A Paris, le vendredi 18 mars 2022
Le Mouvement de la Paix

Le samedi 19 mars marque l'anniversaire
des accords d'Évian
Le Mouvement de la Paix a pensé qu'il était bon de se donner un moment de réflexion en organisant une visioconférence ouverte, avec la participation de plusieurs intervenant·e·s :
· Amed Badaoui, syndicaliste algérien militant des droits de l'homme en Algérie vivant à Alger.
· Yasmina Chouaki, militante de l'association Fahrwa Fatma N'Soumer, association de femmes algériennes à Alger.

· Bravo Jacques Cros, ancien appelé en Algérie, militant au Mouvement de la Paix, d'être présent dans cette visio-conférence.
· Larbi Benchiha, journaliste/cinéaste grand reporter, auteur de films sur la question dont nous projetterons un extrait correspondant à des interviews de participants aux négociations des accords d’Évian.
· Georges Ploteau, militant à l'ARAC, Association Républicaine des Anciens Combattants (sous réserve/sollicité).
Vous êtes toutes et tous convié·e·s à participer à cette visioconférence qui aura lieu sur Zoom le samedi 19 mars à 19h via le lien ci-après : https://zoom.us/j/7585066971
En souhaitant vous voir nombreux.
Bien cordialement,
Le Mouvement de la Paix votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 18 Mars 2022 à 10:52
Lettre ouverte d’Henri Pouillot
à Emmanuel Macron
En 2022

Objet : 19 mars 2022 / 26 mars 1962
Témoin de la Guerre de Libération de l’Algérie, comme appelé (de juin 1961 au 13 mars 1962), affecté à la Villa Susini, j’ai eu l’occasion de constater de très nombreuses exactions commises dans cette période par l’Armée Française (en particulier la torture), des crimes contre l’Humanité, des crimes de guerre, des crimes d’état dont la France porte la terrible responsabilité.
Le 27 janvier dernier je vous interpellais quant à votre intervention du 26 janvier 2022, relative à la fusillade de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962, quant à vos propos : « ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République ». Je vous avais fait la remarque que votre présentation des faits était une falsification grave de l’Histoire de notre pays, d’autant plus grave qu’elle émanait du Président de la République lui-même. Je justifiais cette remarque par le plan que j’avais pu consulter aux archives de Vincennes qui était la preuve formelle de la provocation du commando de l’OAS « oubliée » : preuve incontestable.

Samedi 26 mars 2022, vous avez fait déposer une gerbe à la mémoire des victimes de la fusillade de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962 au Mémorial du Quai Branly. Compte tenu de ce geste et de la présence d’une haie militaire y présentant les armes ainsi que les personnalités officielles présentes, cette commémoration révélait donc le caractère le plus officiel que l’on puisse considérer.
Or, cette commémoration organisée par un groupe de nostalgiques de l’Algérie Française, sera clôturée par l’interprétation du « Chant des Africains » (cette chanson qui fut l’hymne de l’OAS), avec les militaires au garde à vous. Cela ne peut donc que s’interpréter comme un hommage à cette organisation fascisante, terroriste antirépublicaine puisqu’elle organisa un putsch pour tenter de renverser la République, et tenta 2 attentats contre le Président de la République d’alors.
La clôture de cette manifestation, est donc un geste odieux, remettant en cause toutes les valeurs de notre République et elle a donc eu votre caution.
Le Rapport de Benjamin STORA, que vous aviez commandé, il y a un peu plus d’un an, minimisait déjà considérablement la responsabilité de l’OAS dans cette période de la Guerre de Libération de l’Algérie. Vos récentes interventions relatives à la commémoration de ce 60ème anniversaire ne peuvent se comprendre que comme une volonté de votre part d’une réhabilitation, de fait, de cette organisation terroriste, fascisante qui a tenté de remettre en cause notre République.
C’est fort dépité, tellement je suis sidéré, Monsieur le Président de la République, que je vous adresse mes salutations respectueuses pour l’institution que vous représentez.
Henri POUILLOT
Ancien Combattant pendant la Guerre de Libération de l’Algérie, militant antiraciste, anticolonialiste, défenseur des droits de l’homme
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 17 Mars 2022 à 08:53
Communiqué
de Jean-Philippe Ould Aoudia
Président de l'association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons

Madame, Monsieur,
Hier, mardi 15 mars à 9 heures, au 101 rue de Grenelle à Paris, une cérémonie d’hommage s’est tenue devant la plaque commémorative apposée le 12 décembre 2001 à l’entrée de la salle Marchand-Feraoun.
C’était le soixantième anniversaire du massacre commis par l’OAS à Alger le 15 mars 1962, de six dirigeants des Centres sociaux éducatifs.
Comme elle le fait depuis 2019, Madame Amélie de Montchalin ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a prononcé des mots forts et justes. Qu’elle soit chaleureusement remerciée.
Mardi à 15 heures, à Alger, au lieu-dit Château Royal à Ben Aknoun, un hommage a également été rendu. A la demande du Président de la République, l’ambassadeur de France en Algérie a déposé une gerbe de fleurs, au bas de la plaque commémorative apposée sur le mur criblé par les balles devant lequel les six martyrs ont été mitraillés. Le ministre algérien chargé des anciens moudjahidine (combattants) et le conseiller mémoire nationale du président de la République algérienne étaient également présents.
Ce premier geste mémoriel émanant de la Présidence de la République en faveur de victimes de l’OAS a fait l’objet d’échanges avec les services chargés de la Mémoire au Palais de l’Elysée.
La reconnaissance au plus haut niveau de l’Etat du sacrifice des six fonctionnaires de l’Education nationale satisfait pleinement l’association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons.
Elle qui honore et défend depuis trente ans la mémoire d’hommes assassinés dans l’exercice de leurs fonctions, victimes de leur engagement pour les valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie dans une relation fraternelle avec la France. Ils ont pour nom : Marcel Basset, Robert Eymard, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutène, Max Marchand et Salah Ould Aoudia.
L’association exprime ses remerciements profonds et respectueux à Monsieur le Président de la République et à ses conseillers.
Docteur Jean-Philippe Ould Aoudia
Président de l'association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 17 Mars 2022 à 07:59
France-Algérie : Macron commémorera
le 60e anniversaire des accords d’Evian samedi à l’Elysée

Alger (Algérie), le 14 février 2017. Emmanuel Macron, alors candidat, avait provoqué un tollé en affirmant :« La colonisation fut un crime contre l’humanité. »
Par Le Parisien avec AFP
Soixante ans jour pour jour après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en Algérie, le chef d’Etat français entend « apaiser » les mémoires et « tendre la main » à Alger. Le président Tebboune, lui, réclame des excuses officielles de la France pour la colonisation.
En prenant soin de ménager toutes les susceptibilités à moins d’un mois du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron présidera une cérémonie samedi pour le 60e anniversaire des Accords d’Evian et du cessez-le-feu le lendemain en Algérie, avec un souci « d’apaisement » des mémoires et de « main tendue » à l’Algérie, a annoncé mercredi la présidence.
« Commémorer n’est pas célébrer », a toutefois souligné l’Elysée alors que la date du 19 mars 1962, qui marqua l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre armée française et indépendantistes algériens, continue à faire polémique. Les rapatriés contestent la référence aux Accords d’Evian - signés le 18 mars 1962 et qui aboutirent à la mise en œuvre du cessez-le-feu le lendemain - pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie (1954-1962) en raison des violences qui se poursuivirent jusqu’à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 et se conclurent par l’exode de centaines de milliers d’entre eux vers la France.
« Tous les événements liés à la guerre d’Algérie ne se sont pas terminés du jour au lendemain avec la signature des Accords d’Evian », a concédé l’Elysée en citant notamment la fusillade de la rue d’Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l’Algérie française furent tués par l’armée le 26 mars 1962. « Le 19 mars est une étape sur ce chemin (de mémoire) mais ce n’en est pas le terme », a insisté la présidence, en rappelant qu’un hommage serait aussi rendu aux appelés de la guerre d’Algérie le 18 octobre si Emmanuel Macron est « réélu ». (1)
L’ambassadeur d’Algérie sera-t-il présent ?
La cérémonie, qui se tiendra de 12 heures à 13h30, réunira des témoins de toutes les mémoires liées à la guerre d’Algérie, appelés, combattants indépendantistes, harkis et rapatriés. La ministre des Armées Florence Parly, le chef d’Etat-major des Armées Thierry Burckhard ainsi que des élus, dont le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, ville qui accueillera le futur musée de l’Histoire de France et de l’Algérie, seront également présents. L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a également été invité, a indiqué l’Elysée, sans préciser s’il avait accepté l’invitation.
Les relations entre les deux pays sont marquées par un certain apaisement à l’approche des élections après deux années de crispations. Entre autres épisodes, une phrase prononcée par Emmanuel Macron dans le cadre d’un échange avec des jeunes issus de groupes de mémoire liés à la guerre d’Algérie fin septembre 2021 avait jeté pour le moins un froid. « Est-ce qu’il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? » Alger avait décidé illico le rappel « immédiat » de son ambassadeur à Paris et interdit de facto le survol de son territoire aux avions militaires français de l’opération antidjihadistes Barkhane au Sahel. La visite du Premier ministre Jean Castex, initialement prévue en 2021, avait été annulée. A priori, il devrait se rendre à Alger les 23 et 24 mars, a précisé l’Elysée.
«Réconcilier les mémoires cloisonnées»
L’objectif de cette commémoration, « réconcilier » et « apaiser », reste le même que lors des précédents rendez-vous du quinquennat autour de la guerre d’Algérie, a souligné un conseiller présidentiel. Le chef de l’Etat a voulu, à travers une série de gestes mémoriels, « réconcilier la France et l’Algérie » ainsi que les « mémoires cloisonnées » en France, a rappelé l’Elysée.
Suivant les préconisations de l’historien Benjamin Stora, il a reconnu la responsabilité de l’armée française dans la mort du mathématicien communiste Maurice Audin et celle de l’avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d’Alger en 1967. Une stèle à la mémoire d’Abd el-Kader, héros national algérien du refus de la présence coloniale française, a été érigée en France à Amboise (centre) et les crânes de résistants algériens du XIXe siècle restitués à l’Algérie.
En 2017, Macron évoquait un «crime contre l’humanité»
Mais Alger, qui réclame des excuses officielles de la France pour la colonisation, n’a pas donné suite à ce travail de mémoire. « C’est une main qui est tendue et qui restera tendue », a toutefois souligné l’Elysée. Dans la société française, il s’agit de « constituer dans le temps long une mémoire commune, partagée, apaisée », a expliqué l’Elysée en réfutant les accusations de « clientélisme mémoriel » à l’encontre du chef de l’Etat.
Candidat en 2017, Emmanuel Macron avait estimé en février de cette année -là que la colonisation par la France avait été un «crime contre l’humanité» dont l’Hexagone devait s’excuser, provoquant un tollé à droite.
« Il était important aux yeux du président de la République que trois générations après, les poisons de la division qui se sont inscrits dans ce processus qui pendant 60 ans s’est fabriqué dans le déni, dans le non-dit, puissent trouver un terme », a relevé la présidence.
Mon commentaire
(1) Cette date du 18 octobre qui correspond au jour où la France a reconnu officiellement le mot « guerre » le 18 octobre 1999 pour la guerre d’Algérie.
La France reconnaît qu'elle a fait la «guerre» en Algérie. L'Assemblée a adopté la loi du 18 octobre 1999 un texte qui enterre le terme officiel d'«opérations de maintien de l'ordre».
Cette date avait été proposée par la FNACA. La ministre déléguée aux Anciens Combattants exigeait une date « neutre ». Je détiens cette information de source sûre. (Michel Dandelot)
Souvenirs
« VOUS ALLEZ DIRE QU’EN ALGERIE C’ETAIT LA GUERRE » Jean-Pierre Masseret

EXPRESSION « GUERRE D'ALGÉRIE »
Adoption d'une proposition de loi à l'assemblée
Séance du 5 octobre 1999
Discours de M. Jean-Pierre Masseret au Sénat
Et adoption définitive de la loi
"Ainsi, vous allez dire qu'en Algérie c'était la guerre, et ce parce que c'était bien la guerre".
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne prononcerai en cet instant que quelques mots d'introduction, puisque c'est vous qui aurez réellement la parole et, surtout, le pouvoir d'accomplir l'acte important qui nous réunit ce matin : qualifier de « guerre » le conflit d'Algérie et lui donner sa véritable signification historique. Il fallait, en effet, le faire.
Peut-être considérez-vous qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre la fin de la guerre d'Algérie et l'acte juridique que vous allez concrétiser ce matin. C'est vrai ! Mais chacun sait que cette période a été particulièrement difficile pour notre pays compte tenu des réalités et des liens historiques que la France a avec l'Algérie. Toutefois, on ne peut pas ignorer la réalité, et la grandeur d'un pays, c'est effectivement de regarder son histoire en face avec lucidité, avec courage, avec détermination.
En Algérie, c'était la guerre : 1,7 million de soldats ont été mobilisés avec des moyens militaires d'intervention, avec la souffrance de la guerre, la mort, la blessure, l'ensemble des déchirements liés à cette situation.
N'oublions pas non plus le drame vécu par nos concitoyens qui vivaient en Algérie et qui ont dû abandonner leur maison, leur foyer, leur cimetière, leurs racines pour revenir en France.
C'est tout cela qu'il faut, aujourd'hui, prendre en compte si l'on veut réellement reconnaître à ces soldats la dignité d'ancien combattant, la plénitude de cette réalité au même titre que ceux qui sont intervenus au service de la France à d'autres moments de notre histoire.
Ces soldats du contingent, ces appelés, ces rappelés, ces gendarmes, ces militaires d'active ont alors, comme cela a été toujours le cas dans notre histoire, répondu à l'appel de la nation.
Je sais bien que le pays leur a reconnu un certain nombre de droits dès 1955, puis leur a accordé la carte de combattant en 1974, mais c'était toujours au titre d'«opérations de maintien de l'ordre», des « événements d'Algérie ». Personne ne voulait vraiment qualifier la réalité, malgré l'intervention des parlementaires, lors de la discussion, chaque année, du budget du monde combattant, malgré les positions, les espérances et les demandes des associations du monde combattant.
Personnellement, lorsque j'ai accepté la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, j'ai immédiatment utilisé le mot de « guerre, », parce que je n'aurais pas imaginé utiliser un autre terme. Au demeurant, à l'époque, vous-mêmes, les journaux, la radio, nos familles évoquaient la « guerre d'Algérie ». Je ne vois pas comment il m'aurait été possible de qualifier ce conflit autrement ! Je n'ai d'ailleurs pas de mérite particulier : il s'agissait simplement de bien marquer la détermination du pays à accepter dorénavant, quelles que soient les sensibilités politiques de chacun, ce concept de guerre.
Au demeurant, le devoir de mémoire s'applique à cette période au même titre qu'aux autres périodes et il exige cette vérité historique. Or, par décence pour nos soldats qui sont morts en Algérie ou qui y ont été blessés, pour les combattants qui ont été engagés, qu'ils soient appelés ou rappelés, pour les militaires d'active, pour les harkis qui ont combattu à notre côté et qui, malheureusement, connaissent pour la plupart un sort tragique, pour les rapatriés et les pieds-noirs, ce devoir de mémoire ne peut s'exercer que si nous considérons la réalité historique telle qu'elle a été.
J'espère que, en qualifiant aujourd'hui de « guerre » ce qui s'est passé alors en Algérie, vous allez permettre également une avancée vers la réconciliation. En effet, je crois beaucoup que le monde des combattants français, de nos soldats qui portent cette histoire tragique en eux, peut être aussi un élément de réconciliation avec l'Algérie d'aujourd'hui.
Il s'agit de ne rien oublier, de prendre l'histoire dans sa réalité ; mais nous devons aussi être capables de dépasser ce moment tragique pour nous engager, au-delà du devoir de mémoire, dans un acte de réconciliation qui servira nos intérêts communs. Tel est, en tout cas, le vœu que j'émets.
Ce que vous allez faire aujourd'hui est quelque peu inhabituel pour un parlement, dont le rôle est plutôt de voter des lois. Dépassant ce matin votre compétence juridique, vous allez qualifier l'histoire, ce qui constitue effectivement un acte exceptionnel. Ainsi, vous allez dire qu'en Algérie c'était la guerre, et ce parce que c'était bien la guerre. Je vous en remercie ! (Applaudissements.)« VOUS ALLEZ DIRE QU’EN ALGERIE C’ETAIT LA GUERRE » Jean-Pierre Masseret
APPROUVE A L’UNANIMITE PAR LES SENATEURS
Nombre de votants
320
Nombre de suffrages exprimés
320
Majorité absolue des suffrages
161
Pour l'adoption
320 (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.) 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 16 Mars 2022 à 08:04
Guerre d’Algérie : « La mémoire
des victimes de l’OAS
n’a été que partiellement honorée
par Emmanuel Macron »

© KeystoneL'enterrement au cimetière d'El Alia des victimes de l'assassinat de Château-Royal par l'OAS, le 19 mars 1962.
Dans une campagne présidentielle chamboulée par la guerre en Ukraine, le chef de l’Etat s’apprête à commémorer le 60e anniversaire des accords d’Evian, signés le 18 mars 1962. En Algérie comme en métropole, 1962 marque la fin de la guerre, le début des espoirs d’indépendance et de liberté, mais charrie aussi la violence et l’exil. Alors que les autorités françaises négocient avec le Front de libération nationale (FLN) algérien, l’Organisation de l’armée secrète (OAS) s’oppose violemment à toute indépendance. Le 15 mars, un de ses commandos assassine six inspecteurs des centres sociaux éducatifs (CSE), réunis au lieu-dit Château Royal, dans le quartier d’El Biar, près d’Alger. Il s’agit de Mouloud Feraoun, un écrivain et ami d’Albert Camus, du professeur Max Marchand, de Marcel Basset, Robert Eymard, Ali Hammoutène et Salah Ould Aoudia. «La bêtise qui froidement assassine», écrira dans le Monde, le 19 mars, Germaine Tillion, qui fonda les centres sociaux en Algérie.
Depuis 2017, plusieurs «gestes symboliques» visant à réconcilier les mémoires de la guerre d’Algérie ont été effectués par Emmanuel Macron. Ce mardi 15 mars, l’ambassadeur français en Algérie, François Gouyette, a déposé une gerbe sur la stèle érigée à Alger en l’honneur de Mouloud Feraoun et des cinq autres victimes, au nom du président de la République. Jean-Philippe Ould Aoudia, fils d’un des six inspecteurs des centres sociaux tués par l’OAS, déplore toutefois que les victimes de l’organisation terroriste n’aient pas été honorées lors de commémorations officielles plus larges.
Le 15 mars 1962, six hommes, des Algériens et des Français, tous inspecteurs des CSE, sont assassinés par un commando de l’OAS à El Biar, dans la banlieue d’Alger. Pourquoi étaient-ils visés ?
L’assassinat du 15 mars 1962 remonte à loin. D’abord à la création du Service des centres sociaux par Germaine Tillion [en octobre 1955, ndlr]. Un mois avant, Jacques Soustelle [alors gouverneur général de l’Algérie] avait publié un arrêté créant les sections administratives spécialisées (SAS). Ce sont des structures militaires visant à apporter des soins, des notions d’éducation mais aussi à contrôler la population. Deux structures sont donc créées dans le même temps mais la militaire aura moins de succès que celle relevant de l’Education nationale. Dans l’esprit biaisé des militaires, défaits lors de la bataille de Diên Biên Phu six mois auparavant, la maîtrise de la population était importante. Or celle-ci préfère rapidement les centres sociaux aux SAS. Le général Massu, qui disposait des pleins pouvoirs pendant la bataille d’Alger, s’en est ainsi pris aux centres sociaux. Il y voyait une déviance des catholiques et des chrétiens présents dans ces centres en faveur de l’indépendance des Algériens.
Lors du procès des barricades [une semaine insurrectionnelle des partisans de l’Algérie française], les centres sociaux ont été pris à partie par les colonels qui ont désobéi. Tous les militaires et les civils impliqués dans l’affaire des barricades feront partie de l’OAS. Ils ont entendu dans un tribunal, des militaires, des gradés, dont Massu, insulter les centres sociaux. Pour eux, c’était un blanc-seing, un bon à tirer. Le crime du 15 mars n’est pas sorti ex nihilo. Enfin, au sein de ces centres, il y avait un recrutement à peu près égal entre Algériens et Français. C’était la préfiguration de l’Algérie indépendante. Pour les tenants extrémistes de l’Algérie française, il n’en était pas question.
Parmi les victimes, il y avait votre père, Salah Ould Aoudia…
Instituteur, mon père avait été recruté personnellement par Germaine Tillion. C’était l’un des plus anciens dirigeants du service des centres sociaux. Avec lui, on a voulu décapiter un service entier.
Ce jour-là, à trois jours de la signature des accords d’Evian qui ouvrirent la voie à l’indépendance, les partisans de l’Algérie française commettent un attentat meurtrier. L’émoi dans l’opinion publique est considérable. Quelles furent les répercussions politiques ?
Dans ses mémoires, Robert Buron, l’un des négociateurs français des accords d’Evian, écrit que ce crime les a impressionnés. Il pensait que les Algériens ne poursuivraient pas les négociations. Ils ont eu peur que les accords ne puissent être menés à leur terme. Les choses étaient toutefois trop avancées pour être perturbées. Les crimes les plus imbéciles n’interfèrent pas forcément la voie vers la paix et la réconciliation entre les peuples. Dans l’opinion publique, l’émoi fut également important. Le 19 mars au matin, dans toutes les écoles de France, une minute de silence fut respectée en hommage à ces enseignants. Pour nous, descendants des victimes de l’OAS, la minute de silence en hommage au professeur Samuel Paty a eu une résonance très forte.
Le 26 janvier, devant des associations de rapatriés d’Algérie conviées à l’Elysée, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de la rue d’Isly, des dizaines de pieds-noirs tués le 26 mars 1962. Une manifestation «attisée par l’OAS», a-t-il ajouté. Ces mots sont-ils importants à vos yeux ?
Ils n’ont aucune importance. Les historiens Gilles Manceron, Alain Ruscio et Fabrice Riceputi ont écrit sur le 26 mars 1962. Ils ont montré que c’était une manifestation montée et organisée du début jusqu’à la fin par l’OAS, suivant les directives du général Salan. Elle n’a donc pas été «attisée». Ce mot ne signifie donc rien. Le président Macron a ouvert le chantier des mémoires blessées de la guerre d’Algérie. C’est une bonne chose. Il a rendu hommage aux harkis, aux rapatriés, aux Algériens victimes du 17 octobre 1961. Mais il n’a jamais rendu hommage aux 2 700 victimes de l’OAS. C’est la seule mémoire blessée de la guerre d’Algérie qu’il a refusé d’honorer.
Que pensez-vous du dépôt de gerbe effectué ce mardi par l’ambassadeur français en Algérie, sur la stèle rendant hommage à Mouloud Feraoun et ses compagnons ?
Je ne peux pas être insensible à ce qui a été fait pour ces six victimes. Le sacrifice de mon père et de ses compagnons morts pour la défense des valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie n’aura pas été vain. Mais Emmanuel Macron a préféré rendre hommage aux victimes en Algérie…
Attendez-vous un autre geste particulier du président de la République à l’égard des victimes de l’OAS ?
Je n’attends plus rien. Et il n’y aura plus rien. S’il devait y avoir eu quelque chose, cela aurait déjà été fait.
Pourquoi cela n’a pas été fait selon vous ?
Par électoralisme. Dans le Midi, la population des pieds-noirs rapatriés approuve les crimes de l’OAS. La preuve : l’un des membres du commando de l’OAS qui a tué mon père, Gabriel Anglade, a été élu à deux reprises conseiller municipal de Cagnes-sur-Mer en charge des rapatriés. Je suis descendu à Cagnes, j’ai participé à la présence de meetings pour dénoncer la présence d’un tueur de l’OAS au sein de la municipalité. Tout le monde s’en désintéresse…
Les «gestes symboliques» effectués par Emmanuel Macron depuis 2017 visant à «apaiser» les mémoires de la guerre d’Algérie vont-ils, selon vous, dans le bon sens ?
Je ne peux qu’être favorable à l’apaisement des mémoires blessées à la seule condition que ce soit toutes les mémoires blessées. Mais à partir du moment où l’on fait une sélection de ces mémoires, on continue à les diviser. Harkis, Charonne, 26 mars 1962, Européens, 17 octobre 1961… Emmanuel Macron a fait le tour des mémoires. Il en reste une. Pourquoi n’honore-t-il pas celle des civils, militaires, Algériens, Français, magistrats, élus, enseignants, fonctionnaires de police tués par l’OAS ? Les derniers remparts de la République sont les derniers remerciés.
L’Algérie et la France commémorent
l’assassinat de Mouloud Feraoun
et de ses compagnons

Mouloud Feraoun
Le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laid Rebiga, et l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, ont procédé, mardi, au dépôt de deux gerbes de fleurs devant la plaque commémorant l’assassinat, le 15 mars 1962 à Ben-Aknoun (Alger) par l’Organisation de l’armée secrète (OAS), de six enseignants, dont le célèbre écrivain Mouloud Feraoun.
A cette occasion, M. Rebiga a souligné que ce recueillement est une « reconnaissance envers l’un des célèbres auteurs algériens, Mouloud Feraoun, tombé, en compagnie de cinq autres enseignants, sous les balles assassines de la sinistre OAS », rappelant que la ville natale de ce célèbre auteur, Tizi Hibel, abrite des activités commémorant le 60e anniversaire de son assassinat.
De son côté, l’ambassadeur de France a déclaré que « c’était la volonté du Président Macron que je puisse déposer, en son nom, une gerbe de fleurs à la mémoire de ces six enseignants assassinés, le 15 mars 1962, à quelques jours du cessez-le-feu et de la signature des accords d’Evian », qualifiant cet assassinat « d'événement tragique ».
Il a ajouté que sa présence à cette commémoration est « une marque de considération qu’a voulu exprimer le président de la République française en me chargeant de déposer cette gerbe de fleurs au lieu même de cet assassinat ».
Sur les hauteurs d’Alger, à Ben Aknoun, Mouloud Feraoun, auteur de plusieurs ouvrages dont la célèbre trilogie « le fils du pauvre », « les chemins qui montent » et « la terre et le sang » a été assassiné avec cinq de ses compagnons, Ali Hamoutène, Salah Ould Aoudia, Etienne Basset, Robert Aymar et Max Marchands. Ils étaient tous inspecteurs des Centres socio-éducatifs (CSE), des structures créées pour venir en aide aux plus démunis, notamment en assurant des cours d’alphabétisation.
Né en 1913 dans le village de Tizi Hibel (Tizi Ouzou), où il a suivi l’essentiel de sa scolarité, Mouloud Feraoun a été reçu en 1932 au concours d’entrée de l’Ecole normale de Bouzareah à Alger. Diplômé il commence sa carrière d’enseignant et sera nommé instituteur dans son village natal en 1935.
Il a occupé les postes de directeur des cours complémentaires, de directeur de l’école Nador à El Madania, puis celui d’inspecteur des CSE jusqu’à son assassinat, quatre jours avant la signature des accords d’Evian et la proclamation du cessez-le-feu, le 19 mars 1962.
Son journal rédigé à partir de 1955 sera publié à titre posthume sous le titre « Journal 1955-1962 » ainsi que son roman inachevé « L’anniversaire », sorti en 1972 et « La cité des roses » resté inédit jusqu’en 2007.
APS
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 16 Mars 2022 à 07:12
« Hommage à Mouloud Feraoun
et aux victimes de l’OAS » : Communication
de l’ANPROMEVO
Madame, Monsieur,
L'article reproduit ci-après in fine, paru le mardi 15 mars après-midi sur le site Internet du journal "Le Monde", appelle de la part de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS (ANPROMEVO) la communication dont la teneur suit.
Jean-François Gavoury
Président de l'ANPROMEVO- - - - - - - - - -
« Dans une perspective de réconciliation mémorielle inspirée par la recherche de la concorde, de l’apaisement et du respect de toutes les consciences, le Président de la République a passé commande à l'historien Benjamin Stora d'un rapport circonstancié sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
« Au-delà même des préconisations que ce document comporte, il apparaît que le temps est venu de rendre un hommage officiel à toutes ces victimes que l'OAS a frappées jusqu'au plus haut sommet de l'État : parce que ce sont des faits historiques et que l'Histoire doit être connue et transmise sans fard ; parce que c'est le seul moyen de permettre la cicatrisation des plaies qui sont encore ouvertes des deux côtés de la Méditerranée !
« L'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS (ANPROMEVO) prend acte avec satisfaction du geste accompli au nom du chef de l’État par l’ambassadeur de France en Algérie qui, accompagné notamment par le ministre des Moudjahidine, a rendu hommage aux six dirigeants des Centres sociaux éducatifs assassinés par l’OAS sur le lieu même et le jour du soixantième anniversaire de leur assassinat collectif le 15 mars 1962 à El Biar.
« Il s’est agi là, objectivement, d’une nouvelle et significative contribution au réchauffement des relations entre la France et l’Algérie, et l’on peut comprendre, par ailleurs, que l’association statutairement vouée à perpétuer le souvenir de ces six malheureux se soit félicitée de cette initiative.
« Pour sa part, l’ANPROMEVO y a vu un "pas mémoriel" venu s’ajouter à celui effectué le 8 février dans le cadre du soixantième anniversaire de la tragique manifestation parisienne dite de "Charonne".
« Mais c’est un geste plus fort encore que l’association attend du Président de la République le samedi 19 mars et sur lequel elle fonde un ultime espoir : s’impose, en effet, à l’égard des victimes militaires et civiles survivantes et des descendants de victimes tombées sous les coups de l’OAS, un acte premier de reconnaissance officielle équivalent à ceux dont les harkis et les rapatriés d’Algérie ont pu bénéficier depuis des décennies. »

À Alger, la France va rendre hommage
à Mouloud Feraoun et aux victimes
de l’OAS
Emmanuel Macron a demandé à son ambassadeur en Algérie de déposer, mardi 15 mars, une gerbe de fleurs à la mémoire de l’écrivain et instituteur assassiné, il y a soixante ans, par l’Organisation de l’armée secrète.
Par Mustapha Kessous
Un nouveau geste en faveur de la réconciliation des mémoires. Mardi 15 mars, à 15 heures, l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, doit déposer, au nom du président de la République, une gerbe de fleurs en hommage à Mouloud Feraoun et ses cinq compagnons. Il y a soixante ans, jour pour jour, cet écrivain algérien reconnu et instituteur humaniste était froidement assassiné par l’Organisation de l’armée secrète (OAS), dans les hauteurs de la capitale. Pour cette commémoration devant la stèle érigée sur les lieux du drame, M. Gouyette devrait être accompagné de Laïd Rebigua, ministre des moudjahidine et des ayants droit, et d’Abdelmadjid Chikhi, conseiller pour les archives et la mémoire nationale du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
Le 15 mars 1962, à 10 heures, à El Biar, plusieurs dirigeants de centres socio-éducatifs (CSE) s’étaient retrouvés dans un local de Château-Royal, sur la route de Ben Aknoun. En pleine réunion, un commando de l’OAS fit irruption, désigna six inspecteurs de l’éducation nationale – Salah Ould Aoudia, Ali Hammoutene, Mouloud Feraoun, Robert Eymard, Marcel Basset et Max Marchand –, puis les emmena à l’extérieur pour les exécuter à la mitraillette.
A trois jours de la signature des accords d’Evian, qui allait mettre fin à sept ans de guerre entre la puissance coloniale et le Front de libération nationale (FLN), ces crimes avaient suscité un émoi considérable au sein des sociétés française et algérienne. Dans un texte émouvant, la résistante Germaine Tillion – qui avait lancé ces structures, en 1955, pour venir en aide aux plus démunis, en assurant, entre autres, des cours d’alphabétisation – avait souligné que ces victimes « musulmanes » ou « catholiques » avaient « une passion commune : le sauvetage de l’enfance algérienne ». Pour elle, « la bêtise, la féroce bêtise » avait « assassiné » Mouloud Feraoun « froidement, délibérément ».
Une tragédie hautement symbolique
C’est Benjamin Stora qui a proposé à Emmanuel Macron de célébrer le souvenir de l’écrivain kabyle. « Il a tout de suite dit oui, explique l’historien. Mouloud Feraoun était anticolonialiste mais il aimait la France. En le tuant, on a commis un meurtre contre la culture et tenté de détruire la possibilité de passerelle entre la France et l’Algérie. » C’était aussi une demande pressante et de longue date des associations des victimes de l’OAS, comme Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons. « Le sacrifice de mon père et de ses compagnons morts pour la défense des valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie dans une relation fraternelle avec la France n’aura pas été vain », salue Jean-Philippe Ould Aoudia, fils d’une des victimes.
En effet, la tragédie de Château-Royal est hautement symbolique : des Français et des Algériens qui travaillaient ensemble, qui partageaient une amitié et le même idéal, sont morts ensemble. Les centres socio-éducatifs « étaient perçus par l’OAS comme des foyers indépendantistes, et symbolisaient le rapprochement entre les communautés », a souligné l’Elysée dans un communiqué.
Mouloud Feraoun, ami d’Albert Camus et d’Emmanuel Roblès, conteur francophone de la vie berbère, auteur du Fils du pauvre (1950), La Terre et le sang (1953), Jours de Kabylie (1954), a voulu décrire l’autre, le Français, sans le voir nécessairement comme un ennemi. Sans concession sur la guerre d’Algérie, et ses propres sentiments, il a tenu un journal dans lequel il raconte un sanglant conflit au jour le jour, publié à titre posthume aux éditions du Seuil (Journal 1955-1962).
Sur la relation entre la France et l’Algérie, Mouloud Feraoun écrit, lucide :
« La vérité c’est qu’il n’y a pas eu mariage… Les Français sont restés étrangers. Ils croyaient que l’Algérie c’était eux. Maintenant que nous nous estimons assez forts ou que nous les croyons un peu faibles, nous leur disons : non, messieurs, l’Algérie c’est nous… Le mal vient de là. Inutile de chercher ailleurs. Un siècle durant, on s’est coudoyé sans curiosité, il ne reste plus qu’à récolter cette indifférence réfléchie qui est le contraire de l’amour. »
Pour autant, M. Feraoun a su cohabiter entre ses identités multiples, lui le Français d’Algérie, le Kabyle musulman, épris par le patriotisme de son pays, attiré par certaines valeurs de l’occupant. « Au lieu de barrer tout ce qui précède, je me dis : vive la France telle que je l’ai toujours aimée ! Vive l’Algérie telle que je l’espère ! Honte aux criminels ! Honte aux tricheurs ! » Car pour lui seul compte « un impératif désiré par tous, un idéal à atteindre, être libre. Se sentir libéré, l’égal de tous les hommes ».
Après avoir reconnu la responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice Audin, un mathématicien militant de l’indépendance de l’Algérie disparu en 1957 ; dans celle d’Ali Boumendjel, avocat nationaliste algérien « torturé puis assassiné » par les militaires, en pleine bataille d’Alger, en 1957 ; demandé pardon aux harkis ; s’être incliné devant la mémoire des victimes des crimes « inexcusables » du 17 octobre 1961 et rendu hommage aux neuf personnes mortes au métro Charonne, le 8 février 1962, le président Emmanuel Macron poursuit une politique d’apaisement entre deux rives de la Méditerranée en honorant la mémoire de victimes de l’OAS. À quelques jours des 60 ans des accords d’Evian.
Mustapha Kessous
Le point de vue de Jacques CROS
Le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
Publié le 16/03/2022 à 09:39 par cessenon3 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 15 Mars 2022 à 15:53
Algériens, Français : ils racontent
leur guerre d'Algérie


Ils s'appellent Lucien, Bachir, Marie-Claude, Serge, Roger et Djamila. Ils sont Français, Algériens. En 1954, lorsque les "événements" éclatent en Algérie, ils sortent à peine de l'adolescence. L'heure est à la décolonisation un peu partout dans le monde. Ceux que l'on appelle alors les "indigènes" aspirent à mettre fin à 132 ans de colonisation française.
Mais la France ne l'entend pas de cette oreille. Avec plus d'un million d'Européens installés (pour environ 9 millions d'autochtones), l'Algérie est la seule colonie de peuplement de l'empire colonial français. C'est aussi une terre riche en pétrole et en gaz. À partir de 1956, le gouvernement de Guy Mollet décide de recourir à l'armée pour maintenir l'ordre dans ce territoire. Au total, 1,5 million de jeunes appelés français seront envoyés en Algérie pour affronter les fellaghas, ces combattants algériens ayant pris le maquis.
Le 19 mars 1962, lorsque le cessez-le-feu prévu par les accords d'Évian entre en vigueur, 400 000 appelés sont toujours de l'autre côté de la Méditerranée. Leur service militaire a duré 18 mois, parfois même 28 ou 30 mois. Une expérience vécue comme un traumatisme pour nombre d'entre eux. Pendant des décennies, ce qu'ils ont vécu restera tabou – y compris au sein de leurs propres familles.Ci-dessous visualisez une vidéo :
Soixante ans après la fin de cette guerre sans nom (la "guerre" n'a été officiellement reconnue qu'en 1999), ils ont fouillé dans leur mémoire pour nous confier leurs souvenirs. Appelé, compagne d'appelé, harki, soldat de l'Armée de libération nationale (ALN) – bras armé du Front de libération nationale (FLN) – ou membre du FLN, ils nous racontent la colonisation, l'horreur des combats, la torture, la peur mais aussi leur volonté d'apaisement. © Stéphanie Trouillard, France 24
© Stéphanie Trouillard, France 24
85 ans, appelé français, sergent infirmier
"J'avais mon stock de cercueils à gérer"
Lucien Pouëdras est né en 1937, à Languidic, dans le Morbihan, en Bretagne. Ses parents étaient agriculteurs. Lorsqu'il est appelé pour le service militaire, il travaille dans une usine agroalimentaire. Il débarque en Algérie en juillet 1958 au sein du service de santé. Stationné dans un premier temps à Sidi Bel Abbès, dans le nord-ouest, il est ensuite envoyé à Mecheria, l'un des carrefours qui relient le sud algérien à l'Oranie. De retour en France en 1960, il se spécialise dans la gestion d'entreprises et s'installe à Paris. À sa retraite, il se consacre entièrement à la peinture. Artiste reconnu, il a réalisé, en cinquante ans, plus de 400 toiles sur la campagne bretonne.
“En mars 1958, j'ai été appelé pour mon service militaire. Direction Vincennes, en banlieue parisienne, pour mon instruction. J'ai eu quatre mois pour apprendre à manier des armes, puis à faire des pansements et des piqûres au sein du service de santé. Nous avons ensuite été quinze à partir directement pour l'Algérie.
De l'Algérie, je connaissais la carte que j'avais vue pendant mon certificat d'études à l'école primaire comme tout le monde, rien de plus. Je savais aussi que mon père y avait fait son service militaire. En juillet 1958, je suis arrivé à Oran après deux nuits en bateau. C'était un voyage épouvantable, mais le matin, quand on a vu la ville devant nous, c'était extraordinaire. On a embarqué dans des camions pour Sidi Bel Abbès, où se trouvait le siège des légionnaires et le PC de la division médicale. On gérait une centaine de médecins. J'ai appris le traitement des urgences. Je faisais le suivi des blessés, des suicides, des morts et des malades. Il fallait les déclarer tous les jours. C'étaient surtout les embuscades qui faisaient des morts, mais il n'y en avait qu'une vingtaine par mois au début. Il y avait cependant beaucoup de blessés dans des accidents de véhicules ou à cause de mines. Lucien Pouëdras (à droite) en Algérie, au bureau de la direction du service de santé. © Archives Lucien Pouëdras
Lucien Pouëdras (à droite) en Algérie, au bureau de la direction du service de santé. © Archives Lucien PouëdrasÀ la fin de l’année 1959, on nous a descendu à Mecheria où il n’y avait rien, à part une immense plaine désertique. Comme on était loin d'Alger et d'Oran, on s'est retrouvés avec une antenne chirurgicale. Elle comprenait un chirurgien, deux réanimateurs, un anesthésiste, quelques infirmiers et une salle. L'objectif était de pouvoir récupérer tous les blessés, avant de les traiter ou de les expédier vers Oran ou Alger. On gérait les militaires et toute la population civile. C'était plus coriace dans ce secteur. Il n'y avait pas de front ni d'ennemi qu'on pouvait voir. C'était la guérilla. Les militaires circulaient sur des chemins de terre avec des half-tracks, des véhicules blindés. S'ils sautaient sur une mine, cela faisait de gros dégâts. L'explosion créait une vibration. Le temps qu'on les découvre et qu'on les transfère, s'ils étaient déjà dans un état comateux, c'était foutu. Le tibia ou le fémur était découpé comme un saucisson en rondelles. Il fallait souvent amputer des jeunes de 20 ans au niveau du genou. Quand vous voyiez arriver des brûlés, c'était aussi un spectacle que vous ne pouvez pas imaginer. On était obligés de les scier pour les mettre dans le cercueil car les corps étaient figés.
 Un transport de blessés par hélicoptère. © Archives Lucien Pouëdras
Un transport de blessés par hélicoptère. © Archives Lucien PouëdrasMoi, j'étais en bout de ligne. J'ai vu beaucoup de jeunes mourir. J'avais mon stock de cercueils à gérer. Je voyais aussi partir toutes les lettres de condoléances. Mais je voyais aussi des gens qui s'en sortaient. C'était un travail intéressant. Je me sentais utile, mais je savais par contre dans ma tête que c'était inutile de prétendre assimiler cette population. Dès le départ, j'ai eu une bienveillance pour ce pays. Je n'ai jamais cru à l'Algérie française.
 Des enfants d’une tribu pris en photo par Lucien Pouëdras. © Archives Lucien Pouëdras
Des enfants d’une tribu pris en photo par Lucien Pouëdras. © Archives Lucien PouëdrasAujourd'hui si je parle de ma vie, il y a eu des choses importantes comme le fait de se marier ou d'avoir des enfants, mais l'Algérie est un gros morceau. Je suis heureux d'avoir eu cette expérience. Elle est précieuse. Sur l'ensemble de mon séjour, je suis revenu avec des choses positives car je ne me suis jamais retrouvé dans l'ambiance du combat. Je l'ai vécu indirectement. Je n'avais pas d'armes. J'ai fait mon boulot.”
 © Stéphanie Trouillard, France 24
© Stéphanie Trouillard, France 24
85 ans, combattant de l'Armée de libération nationale (ALN)
"La peur de mourir, c'est énorme quand on a 20 ans"
Bachir Hadjadj est né en 1937, à Aïn Touta, près de Batna, dans les Aurès. Son père s'est engagé volontairement pendant la guerre de 1914-1918 au sein des "Turcos", devenus ensuite les "Tirailleurs". Gueule cassée devenu "caïd" (fonctionnaire de la France), il lui a offert une vie "heureuse", loin de "la misère coloniale". À 20 ans, Bachir fait son service militaire sous le drapeau français et se retrouve à servir en Kabylie. Une véritable épreuve qui le poussera deux ans plus tard à rejoindre l'ALN à la frontière tunisienne. En 1972, ses divergences politiques l'amènent à quitter l'Algérie. Pendant des années, il gardera le silence sur "cette humiliation du colonisé, infériorisé chez lui", jusqu'à ce qu'un jour, sa fille lui demande "d'où elle venait". Il en naîtra "Les voleurs de rêves", (éditions Albin Michel), récompensé par le prix Seligmann contre le racisme en 2017.
“J'avais 17 ans quand la guerre d'Algérie a commencé, 26 ans quand elle s'est terminée. J'ai connu le monde colonial. Pour nous Algériens, c'était un monde humiliant, un monde d'inégalités.
À l'école, nos instituteurs n'étaient pas racistes. C'était valorisant de venir apprendre le français aux petits Arabes. Nous, nous étions contents d'apprendre. Il n'y avait aucun cours sur l'Algérie. Elle n'existait pas. J'étais un bon élève. Nous étions différents de nos camarades français. À l'extérieur de l'école, on ne se rencontrait pas, on ne jouait pas au foot ensemble. Ils habitaient dans des villas, nous dans des gourbis [habitation sommaire, NDLR].
Au lycée, on s'apercevait vite que tous les professeurs étaient Français. Seul le prof d'arabe était Arabe. Les Français n'apprenaient pas notre langue alors qu'ils vivaient en Algérie. On n'aimait pas se mélanger. On n'était pas aimés. Bachir Hadjad, en septembre 1949, lors de sa rentrée en 6e avec son père et son frère (à droite). © Archives Bachir Hadjadj
Bachir Hadjad, en septembre 1949, lors de sa rentrée en 6e avec son père et son frère (à droite). © Archives Bachir HadjadjÀ 20 ans, j'ai dû faire le service militaire obligatoire. On était sujets français mais pas citoyens. C'était une catastrophe. Suprême humiliation, on m'a mis chez les chasseurs alpins. Je n'aime ni la neige, ni le froid, je me suis retrouvé sur des skis. On m'a envoyé à Modane, en Savoie. Je suis resté 14 mois en formation. Après, on m'a affecté comme soldat français en Kabylie. Il fallait montrer que les Algériens étaient dans l'armée française. On était une quinzaine sur une centaine de soldats. On avait le même treillis, le même fusil, mais quand ils parlaient entre eux, on était les "bougnoules". Je suis resté une douzaine de mois en tant qu'infirmier. J'étais caporal. J'ai vu la torture. J'ai entendu comment les soldats traitaient les paysans, les encerclements, comment on fouillait les villages, on montrait le sexe de la femme pour voir s'il était rasé (pour savoir si son mari était venu la voir). J'avais de la rancune. Je me suis construit comme ça. On ne naît pas anticolonial, on le devient. Ça a duré 28 mois. J'ai été libéré en septembre 1959.
Après avoir passé mon bac en candidat libre, je suis allé en fac de sciences à Grenoble. Je suis resté six mois, mais je n'accrochais pas. J'ai alors commencé à militer dans une cellule du FLN. Puis, l'ALN a demandé à des étudiants de la rejoindre. Je me suis engagé, sans le dire à mes parents pour ne pas les mettre en danger. Bachir Hadjadj en 1960. © Archives Bachir Hadjadj
Bachir Hadjadj en 1960. © Archives Bachir HadjadjNous sommes arrivés à Ghardimaou, en Tunisie, siège de l'état-major. Nous avons été affectés dans un camp d'instruction et répartis dans les bataillons. Entre la Tunisie et l'Algérie, il y avait un barrage électrifié qui empêchait que l'ALN n'envoie des troupes : 50000 volts dans la journée, 200 000 la nuit. Il y avait une double haie de barbelés sur 600 km. Quelqu'un qui passait la première ne pouvait pas atteindre la deuxième. Entre les deux se trouvait une piste où il y avait des patrouilles de chars, de mitrailleuses, des mines... c'était horrible.
C'était la ligne Morice. Les combats, c'était dans ce no man's land. Les Algériens avaient une quarantaine de bataillons de 400 à 600 hommes. Notre travail consistait à exercer une pression maximum sur le barrage pour obliger les Français à mettre des soldats. On leur rendait la vie impossible. C'était du harcèlement. J'ai fait ça une quinzaine de mois.
C'était très dur physiquement parce que les équipements étaient rudimentaires. On avait des fusils Mauser allemands. On avait une chemise, un pull, une casquette, un treillis qu'on gardait cinq, six mois, des sous-vêtements. Un change dans le sac, une serviette. Un jour, j'ai vu des poux sous la chemise. J'étais affolé. Ça grouillait de partout. Je me suis jeté dans la rivière glacée mais il y en avait tout autant. On nous donnait du DDT, mais les poux s'y habituaient. On mangeait un demi-pain par jour, une boîte de sardines à deux ou une boîte de confiture.
Je suis resté sur le barrage jusqu'à la veille du cessez-le-feu du 19 mars. La conviction était là mais la peur de mourir, c'est énorme quand on a 20 ans. J'ai perdu des amis. Ils étaient mieux armés, mieux préparés. Ils avaient des officiers qui avaient fait des écoles de guerre. Mon chef ne savait ni lire ni écrire. Il avait juste envie d'en découdre. Bachir Hadjadj en octobre 1962. © Archives Bachir Hadjadj
Bachir Hadjadj en octobre 1962. © Archives Bachir HadjadjLe 19 mars 1962, j'étais content que la guerre soit finie. On a été soulagés à l'indépendance. Les combattants stationnés à la frontière voulaient rentrer. L'ALN voulait tout de suite occuper Alger pour prendre le pouvoir. De Gaulle s'y est opposé. J'ai donc quitté le barrage début septembre. J'avais un ordre de mission pour entrer en Algérie. Ça m'a fait tout drôle quand le chauffeur m'a dit "mon lieutenant". Je n'étais pas habitué à ça.
On s'est arrêtés près d'un village et le chauffeur s'est mis à crier "le salaud, le salaud". Il m'a expliqué qu'on envoyait des harkis [Algériens combattant avec l'armée française, NDLR] dans les champs de mines pour qu'ils déminent. Je me rappelle cet homme recroquevillé. On tirait à côté de lui pour qu'il bouge. C'était atroce.
Je suis rentré à Sétif, l'Algérie était déjà sens dessus dessous. Pendant la guerre de libération nationale, pour assoir son autorité, le FLN interdisait de fumer, d'aller au cinéma. Il y avait un sentiment de religiosité. Le peuple algérien tenait à la religion, c'était sa forteresse pendant la colonisation. Mais on ne s'est pas battus pour ça. Je ne suis pas un moudjahid, je suis un combattant de la liberté.” © Famille Briand
© Famille Briand
84 ans, femme d'appelé français
"J'ai compris que j'arrivais en enfer"
Marie-Claude Briand est née en 1938, à Blaye, en Gironde. Elle rencontre son futur époux, Pierre, au lycée. Quatre ans plus tard, ils se marient. Alors qu’il poursuit ses études à Paris, elle commence à travailler dans un bureau d'études à Montrouge, au sud de la capitale. En novembre 1960, Pierre doit finalement partir pour son service militaire. Dix mois plus tard, il est envoyé en Algérie. Marie-Claude décide de le rejoindre. Elle le retrouve en novembre 1961 à Constantine, où elle décroche un emploi de secrétaire. Elle découvre alors la guerre et assiste à plusieurs attentats. Après l'indépendance, le couple reste en Algérie, où naîtront leurs deux enfants, et y travaille pendant cinq ans. Marie-Claude a rédigé ses mémoires d'Algérie pour sa famille.
“La guerre d'Algérie était un peu une épée de Damoclès. Nous espérions toujours qu'elle se termine, mais j'avais dit à mon mari que si elle continuait et qu'il était appelé, n'ayant pas d'enfant, je le suivrai. Dans ma ville natale, je connaissais un jeune homme qui avait été appelé et qui avait été tué. Cela m'avait profondément marquée et c'est là que j'ai pris ma décision. S'il ne nous restait que quelques temps à vivre ensemble, il fallait prendre ce risque.
Je suis partie le 5 novembre 1961 à Constantine, en avion. L'un des rares passagers, intrigué par ma présence et ma jeunesse, m'a demandé ce que je partais faire. Il m'a prodigué des conseils de prudence et de réserve. Surtout ne pas donner d'opinions personnelles et éviter de révéler le statut de mon mari, ce qui aurait pu être dangereux. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait une ambiance de guerre. J'ai vu les pancartes percées par les impacts de balle et les rouleaux de barbelés sur la route. J'ai compris que j'arrivais en enfer.
Mon mari avait une permission permanente donc nous pouvions loger ensemble. Nous avions trouvé des colocataires. Ils nous avaient alertés sur les plastiquages quasi-quotidiens vers 20 h-21 h. Dès le premier soir, alors que j'étais debout dans la chambre, il y a eu une première détonation. J'ai cru que la maison allait exploser. Je me suis précipitée de l'autre côté de la pièce pour me jeter dans les bras de mon mari. Il y a eu un deuxième plastiquage à ce moment-là. Cela a été le baptême du feu, j'ai tout de suite été mise dans l'ambiance. Marie-Claude Briand et son mari, Pierre, à Constantine, dans le nord-est algérien, en 1962. © Archives famille Briand
Marie-Claude Briand et son mari, Pierre, à Constantine, dans le nord-est algérien, en 1962. © Archives famille BriandLe lendemain, j'ai commencé à travailler. J'ai observé, j'ai écouté et je n'ai pas donné d'opinions personnelles. C'était très difficile, il y avait des souffrances de tous les côtés. Devant mon silence et ma neutralité, les langues commençaient à se délier. J'entendais mes collègues parler des "événements" et des attentats. Cela m'a permis de mieux comprendre et de reconstituer le puzzle qui m'entourait. Il y avait des Algériens, des pieds-noirs [Français d'Afrique du Nord, NDLR], des juifs, des musulmans, des catholiques. Tout cela était une découverte sur le terrain. Je n'avais pas d'a priori.
Un jour en partant travailler, en descendant le boulevard Victor Hugo, j'ai vu que le salon de coiffure avait été complètement détruit par une grenade. En continuant mon chemin, j'ai vu qu'une grenade avait aussi été lancée dans la boutique du marchand de beignets. C'était une vision dramatique. Il y avait des restes de corps humain par terre. Cela a été la panique dans ma tête. Le plastiquage d’un véhicule à Constantine. © Archives famille Briand
Le plastiquage d’un véhicule à Constantine. © Archives famille BriandJe suis arrivée place Béhagle, devant la société où je travaillais. Tous les employés étaient regroupés dehors. J'ai compris qu'il y avait un danger latent. Sur le trottoir d'en face, un commando de l'OAS [organisation opposée à l'indépendance, NDLR], avec trois Français, nous observait et attendait qu'on entre dans le magasin. À ce moment précis, notre patron est arrivé en voiture et nous lui avons expliqué ce qui était arrivé sur le boulevard Victor Hugo. Il nous a dit de rentrer chez nous et de nous faire accompagner. Un homme nous a ramenées, en voiture. En remontant le boulevard, il y avait une ambiance de peur. J'ai aperçu deux Français avec un fusil dont de la fumée sortait du canon. Nous avons alors croisé un Algérien qui avait été atteint à la gorge et qui titubait. J'ai complètement paniqué. J'ai compris que la guerre était quelque chose d'épouvantable.
Quelques mois plus tard, le 19 mars 1962, il y a eu le cessez-le-feu. On se disait qu'on se dirigeait enfin vers le dénouement qu'on attendait depuis des années. Ce jour-là, il y a quand même eu un événement qui m'a marquée. Un jeune qui travaillait dans notre société a été tué. Son beau-père avait voulu faire une course alors que c'était le jour où tout devait s'arrêter et où chacun devait rester dans son camp. Son gendre a voulu l'en dissuader, connaissant les risques, mais il a insisté. Il l'a finalement accompagné. Ils ont été mitraillés par le FLN au détour d'un carrefour. J'ai compris que tout n'était pas fini dans les têtes, qu'il y avait encore de la souffrance et un besoin de se venger. Le jour de l'indépendance est arrivé en juillet. Les Français ne sont pas sortis dans la rue. Beaucoup étaient déjà partis en métropole. Avec un couple d'amis, j'étais la seule à me retrouver dehors au milieu de tous ces Algériens qui fêtaient l'indépendance. J'ai saisi l'occasion pour prendre des photos. Il y avait une foule immense. Les Algériens célèbrent leur indépendance, le 5 juillet 1962 à Constantine. © Archives famille Briand
Les Algériens célèbrent leur indépendance, le 5 juillet 1962 à Constantine. © Archives famille BriandNous sommes ensuite restés pendant cinq ans dans ce pays que nous aimions. Les habitants n'ont pas montré de sentiments agressifs à notre égard. Je me suis toujours sentie en confiance. Je n'ai aucun regret car j'ai beaucoup appris, même si j'ai toujours très peur de la guerre et des armes. La haine s'est heureusement dissipée aujourd'hui, mais il y a de part et d'autre des personnes qui ont souffert. Si l'on veut maintenir l'esprit des gens dans la paix, il faut un discours d'apaisement. Il faut toujours essayer de comprendre l'autre qui est différent de soi. La méconnaissance entraîne la peur et engendre la haine.”
 © Stéphanie Trouillard, France 24
© Stéphanie Trouillard, France 24
84 ans, harki, supplétif engagé dans l'armée française
"On enterrait certains des nôtres qui étaient encore vivants"
Serge Carel est né en 1937 dans la région de Boghari, au sud d'Alger. Son père était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire, devenu ensuite garde forestier dans l'administration française. À 20 ans, en 1957, il s'engage comme harki, du nom de ces Algériens qui combattent dans l'armée française. Comme il parle très bien la langue, il devient interprète. En juillet 1962, il est arrêté et torturé par le FLN. Le jeune homme réussit à s'échapper après avoir subi plusieurs semaines de torture. Soigné en cachette, il embarque pour la France et refait sa vie. Il entre à la Brink's, où il fera toute sa carrière. Il se bat depuis de nombreuses années pour la reconnaissance officielle par la France de l'abandon et du massacre des harkis. En 2021, il se voit élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
“J'ai grandi avec l'idée de servir la France. Dans notre famille, on l'a toujours aimée et on lui reste fidèle. En Algérie, on vivait entre musulmans, juifs, chrétiens. On s'entendait en parfaite harmonie, mais dès le début des "événements", le 1er novembre 1954, il y a eu une séparation. On ne se fréquentait plus comme avant. Serge Carel aux côtés de ses frères, sa sœur et son père. © Archives Serge Carel
Serge Carel aux côtés de ses frères, sa sœur et son père. © Archives Serge CarelOn a commencé à entendre que des gens avaient été égorgés et que des militaires avaient été tués. Un jour, en 1957, un ami nous a réunis avec d'autres copains pour nous demander de rejoindre le maquis. J'ai passé une nuit blanche. Je ne voulais pas trahir mes parents qui avaient toujours été profrançais et je ne voulais pas trahir la France qui nous avait tout donné, alors j'ai décidé de devenir harki. Je ne l'ai dit à personne et j'ai quitté ma région car je ne voulais pas me retrouver un jour face à mes amis. Cela m'aurait fait beaucoup de mal de leur tirer dessus ou vice versa. Je suis donc parti en Kabylie, où je me suis engagé.
Un capitaine m'a posé quelques questions. Il était intéressé car je parlais le français et parce qu'il cherchait quelqu'un pour servir d'interprète. J'ai tout de suite été pris. On allait dans les djebels à pied ou bien par hélicoptère. On était dans une région montagneuse et escarpée. On s'est retrouvés sur le champ de bataille. Il y avait des embuscades et on ripostait. Il y avait des morts de part et d'autre. On avait toujours peur car l'ennemi était toujours caché quelque part.
Dans chaque harka [milice supplétive], il y avait à peu près une quinzaine de militaires métropolitains pour nous aider – et aussi pour nous surveiller. Certains harkis ont pris la fuite avec des armes pour rejoindre le FLN. Il y avait toujours une méfiance. Mais ils n'étaient pas méchants avec nous. Ils étaient respectueux, même si les harkis effectuaient le travail et que les officiers étaient décorés à notre place. On était toujours aux avant-postes car on connaissait le terrain, alors qu'eux étaient complètement paumés avec leurs cartes.
Un jour, un 24 décembre, on est descendus dans un village avec une quinzaine d'hommes car on était invités au régiment d'infanterie coloniale pour le réveillon. Il y avait parmi eux Nordine Bouazza, le frère de Djamila Bouazza, celle qui avait lancé des bombes à la cafétéria du Coq Hardi, à Alger. Il était opérateur radio. Tout d'un coup, on a entendu tirer. Un fellagha était caché. Nordine a décidé d'y aller. Il a fait deux pas et il a reçu une balle dans l'œil. On a appelé un hélicoptère pour le transporter, mais c'était trop tard. Nordine me serrait fort la main car la mort approchait. C'est un événement qui m'a particulièrement marqué car c'était mon ami. Quelques heures plus tard, vers 1 h du matin, on a entendu un déluge de feu. Ordre du commandant. Ce n'était pas bien. C'était une vengeance sur des villageois qui n'avaient rien fait. Cela m'a choqué. Des harkis pris en photo par Serge Carel au cours de la guerre. © Archives Serge Carel
Des harkis pris en photo par Serge Carel au cours de la guerre. © Archives Serge CarelUne fois que les accords d'Évian ont été signés, on a commencé à se poser des questions. Dans le village où j'étais, les gens ont manifesté avec un drapeau algérien. Notre capitaine s'est mis au garde-à-vous. C'est là que j'ai compris que c'était fini pour nous, mais je ne savais pas qu'on allait être désarmés et laissés à notre triste sort. Finalement, chacun est parti de son côté. Le FLN a alors saisi l'occasion. Ils ont commencé à arrêter, torturer et exécuter tous ceux qui avaient travaillé pour la France, surtout les harkis. J'ai été fait prisonnier trois jours après l'indépendance, le 8 juillet 1962, à Tizi Ouzou. Toutes les issues de la ville étaient bouclées. J'étais recherché. J'ai pris un taxi pour essayer d'aller à Alger, mais des officiers du FLN m'ont reconnu. Ils m'ont fait descendre et ils m'ont attaché les mains derrière le dos. Ils m'ont emmené dans le village où j'avais été basé. Tout le monde m'attendait. Il y avait un soleil de plomb. C'était l'enfer. La population s'est acharnée sur moi avec des crachats, des coups et des jets de pierre, même des gens à qui j'avais rendu d'énormes services.
Ils m'ont ensuite emmené dans une salle où il y avait au moins une cinquantaine de harkis. Il y avait du sang par terre et des gens blessés un peu partout. Ils m'ont conduit dans une autre salle où ils m'ont déshabillé et où ils m'ont torturé au courant, 120 volts. Je n'étais peut-être pas complètement dans le coma, mais presque. C'était tous les jours comme cela, chacun son tour. Je demandais à mourir. Un jour, j'avais soif et j'ai tiré la langue. Ils m'ont filé un coup de jus dessus. J'avais du pus partout dans la bouche et je ne pouvais plus rien avaler. Ils nous faisaient aussi creuser des tombes. Parfois, on enterrait certains des nôtres qui étaient encore vivants. D'autres étaient jetés dans la rivière. Serge Carel en 1962, avant son arrestation par le FLN. © Archives Serge Carel
Serge Carel en 1962, avant son arrestation par le FLN. © Archives Serge CarelAu bout de trois mois, je me suis retrouvé un soir avec un combattant du FLN qui ne me faisait pas de mal. C'était le fils d’un couple que j'avais aidé à libérer quand ce dernier avait été arrêté par l'armée française. Il m'a dit d'essayer de fuir car j'avais sauvé ses parents. J'ai tenté ma chance. J'étais dans un état lamentable, un déchet humain. J'ai réussi à aller jusque chez un ami et je lui ai demandé de m'emmener à Alger. J'ai été accueilli chez ma tante qui s'est occupée de moi. J'ai réussi à me faire soigner et à obtenir une autorisation de sortie d'Algérie pour aller passer des vacances en France avec une fausse identité. Avant de monter dans le bateau, j'ai commencé à trembler. C'était un billet sans retour. Je suis monté sur le pont et je me suis dit que plus jamais je ne retournerai dans ce pays qui m'a torturé. Je suis finalement arrivé le 1er août 1964 à Paris, en chemise et en pantalon. J'avais tout perdu.
De cette période, il me reste l'horreur. C'était une guerre sans nom qui n'aurait pas dû exister. Mais je ne regrette pas d'avoir servi la France, parce que c'est mon pays et que je l'aime. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai jamais abandonné mes frères d'armes. Les lâches, ce sont ceux qui nous ont abandonnés.” © DR
© DR
84 ans, appelé ayant rejoint le FLN
"Je ne pouvais pas tuer quelqu'un"
Roger Winterhalter est né en 1938 à Lutterbach, en Alsace. Son père, résistant sous l'occupation allemande, lui a appris à dire non à la guerre. D'abord sursitaire, il a 22 ans quand il est appelé sous les drapeaux. Il restera 27 mois en Algérie. La violence de la société coloniale, le "mépris" pour les Algériens le poussent à rejoindre le FLN tout en restant au sein de l'armée française. En 2012, lorsqu'il raconte son histoire pour la première fois dans "Si c’était à refaire" (éditions Le Manuscrit), il est accusé d'avoir trahi la France. Malgré les insultes et les menaces de mort, il ne regrette rien et rappelle qu'il s'est battu pour la paix et qu'il n'a jamais eu de sang sur les mains.
“Quand la guerre a éclaté, j'étais sursitaire. Je faisais des études de comptabilité. Je jouais au football et j'allais de bal en bal. Je voulais faire la fête et oublier cette Algérie qui m'attendait. Et puis ça m'est tombé dessus : 27 mois en Algérie. J'avais 22 ans. C'est la seule fois de ma vie que je me suis soûlé.
Je suis arrivé à Philippeville, en Algérie [aujourd'hui Skikda, NDLR], en janvier 1960. On avait voyagé sur le bateau El Djazaïr. On était en fond de cale, les gens vomissaient. C'était affreux. Quand on a débarqué, on nous a fait tout de suite monter dans un train. On est arrivés à Constantine et de là, à Telergma, où je suis resté jusqu'à la fin de mon service. C'était un centre de formation et un régiment disciplinaire. Je n'ai jamais su pourquoi, je n'avais rien fait.
Il y avait une sacrée faune : des types qui avaient tué, volé. Il y avait aussi un certain nombre d'intellectuels qui m'ont initié à ce qu'était la guerre d'Algérie, la politique. Quand on m'a donné un fusil, je n'ai pas mis de balles. Je ne pouvais tuer quelqu'un. J'ai vu des gens diminués, méprisés. Je les appelais "les Algériens" mais pour les autres, c'étaient des "bougnoules", des "bicots". Ils avaient perdu leur dignité, on ne les respectait plus. J'ai compris très vite qu'on n'était pas là pour rétablir l'ordre, mais pour semer plutôt le désordre. Je me suis demandé pourquoi j'étais là.
Le camp était horrible. Il s'appelait Hadjar, pour certains c'était le camp de la mort. C'était sale, la nourriture n'était pas bonne. J'ai vu la transformation des gens au bout de quelques jours, semaines. Ils devenaient voraces, ils volaient les vêtements qui séchaient. C'était terrible. Roger Winterhalter en Algérie. © Archives Roger Winterhalter
Roger Winterhalter en Algérie. © Archives Roger WinterhalterJ'étais dans un régiment de tirailleurs algériens, il y avait les FSNA (Français de souche nord-africaine) et nous, les FSE (Français de souche européenne). C'était moitié moitié. J'ai lié des amitiés très solides. Je ne voulais pas aller dans les troupes de choc, le 7e régiment des tirailleurs, qui allaient au contact. J'ai été mis aux effectifs. On remplissait des fiches, tenait les livrets militaires à jour. On avait des fiches d'incorporation. On suivait les soldats du début jusqu'à la fin. Mais le plus important, c'était les affectations.
Le 9 juillet 1961, il y a eu une manifestation à Telergma. Il y avait un millier de personnes, des femmes, des enfants. Il y avait des youyous. Ils disaient "Vive l'indépendance", "À bas le colonialisme". Notre colonel était devant. Il a demandé aux troupes de lancer des grenades sur la foule. Mais c'étaient des jeunes appelés. Ils ne savaient pas que quand on dégoupille une grenade, on compte jusqu'à six ou onze, et ensuite on la lance. La foule a repris les grenades et les a lancées sur les tirailleurs. Il y a eu quelques blessés. Le colonel a alors demandé de tirer avec la mitrailleuse 12,7 de l’half-track [véhicule semi-chenillé et blindé, NDLR]. Il y a eu plus de 50 morts. Ils les ont ramassés dans des brouettes. Je suis rentré profondément choqué, remué. J'ai demandé à un copain, Mahfoud : "Comment tu fais pour être dans cette armée ?" La ville de Telergma en 1960. © Archives Roger Winterhalter
La ville de Telergma en 1960. © Archives Roger WinterhalterIl m'a invité à le rejoindre dans une chambre après le couvre-feu. Ils étaient cinq ou six. Ils m'ont appris qu'ils faisaient partie d'une section du FLN constituée au sein de l'armée française. C'était l'une des rares, voire la seule. Ils m'ont dit parlé de leur lutte, de leur combat. Ils m'ont proposé de faire partie de la section. J'ai dit spontanément oui parce que j'étais libéré. J'allais participer à l'indépendance de l'Algérie. J'ai tout de suite posé une limite. Mon exigence, c'était qu'il n'y ait jamais un attentat meurtrier dans notre région.
C'est là que j'ai "trahi" la France. Tous les deux ou quatre mois, je faisais quelque chose pour le FLN. L'ALN me donnait entre trois et cinq noms d'intellectuels qui faisaient de la contre-propagande. Je devais les affecter à tel ou tel régiment. Jamais personne n'a vérifié. J'imitais la signature du colonel. C'était mon travail essentiel. On n'avait pas besoin de prendre les armes. Ça aidait les Algériens.
J'avais aussi compris que les Algériens qui avaient fait un service civil d'un an ou deux dans l'armée pouvaient être libérés immédiatement. Ça comptait pour le service militaire mais ça n'a jamais été appliqué. On a libéré légalement des dizaines de personnes qui venaient à peine d'arriver. On a aussi organisé la désertion de 19 personnes. C'était un exploit. Enfin, quand l'ALN a été touchée par une épidémie de variole, nous avons volé des vaccins pour tout l'est constantinois.
C'était une aventure passionnante, excitante. Ce peuple était devenu mon peuple. Je savais qu'on risquait d'être fusillés si on était attrapés. Mais on savait qu'on allait gagner, que l'Algérie allait devenir indépendante. Mon combat, c'était pour la justice. C'était pour le respect de ces personnes, contre la guerre et pour la paix. Je suis devenu un pacifiste. Je suis Alsacien, je suis Français, je suis Algérien. Je suis vraiment fier de mon engagement. Ça a fait de moi un homme, un militant. Mon père a été extrêmement fier de moi. Mais c'était trop pour lui. Il a eu tellement peur qu'on me fusille, qu'il est mort deux ans après ma libération. Roger Winterhalter au régiment de Telergma. © Archives Roger Winterhalter
Roger Winterhalter au régiment de Telergma. © Archives Roger WinterhalterLe 19 mars 1962, j'étais déjà rentré en France depuis un mois. J'étais au cinéma quand un copain m'a appelé. Ça m'a fait frissonner. Je ne parlais que de l'Algérie depuis mon retour. J'avais les larmes aux yeux. Je voulais repartir le plus vite possible, donner un coup de main pour l'indépendance. Mais je me suis marié rapidement et ma femme ne voulait pas y aller.
Ensuite, Ben Bella a été mis en prison – je rêvais de devenir son collaborateur – et je n'ai pas supporté. J'y suis retourné pour la première fois en 1967 avec ma femme et mes enfants. J'ai senti que je ne pouvais pas rester, que je risquais de finir en taule. J'ai des contacts permanents avec mes compagnons. Ils sont mes frères : Mahfoud, Ahmed.
Ce que j'avais fait, je n'en parlais pas. Seuls mes proches étaient au courant. C'est quand l'un de mes compagnons est décédé que j'ai écrit. C'était pour lui. Si j'avais su que les réactions seraient aussi violentes, je ne l'aurais pas sorti, ce livre. J'ai reçu des lettres d'insultes, des menaces de mort, la plupart anonymes. J'ai compris que des sections entières d'anciens combattants avaient participé à ce harcèlement. J'ai écrit au préfet pour qu'on me protège. Il n'y avait pas de raison qu'on me condamne alors que les généraux de l'OAS [Organisation de l’armée secrète, opposée à l'indépendance, NDLR] ont été amnistiés. Il n'y a pas de quoi être fier de ce qu'on a fait pendant la guerre d'Algérie. On a tué, torturé, manqué de respect aux femmes. On n'en parle pas de ça. Combien ont assisté à des viols individuels et collectifs ?
À ceux qui me condamnent, je réponds que je me suis engagé pour que ces hommes et ces femmes retrouvent leur dignité, deviennent acteurs de leurs vies. Je me suis engagé pour la paix. J'ai essayé de faire ce que je pensais être juste. Je me respecte.” © Assiya Hamza, France 24
© Assiya Hamza, France 24
87 ans, agent de liaison du FLN en France
"J'ai même transporté des armes dans la poussette de mon fils"
Djamila Amrane est née en 1934 à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Son père est arrivé en France en 1914 pour travailler en tant que chauffeur de chaudière dans une usine de savon à Aubervilliers. Fille unique, mariée très jeune, c'est après un voyage en Algérie, au tout début de la guerre, que naît son militantisme pour l'indépendance. Recrutée comme agent de liaison par le FLN en France, elle a aussi récolté de l'argent pour financer le maquis et convoyé des armes dissimulées dans une poussette. Aujourd'hui, elle continue à s'engager pour les femmes et contre le racisme au sein de l'association Africa, à La Courneuve.
“J'étais encore jeune quand la guerre a éclaté. Je n'avais pas la notion de ce qui se passait en Algérie. Mes parents n'en parlaient pas du tout. Mon père était très fusionnel avec moi. Ils ont essayé de me protéger au maximum. Je ne sentais aucune différence avec les Français, j'étais bien intégrée à l'école. Je n'ai pas ressenti le racisme à l'adolescence, pourtant nous étions les seuls Algériens de notre quartier. Malheureusement, ou heureusement, je n'étais pas typée. Je passais partout. Je n'avais jamais de remarque comme "sale bicot" ou "bougnoule". Je l'ai entendu, mais ça ne me concernait pas.
Quand la guerre d'Algérie a commencé, les gens ne comprenaient pas pourquoi on voulait notre indépendance. Ils se demandaient ce qu'était cette guerre. Il ne faut pas oublier que la France venait de subir la guerre de 1940, l'occupation allemande. Ils avaient peur de revivre la même chose. Une femme voilée et son enfant, sous le regard d'un soldat français, dans une rue d'Alger, le 12 décembre 1960. © AFP
Une femme voilée et son enfant, sous le regard d'un soldat français, dans une rue d'Alger, le 12 décembre 1960. © AFPJ'ai été mariée très jeune. En 1954 ou 1955, je suis partie en Algérie faire connaissance avec ma belle-famille. À Alger, ma première vision était les gamins cireurs de chaussures. Je ne voyais aucun Algérien à la sortie des écoles. Je me suis demandé pourquoi j'avais eu le droit d'aller à l'école et pas eux. Les indigènes n'y allaient pas. Ça a été un choc. J'ai senti un mur entre la France, les Français d'Algérie et les Algériens. J'ai ressenti une grande tristesse. L'esclavage avait beau être fini depuis longtemps, j'avais l'impression qu'il était là sous une autre forme. J'étais révoltée à l’intérieur. Pourquoi moi j'avais eu le droit et pas eux ? Je voulais faire quelque chose pour que ces filles et ces garçons aillent à l'école.
Je ne pensais pas à faire la guerre. C'est à ce moment-là que le Front de libération nationale a commencé à organiser un réseau en France. Lorsqu'on m'a proposé de participer à la libération de l'Algérie, j'ai tout de suite dit oui. J'ai été nommée agent de liaison. Je participais à des réunions, je collectais l'argent pour le maquis, j'informais les femmes. En France, on était dans notre cocon. On ne savait pas ce qui se passait en Algérie. J'étais désormais dans cette guerre. J'ai même transporté des armes dans la poussette de mon fils.
Je n'avais pas peur. Au contraire. On me disait que j'étais une vraie guerrière et qu'on pouvait compter sur moi. Il m'est arrivé de passer devant des policiers qui me faisaient des grands sourires. Je devais être invisible. Jusqu'au jour où j'ai été dénoncée. La police est venue nous arrêter, mon mari et moi. Ils ont trouvé des armes à la maison. Il a été envoyé quelques jours à Fresnes, puis dans le camp du Larzac jusqu'à l'indépendance.
J'ai été interrogée pendant plus de 24 h au commissariat. J'ai été bousculée, tapée mais j'ai résisté. Ça n'a pas été facile. Mais je n'ai rien divulgué malgré les pressions. À l'époque, j'étais en relation directe avec deux personnes qui étaient très recherchées. Dans les groupes, on ne se côtoyait pas pour éviter de donner des informations si on était arrêtés. Il faut savoir que quand on les arrêtait, c'était l'eau, l'électricité loin des regards. C'est abominable ce qu'ils pouvaient faire. Du côté de Gambetta, il y avait ce qu'on appelait "la piscine". Je ne veux pas repenser à ça. C'est tellement horrible.
Je n'avais pas peur de ce qu'on allait me faire, mais seulement de ne plus revoir mes cinq enfants. Pour eux, c'était surtout mon mari qui était au FLN. J'ai été relâchée parce qu'il m'a protégée et dit que je n'étais au courant de rien. Peut-être aussi parce que j'avais des enfants. Parfois, je me dis que je n'étais pas très raisonnable de jouer les casse-cou avec des enfants. On avait cette foi, ce courage parce qu'on était sûrs qu'on allait y arriver.
Dès l'indépendance, il a fallu qu'on quitte le territoire. On a été mis sur un bateau et on est arrivés le 5 juillet à Alger. Je n'oublierai jamais ce moment. Tout le monde était sur les toits des camions, des bus, des taxis. Il y avait des youyous. Le drapeau algérien flottait partout. On avait gagné, on n'avait pas fait ça pour rien. Même si on a eu beaucoup de morts, on est allés au bout pour ce si beau drapeau. Rentrée des classes à l'école de la Basse Casbah à Alger, le 15 octobre 1962. © AFP
Rentrée des classes à l'école de la Basse Casbah à Alger, le 15 octobre 1962. © AFPOn m'a demandé d'être institutrice. J'ai fait cette révolution à cause de l'école et je me suis retrouvée à enseigner. La boucle était bouclée. J'avais 40 élèves dans chaque classe. Quelle joie ! J'ai enseigné une dizaine d'années. Je suis rentrée en France en 1975. Mon fils était très malade. Le médecin m'avait dit que le climat d'Alger n’était pas bon pour lui.
Aujourd'hui, aucune de mes actions ne m'impressionne. Je dois être un peu kamikaze. Je suis prête à recommencer pour une autre cause. Tout ce qui concerne la liberté me touche.” 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 15 Mars 2022 à 09:51
Communiqué de l’Elysée

Le président de la République a chargé l’Ambassadeur de France en Algérie de déposer une gerbe de fleurs au pied de la plaque commémorative à Château Royal, à El Biar.

Communiqué de Jean-Philippe Ould Aoudia

Enterrement au cimetière d’El Alia, le 19 mars 1962, des victimes de l’assassinat de Château-Royal par l’OAS. © Keystone-France/Gamma Rapho
L’Algérie et la France rendent hommage aux 6 dirigeants des Centres Sociaux Educatifs assassinés par l’OAS le 15 mars 1962 à Alger.
Au nom du président de la République française une gerbe de fleurs sera déposée par l’ambassadeur de France en Algérie, au pied du mur criblé de balles, sous la stèle où les six fonctionnaires des Centres Sociaux Educatifs ont été assassinés. L’ambassadeur de France en Algérie sera accompagné par le ministre algérien des Anciens Combattants et aussi par le conseiller mémoire du président de la République algérienne.
Le sacrifice de mon père et de ses compagnons morts pour la défense des valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie dans une relation fraternelle avec la France n’aura pas été vain.
Jean-Philippe Ould Aoudia
L’association
communique
Ce mardi 15 mars 2022, un hommage sera rendu aux six dirigeants des Centres sociaux éducatifs massacrés il y a soixante ans, le 15 mars 1962, à Alger, par l’OAS.
La cérémonie se déroulera à 9 heures précises, devant la plaque commémorative apposée au siège du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, 101 rue de Grenelle, Paris 8è.
Seront présents :
-Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, et son chef de cabinet ;
-des représentants du Monde combattant ;
-le représentant de Madame la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La levée de la limitation du nombre de participants permet aux personnes qui le veulent de s’inscrire rapidement auprès de :
Jean-Philippe Ould Aoudia
06 85 40 44 16

 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 14 Mars 2022 à 09:07
Henri Pouillot, militant anticolonialiste
répond au quotidien algérien L’Expression
« Si la France avait reconnu… »

L’auteur du livre «Torture en Algérie, un appelé parle»
Henri Pouillot est témoin de la guerre de Libération nationale, comme appelé entre juin 1961 et mars 1962. Il est l'auteur du livre Tortures en Algérie, un appelé parle (juin 1961-mars 1962).
L'Expression : Appelé de l'armée française en Algérie, entre juin 1961 et mars 1962, vous avez dénoncé dans votre livre - Torture en Algérie, un appelé parle - les pires atrocités commises contre les Algériens par l'armée française. Comment avez-vous vécu la signature des accords d'Évian ?
Henri Pouillot : J'avais quitté la villa Susini le 13 mars 1962 pour rentrer en France. D'Alger, nous sommes partis en convoi spécial jusqu'à Oran, compte tenu des conditions d'insécurité pour prendre le bateau pour la France. Il y avait une très grosse tempête et nous avons longé la côte algérienne, marocaine, puis espagnole jusqu'à Marseille. Ce devait être le dernier voyage de ce vieux bateau. La traversée a duré presque 2 jours, à fond de cale. C'est là que j'ai passé mon anniversaire, j'étais malade, comme tous les camarades, mais tellement heureux de quitter l'Algérie et cet enfer... Après une nuit inconfortable à la caserne de Marseille, nous avons pris le train (un train spécial réservé pour les militaires rapatriés) à destination de Sissonne. À l'époque, il n'y avait ni Internet ni réseaux sociaux : les seules informations presque instantanées qui pouvaient être diffusées l'étaient par radio, et les transistors étaient très rares. Un appelé en disposait un et a entendu ce message que les accords d'Évian venaient d'être signés. Ce fut une explosion de joie indescriptible : tout le monde s'embrassait, chantait, criait. Même si je ne fus libéré de mes obligations militaires que 4 mois plus tard, ce cessez-le-feu, fut un formidable soulagement et un immense espoir pour le peuple algérien qui avait payé un si lourd tribut pendant cette guerre.Le général de Gaulle s'était opposé aux partisans de l'Algérie française et avait échappé à plusieurs attentats de l'OAS. Pourriez-vous revenir sur ces événements avec force détails en tant que soldat de l'armée française en Algérie, sachant que 60 ans après les accords d'Évian, la guerre d'Algérie continue à hanter les mémoires, notamment chez l'extrême droite française ? Pourquoi cette nostalgie qui s'éternise encore ?
De Gaulle avait été acclamé par l'armée et par la population pieds-noirs d'Algérie quand il est revenu au pouvoir : sa déclaration, à Alger, « Je vous ai compris » avait été un formidable espoir, assez rapidement déçu, dès qu'il a été évoqué la possibilité d'une autodétermination pour le peuple algérien. Pour les militaires de carrière, dont beaucoup avaient une grande nostalgie d'avoir subi une terrible défaite en Indochine quelques années plus tôt, il n'était pas question « d'abandonner » l'Algérie. Les pieds-noirs, même si dans leur très grande majorité n'étaient pas de riches colons, bénéficiaient d'un prestige, fondé sur un concept raciste. Le « second collège » constituait une catégorie de sous-citoyens : ces musulmans algériens (même s'ils n'étaient pas très pratiquants de leur religion). Tout l'enjeu idéologique, c'était le colonialisme fondé sur le racisme. Très rapidement, une convergence s'est établie entre la majorité des pieds-noirs et les militaires de carrière. N'oublions pas que Jean-Marie Le Pen, fin 1956, alors qu'il venait d'être élu député sur une liste poujadiste (courant d'extrême droite) démissionna, selon sa formule d'alors, devenue célèbre, pour « aller casser du Bougnoule ». Cela se concrétisa avec les barricades d'Alger en janvier 1960, et dans la foulée la constitution de l'OAS, puis le putsch d'avril 1961. Pour l'essentiel, c'est grâce aux réactions des appelés qui s'y sont massivement opposés que le putsch échoua. L'OAS n'a jamais accepté le cessez-le-feu. Malgré la fin des colonies françaises, dans les années 1960 (Indochine puis Algérie, suivi de Madagascar, du Cameroun, et des pays africains Sénégal, Mali...), avec souvent des dizaines de milliers de morts peu connus, la nostalgie du colonialisme ne s'est pas éteinte spontanément : la Françafrique n'est pas encore complètement abandonnée. À partir de la fin de l'année 2000, avec le témoignage de Louisette Ighilahriz un débat s'est ouvert en France autour de l'histoire de la guerre de Libération de l'Algérie. Cette nostalgie du colonialisme s'est concrétisée avec la loi du 23 février 2005, qui en est la démonstration : son article 4 (supprimé par la suite, compte tenu des nombreuses réactions d'opposition) demandait aux enseignants d'inculquer le « rôle positif de la colonisation ».
Le racisme, en France, garde de profondes racines de son passé colonial, tout particulièrement l'islamophobie. Les attentats perpétrés par des adeptes d'un islamisme radical, ont certainement eu un impact sur ce type de réaction, et l'extrême droite a beaucoup instrumentalisé cet aspect.
Jusqu'en 2000, en France, il n'y avait qu'une quinzaine de rues, de monuments commémorant l'Algérie française ou des responsables de l'OAS, maintenant il y en a une bonne centaine. Ces nostalgiques de l'Algérie française, de l'OAS en sont un terreau très favorable.Il y a de nombreux groupes de mémoires très puissants en France : appelés de l'armée en Algérie, Européens d'Algérie, harkis et émigrés d'Algérie en France, 60 ans après les accords d'Évian chacun se renferme dans son rapport avec son propre passé. N'y a-t-il pas là une communautarisation des mémoires ?
Il n'est pas anormal que des catégories de personnes ayant eu un passé quasi identique, parfois douloureux, se retrouvent plus facilement pour évoquer ces années de souffrance. Surtout par rapport au passé de cette période de la guerre de Libération de l'Algérie, alors que tout a été fait pour éviter de reconnaître les responsabilités, en débattre. Ces douleurs ne s'effacent pas avec le temps. Si l'État français avait officiellement reconnu sa responsabilité dans les crimes commis en son nom et les avait condamnés, les références au passé auraient permis d'être plus apaisées. Si un débat, sans tabou, avait pu avoir lieu, nul doute que cette nostalgie aurait évolué très différemment. Cette échéance de 60 ans, pèse sur ceux qui ont vécu cette période, à la fin de leur vie, ils en souffrent. Les héritiers de ces acteurs ressentent, sans pouvoir les comprendre les souffrances subies, et évitent les débats sur ces questions. Ceux, plus jeunes, ignorent souvent l'essentiel : l'histoire enseignée sur cette période a longtemps été muette, ou minimisée. Pour les appelés, la question des traumatismes subis (en particulier psychologiques) n'a pas été reconnue. La question des harkis, très complexe du fait du recrutement très hétérogène, n'a pas été réglée comme elle aurait dû l'être. Ils étaient nombreux à se retrouver, avec leur famille, dans des conditions indignes, inhumaines, et même la « régularisation » qui vient d'être tentée, il y a quelques mois, n'est pas satisfaisante. Les pieds-noirs, à leur entrée en métropole ont parfois été assez mal accueillis. Partis, pour la plupart de rien, ils ont eu beaucoup de mal à retrouver une situation sociale acceptable, souvent largement dégradée par rapport à leur situation en Algérie. Il a fallu attendre la loi de 2005 pour qu'une aide leur soit enfin accordée. Les Algériens de souche souffrent toujours de racisme, de discriminations...
Depuis la première commémoration officielle des accords d'Évian par François Hollande en 2015, nous avons assisté à des réactions acerbes à commencer par celle de Nicolas Sarkozy suivie par d'autres nostalgiques de l'Algérie française. Cela ne constitue-t-il pas une rente mémorielle du côté français ?
Dans la mesure où il a fallu attendre 1999 (37 ans) pour reconnaître qu'il s'agissait d'une guerre et non pas d'évènements et d'opérations de maintien de l'ordre, il ne faut pas s'étonner que les interprétations aient été diverses et que la clarté ne se soit pas manifestée. Cela a empêché de trancher clairement le passé de cette douloureuse période des différentes communautés.Le général de Gaulle s'était opposé aux partisans de l'Algérie française et avait échappé à plusieurs attentats de l'OAS. Pourriez-vous revenir sur ses événements avec force détails ?
Le général de Gaulle qui avait compris que l'Algérie ne pouvait pas rester française, mais qui voulait que la France puisse exploiter le pétrole algérien et réaliser ses essais nucléaires au Sahara, s'est donc naturellement trouvé en conflit total avec les partisans de l'Algérie française et de l'OAS. Cette organisation terroriste avait planifié deux attentats contre lui en Région parisienne, alors qu'il rejoignait, avec son épouse, sa résidence personnelle de Colombey-les-Deux-Églises. Le premier le 8 septembre 1961 à Pont-sur- Seine, le second le 22 août 1962 au Petit-Clamart. Dans les deux cas, il s'en est sorti indemne.
60 ans après les accords d'Évian, la guerre d'Algérie continue-t-elle dans les mémoires notamment auprès de l'extrême droite française ? Pourquoi cette nostalgie française qui s'éternise encore ?
Je serais tenté de dire que les mémoires relatives à la guerre de Libération de l'Algérie se sont considérablement estompées, mais que, avec l'approche du 60e anniversaire du cessez-le-feu une instrumentalisation en a été faite, en particulier, logiquement par l'extrême droite, mais aussi par le pouvoir en place. L'extrême droite continue « naturellement » de cultiver ce racisme, culture du colonialisme.
Mais depuis un an le macronisme a décidé d'instrumentaliser ce 60e anniversaire, qui coïncide avec la campagne électorale de la présidentielle. Ce fut la commande du rapport de Benjamin Stora qui, certes comporte un certain nombre de points positifs, comme, en particulier, le rôle de la colonisation, mais en occulte un certain nombre de points très importants : le rôle, l'importance de l'OAS, la responsabilité de la France dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'État commis en son nom et leur condamnation.Certes, le président Macron a reconnu l'assassinat de Maurice Audin sous la torture, puis celui d'Ali Boumendjel, mais pourquoi pas celui de Larbi Ben M'hidi assassiné dans les mêmes conditions ?
Les exécutions sommaires (corvées de bois, crevettes Bigeard...), la torture, les viols, les villages rasés au napalm (entre 600 et 800, donc plus de 100 000 victimes civiles) les camps d'internement pudiquement appelés de regroupement (plus de 200 000 victimes civiles selon le rapport officiel de Michel Rocard réalisé avant la fin de la guerre), l'utilisation du gaz Vx et Sarin, les essais nucléaires... commis au nom de la France, n'ont toujours pas été reconnus et condamnés par l'Etat Français: il serait plus que temps!!! Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est permis de falsifier gravement l'histoire, en particulier le 26 janvier dernier en évoquant la fusillade du 26 mars 1962 à Alger. Il a considéré que le 4e RTA était seul responsable de la fusillade des manifestants de l'OAS : il a « oublié » d'évoquer qu'un commando de l'OAS était juché sur les toits et balcons et avait ouvert le feu sur la troupe. Cette falsification ne peut s'expliquer que par une volonté de récupérer des voix zémouriennes et lepénistes aux prochaines élections. Une telle expression de la part d'un président de la République, donnant une version officielle mais volontairement fausse parce que tronquée est un scandale inacceptable. (1) Il y avait déjà eu un précédent, le 26 mars dernier, avec le dépôt d'une gerbe au mémorial du Quai Branly, en son nom, par sa ministre : la première fois qu'un président de la République osait une telle provocation. Ce président, par cette presque « réhabilitation » de l'OAS, semble donc oublier son caractère terroriste, fascisant, qui n'avait pas hésité à mettre en cause la République française par un putsch et les tentatives d'assassinat de son président de la République d'alors. Nul doute que l'instrumentalisation de cet anniversaire n'est pas terminée, même si l'actualité, avec la Russie et l'Ukraine, va mettre au second plan ce débat. Il est urgent et indispensable que la France reconnaisse et condamne sa responsabilité dans les crimes commis en son nom à cette période-là. C'est une démarche indispensable pour que des relations apaisées, ouvrant à un traité d'amitié, de coopération entre nos deux pays qui ont un tel passé commun puisse voir le jour.(1) HONTE à vous m. MACRON

Dépôt d'une gerbe, au nom du Président de la République, aux victimes du 26 Mars 1962, rue d'Isly… Sans doute l’OAS n’a pas existé pour M. Macron ?
EN PRESENCE DE :
MME DARRIEUSSECQ - MINISTRE DéLéGUéE AUPRES DE LA MINISTRE DES ARMéES CHARGéE DE LA MéMOIRE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
DU VICE-PRESIDENT DE l’ASSEMBLéE NATIONALE
DU MAIRE ADJOINT à LA MAIRIE DE PARIS
DE MADAME PEAUCELLE-DELELIS DIRECTRICE GéNERALE DE L’ONAC-VG
Inacceptable vidéo pour les victimes de l’OAS mise en ligne uniquement dans un but d’information... nous n'oublierons jamais m. MACRON CAR VOUS AVEZ occulté la criminelle et terroriste oas responsable de ce drame...
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 13 Mars 2022 à 08:45
ATTENTION le documentaire en 5 épisodes que France 2 vous propose de voir lundi 14 et mardi 15 mars est tronqué pourquoi ?

Parce qu’écrit et réalisé par deux pieds-noirs il fait la part trop belle aux pieds-noirs, oubliant les appelés du contingent, occultant l’OAS et ses 2700 victimes, négligeant aussi et surtout les 450000 à 1 million 500000 (suivant les sources) victimes algériennes. A titre personnel je vous conseille de ne pas perdre votre temps à regarder ce documentaire beaucoup trop orienté politiquement puisqu’il montre trop la nostalgie coloniale. Oui M. Stora enterre la guerre d’Algérie mais aussi son rapport remis à M. Macron qui est maintenant devenu sans éclat ni sans lendemain.
Violences coloniales, Benjamin Stora coupable de « révisionnisme »

Dans la presse algérienne les historiens et les intellectuels critiquent avec des arguments pertinents le rapport Stora sur la mémoire de la guerre d’Algérie, notamment cette fausse symétrie qui, sans les hiérarchiser, stigmatise autant les violences commises du côté algérien que celles perpétrées du côté français. Mondafrique reprend quelques extraits des deux contributions éclairantes. Celle de l’historien … Lire la suite de Violences coloniales, Benjamin Stora coupable de « révisionnisme »
Quant à M. Macron les seules paroles justes qu’il a prononcées, c’est en 2017, en Algérie, alors qu’il était candidat à la présidence de la République : « La colonisation est un crime contre l’humanité » Maintenant il fait sans cesse un pas en avant et deux pas en arrière.
Michel Dandelot
Lundi soir, France 2 et Benjamin Stora enterrent la guerre d’Algérie

Paresseux et tronqué, le documentaire co-écrit par Benjamin Stora à l’occasion des soixante ans de la fin de la guerre d’Algérie fait surtout la part belle aux pieds-noirs. À l’opposé de l’excellent documentaire d’Arte en six épisodes produit par Arte (VOIR MON ARTICLE :
C’était la guerre d’Algérie, un film de Georges-Marc Benamou, écrit avec Benjamin Stora, 5×52 min, sur France 2, les 14 et 15 mars 2022
Une chronique de Frédéric Pascal
Pendant des années, « France Télévisions » a rechigné à faire de la guerre d’Algérie un sujet d’exploration pour ses documentaires. Matière trop inflammable, sujet trop sensible, les caciques de la télévision française préféraient se repaître d’innombrables films sur la Seconde guerre Mondiale. Cette période de l’Histoire de France ne présente en effet que des avantages pour des diffuseurs qui ne veulent pas prendre trop de risques avec leur autorité de tutelle. La dernière Guerre en effet est un terrain de jeu manichéen parfaitement balisé avec méchants (les nazis) d’un côté et des gentils (les résistants) de l’autre, un sujet peu propice aux polémiques.
Quelques dérisoire crispations pétainisto-zemmouristes pimentent le tout et l’audience est généralement au rendez-vous auprès d’un public vieillissant.

Trop souvent les combattants algériens ont été juste oubliés dans les documentaires produits en France sur la guerre d’Algérie
Une mémoire franco-française
Ces dernières années, quelques projets de grande qualité comme La guerre des appelés (2019) de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman, avaient pourtant commencé à ouvrir la brèche d’un traitement documentaire de la guerre d’Algérie sur les antennes françaises. Mais s’il mettait en scène d’anciens troufions traumatisés par les crimes de guerre perpétrés de chaque côté, ce film ne présentait, comme son titre l’indique qu’une mémoire franco-française, aussi humaniste fut-elle.
À l’occasion du soixantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, les antennes publiques ont enfin décidé de franchir le pas et de consacrer deux soirées exceptionnelles à l’évènement avec une longue fresque historique en cinq parties. Un film « sans tabou et à hauteur d’hommes » comme proclame le dossier de presse, censé servir de référence, sinon historique, tout du moins télévisuelle. Un documentaire écrit par deux sommités des salons parisiens : l’écrivain-journaliste et « en même temps » ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Georges-Marc Benamou ; l’historien reconnu de l’histoire de la guerre d’Algérie devenu le proche et conseiller de l’ombre de tous les pouvoirs élyséens, Benjamin Stora.
Le rapport Stora sans éclat ni lendemains
Historien réputé devenu le conseiller et l’ami des Présidents successifs, notamment Hollande et Macron, Benjaminn Stora est le gage d’une facture politiquement correcte sur un sujet hyper sensible à un mois de la Présidentielle française. Entre une exposition sans éclat à l’IMA et un voyage avec le Président de la République, le même est l’auteur d’un rapport sans lendemain sur les relations France-Algérie. Il s’agissait d’une commande du président Macron pour tenter d’habiller un rapprochement entre Paris et Alger qui n’a, hélas, jamais eu lieu.
Bref, aux manettes du film, un attelage œcuménique d’habitués de la Cour, taillé pour retranscrire fidèlement ce qu’il faut penser du conflit de ce côté-ci de la Méditerranée. A ceci près que ces auteurs présentent la caractéristique d’être tous les deux pieds-noirs et que dès les premières minutes du film, à contre-courant de l’équilibre des points de vue, vanté par les auteurs dans leur note d’intention. Il affleure inévitablement une certaine nostalgie coloniale qui restera le fil conducteur principal de cette fresque couvrant la période 1830-1962.
Une nostalgie coloniale
L’histoire que le duo Stora-Benamou raconte pendant plus de quatre heures, est donc celle d’un pays de cocagne, saboté par des extrémistes, forcément extrémistes. D’un côté, le lobby des « gros colons » qui bloque systématiquement toutes les tentatives de reformes humanistes avant-guerre comme le plan Blum-Violette, qui laissent la place aux ultras de l’Algérie française ; de l’autre les agitateurs indépendantistes qui s’échinent à faire capoter tout compromis plus consensuel.
Le tout sous le regard navré d’un Albert Camus militant de la cause pied-noir et – en même temps – apôtre de la non-violence, érigé en grande conscience du film, alors même que l’écrivain s’était muré dans le silence dès que le début de guerre d’Indépendance, sujet dudit film. Bref…

Le film donne à voir une profusion d’images comme celle-ci où l’on voit le général de Gaulle à Alger, mais hélas sans point de vue clair ni véritable articulation
Ses grands témoins très « people »
Pour le reste, le film oscille entre une chronique politique et militaire, précise, du conflit et celle, plus évanescente, du ressenti de la population. On passe de l’embuscade de Palestro (16 morts français) à la Bataille d’Alger, de l’attentat du car de Biskra au dynamitage du Milk Bar, de la semaine des barricades au putsh d’Alger. Le tout dans un tourbillon sans grandes articulations.
Malheureusement, les entretiens réalisés pour le film n’apportent guère d’éclairage pertinent sur ces enchaînements, tant nombre de témoins sollicités aujourd’hui semblent avoir été choisis plus pour leur célébrité (Cédric Villani, Yasmina Reza, Pierre Joxe) que pour leur pertinence. On a affaire plus à des experts qu’à de véritables témoins. Parmi les quelques rares entretiens qui sonnent juste, les récits tout en sensibilité de Nicole Garcia et les sentiments ambivalents de Slimane Zeghidour, écrivain élevé dans un camp de déplacés qui, enfant, avait du mal à comprendre la figure du soldat français. Pourquoi ce dernier, se demandait-il, tuait des Algériens et faisait la classe aux enfants de ceux-ci ?
Les autres témoignages sont issus pour la plupart d’archives d’anciennes interviews déjà données à la télévision par des protagonistes des événements dans les années 70 ou 80. En exprimant une vérité datée, ils privent le film de la résonnance actuelle que les promoteurs du film assurent pourtant avoir cherché.

Les fondateurs de « l’organisation spéciale », ancêtre du FLN
« L’Orient compliqué de l’Algérie » !
Formellement, cet opus paresseux de la guerre d’Algérie rate également largement sa cible. Le commentaire est lu de façon théâtrale par Benoît Magimel et jalonné de poncifs ridicules (« L’Orient compliqué de l’Algérie » !). Les archives plaquées sans grande pertinence, traitées comme de simples illustrations, sans interroger leur pertinence, reprises en longueur et sans contextualisation, vagues recyclages de vieux reportages de « Cinq Colonnes à la Une ».
Ce qui était annoncé comme une somme définitive bénéficiant de soixante ans de recul et d’analyse, permettant de mettre fin aux ambiguïtés du conflit, se révèle être, en réalité, un pensum long comme un cours d’histoire-géo de ZEP dans les années 80, dispensé par un enseignant médiocre à l’aube de la retraite.
En creux, le film montre par contre assez bien, combien dans les antichambres des Palais nationaux, l’histoire de la guerre d’Algérie a toujours du mal à passer. Il faudra peut-être encore quarante années supplémentaires pour digérer ce bain de sang sans aigreur d’estomac.
Source : Lundi soir, France 2 et Benjamin Stora enterrent la guerre d’Algérie - Mondafrique 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 11 Mars 2022 à 13:12
Il y a soixante ans : un crime impuni de l’OAS
Le crime de Château-Royal à Alger

Le 15 mars 1962, six dirigeants des Centres
sociaux éducatifs d’Algérie sont tués
par un commando de l’OAS

Par Jean-Philippe Ould Aoudia Fils de l’une des victimes, auteur de L’assassinat de Château-Royal, Alger, 15 mars 1962, Éditions Tirésias
Après un siècle de colonisation et à la veille de la guerre d’indépendance, 80% des enfants que l’on appelle alors « indigènes » ne sont toujours pas scolarisés. C’est pour (tenter de) pallier cette incroyable incapacité que, le 27 octobre 1955, sont créés les Centres sociaux éducatifs (CSE), à l’initiative de Germaine Tillion, déportée-résistante, membre du cabinet civil du gouverneur général Soustelle. Progressivement, les animateurs des centres vont faire de leurs locaux, dans des villages dépourvus de tout, des lieux d’apprentissage, doublés de centres de soins infirmiers, où de surcroît les enfants au ventre creux dès le matin pouvaient boire du lait.
La guerre de libération nationale qui éclate le 1er novembre 1954 constitue un défi pour l’armée française qui sort de la défaite de Diên Biên Phu, le 7 mai 1954 au Vietnam. Les officiers, certains faits prisonniers par ceux qu’ils appellent avec mépris les « Viets », y ont appris le rôle essentiel tenu par la population dans la guerre dite « subversive ». C’est en partie pourquoi le succès des CSE auprès des musulmans est vu par l’armée comme une connivence entre le personnel du service et le FLN. Pour ces esprits bornés, nourris par une haine inexpiable, tout ce qui assure au peuple algérien un minimum de bien-être (et de dignité) est à détruire.
Des unités de centurions (c’est l’expression employée par l’écrivain militaire Jean Lartéguy) vont exprimer leur hostilité contre un service dont le fonctionnement reste pourtant conforme aux grandes traditions de l’Éducation nationale française. Le 15 octobre 1956, une série d’enlèvements par les parachutistes frappe le personnel algérien et français, femmes et hommes qui seront tous torturés. Le journal d’extrême droite Aux écoutes titre : « Tentatives de subversion dans les Centres sociaux ». Cette affaire est montée de toute pièce par les services « psychologiques » de l’armée à seule fin de stigmatiser les Centres. Le 16 décembre 1960, lors d’une audience au procès dit des Barricades, le tribunal permet à des officiers supérieurs de tenir des propos diffamatoires contre un service de l’Éducation nationale, totalement étranger à l’affaire jugée.
Début 1961, à Madrid, en terre franquiste, les plus fanatiques partisans de l’Algérie française fondent l’Organisation armée secrète (OAS), dont le sigle va bientôt semer la terreur. L’OAS est une structure associant des civils ayant déjà la pratique du meurtre de sang-froid et des déserteurs des unités parachutistes ayant participé au putsch raté d’avril 1961 (le « quarteron de généraux en retraite »). Ils entendent conserver l’Algérie française « à l’ancienne » par le terrorisme des deux côtés de la Méditerranée. Pendant les 16 derniers mois de la guerre d’Algérie, ils feront régner un climat de terreur et de guerre civile. Ce groupement ultra violent a à sa tête le putschiste Salan, qui rédige fin février 1962 une instruction aux chefs des commandos de la mort : « …Il faut s’attaquer aux personnalités intellectuelles musulmanes…Chaque fois qu’un de ceux-ci sera soupçonné de sympathie (et je dis bien « soupçonné » et « sympathie ») à l’égard du FLN il devra être abattu ». Les animateurs des Centres sociaux figurent sur la liste des « ennemis ».
Le jeudi 15 mars 1962, aux informations de 13 heures, est annoncée « une effroyable tuerie de l’OAS à Alger » : six dirigeants des Centres sociaux éducatifs avaient été collectivement massacrés sur leur lieu de travail et dans l’exercice de leur mission d’enseignement. On a bien lu : 15 mars, soit trois jours avant les accords d’Évian, quatre jours avant le cessez-le-feu.
La tuerie du15 mars 1962 par un commando de l’OAS (delta 5 et 7), est donc le passage à l’acte sanglant du lobby politico militaire qui veut dicter sa loi en Algérie. Les victimes ont noms Marcel Basset, ancien du réseau de résistance « Voix du Nord », Robert Eymard, Mouloud Feraoun, écrivain de langue française le plus connu de son époque, Grand Prix littéraire de la ville d’Alger (1950), Ali Hammoutène, Max Marchand inspecteur d’académie chef du service, Grand Prix littéraire de l’Algérie (1957), Salah Henri Ould Aoudia, oncle de maître Amokrane Ould Aoudia, assassiné par les services secrets français le 23 mai 1959 à Paris pour avoir dénoncé la torture à Paris.
Lundi 19 mars, à 11 heures, dans tous les établissements scolaires, un hommage était rendu aux six victimes comportant la lecture d’un message du ministre de l’Éducation nationale, suivie de l’observation d’une minute de silence.
Il n’y eut pas d’enquête pour découvrir les meurtriers qui sont aujourd’hui connus.
L’un d’eux, Gabriel Anglade, a été élu conseiller municipal de Cagnes-sur-mer, chargé des rapatriés, sur une liste de droite. À son enterrement il eut droit à un éloge au cours duquel sa participation au massacre de six fonctionnaires de l’Éducation nationale le 15 mars 1962 fut porté à son crédit.
Ainsi va la mémoire de la « Nostalgérie ».
Dans quelques jours viendra le triste anniversaire de cette tuerie. Le président Macron, qui a alterné les actes positifs et les compromissions en matière mémorielle, aura-t-il un mot sur ce massacre d’hommes de bonne volonté ?
Alain Ruscio a co-dirigé et co-signé cet article avec son ami très cher Jean-Philippe Ould-Aoudia précisant que cet article a été mis en ligne, ce matin, dans L’Humanité.
« Nous attendons un geste mémoriel de la part du président en hommage aux victimes de l’OAS, qui sont au nombre de 2 700 » écrit Jean-François Gavoury président de l’ANPROMEVO. M. le Président Macron vous avez une nouvelle occasion de faire ce geste le 15 mars prochain.
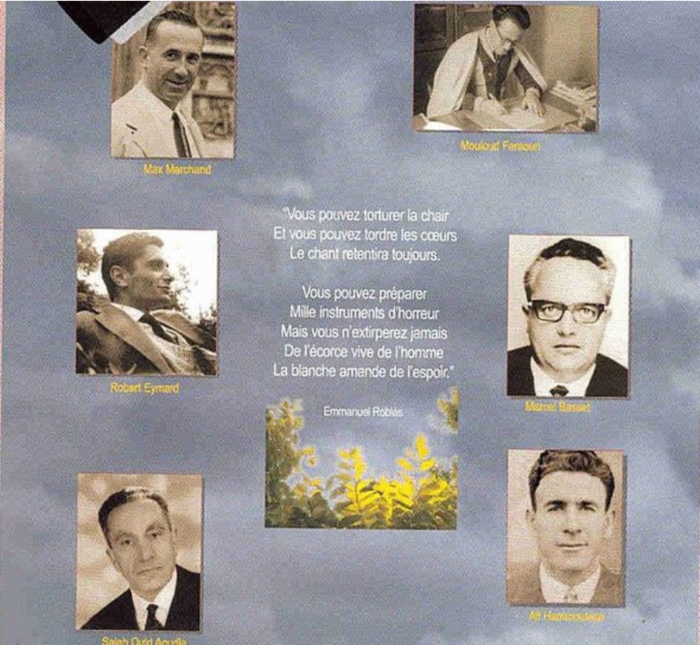
Le 15 mars 1962 : les 6 victimes
de Château-Royal ont été assassinées
par les terroristes fascistes de l’OAS
Marcel Basset ; Mouloud Feraoun ; Ali Hammoutene ; Max Marchand ; Salah Ould Aoudia ; Robert Eymard. Ces noms et ces visages que nous ne voulons pas, que nous ne pouvons pas oublier.
Ils étaient fonctionnaires de l’Éducation nationale. Au départ, instituteurs, inspecteurs de l’enseignement primaire, directeur d’école ou de cours complémentaire. L’un d’eux était aussi écrivain. Passionnés par l’enseignement, animés par un idéal de justice et de partage, ils avaient rejoint, pour certains dès le tout début, les CSE, ces centres sociaux éducatifs créés en 1955 par Germaine Tillion. Ils étaient devenus les principaux responsables de cette structure directement rattachée à l’Éducation nationale. Ils avaient rang d’inspecteur.
Marcel Basset, né le 3 septembre 1922 à Foulquières-lès-Lens (Pas-de Calais), ancien résistant, gaulliste, son engagement dans les CSE correspond à son idéal.
Mouloud Feraoun, né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel (Grande Kabylie), très bon élève. Grâce à l’obtention d’une bourse pour poursuivre ses études à l’école normale de La Bouzarea (Alger), il devint instituteur et non berger. Il fut le premier Algérien nommé directeur d’un Cours Complémentaire à Fort-National (LArbaaâ Nath Irathen). À la suite de menaces par des militaires activistes, il fut nommé à l’école Nador du Clos-Salembier, un des quartiers les plus pauvres d’Alger. Il intégra les CSE en 1960 comme directeur-adjoint, chargé d’une mission d’inspection sur l’ensemble du territoire algérien.
Ali Hammoutene, né le 16 décembre 1917 à Tizi Ouzou (Kabylie) dans une famille pauvre. Boursier, élève de l’école normale de La Bouzarea (Alger), il fut instituteur, puis passa à Paris le concours d’inspecteur primaire et devint directeur-adjoint des CSE.
Max Marchand, né le 16 février 1911 à Montaure (Eure), brillant élève, école normale d’Évreux, instituteur en Normandie, inspecteur primaire à Oran, inspecteur d’Académie à Bône (Annaba) et à Alger, puis directeur des CSE.
Salah Ould Aoudia, né le 8 novembre 1908 à Ouaghzen (Kabylie), où il n’y a pas d’école publique. Il fut éduqué par les Pères Blancs et devint instituteur. Directeur d’un CSE dès leur création, il devint inspecteur des CSE pour la région Alger-Est.
Robert Eymard était le chef du bureau d’études pédagogiques.
Plus on approchait de la signature des accords d’Évian, qui signeraient sa défaite, plus l’OAS, pratiquant la politique de la terre brûlée, multipliait les attentats. Or, depuis leurs débuts, les centres sociaux étaient très mal perçus par les milieux conservateurs algériens, dont l’hostilité augmentait en proportion de l’enthousiasme de la population :
« Un centre social, dans ce pays en guerre, c’est un havre de paix, un endroit où on retrouve un peu d’espoir. Ceux qui ont faim peuvent même y trouver un peu de lait, les directeurs ayant pris l’initiative de donner à manger à leurs élèves qui leur avouaient venir au cours le ventre vide ! »
Les CSE furent soupçonnés d’être des nids de sympathisants ou de membres du FLN. Arrestations arbitraires, mauvais traitements et tortures, leurs employés payèrent un lourd tribut à la politique de «maintien de l’ordre» telle que la concevaient les autorités civiles et militaires de l’époque. Il y eut aussi des titres mensongers en première page des quotidiens les plus lus par la population «européenne», dont le but était de nuire aux CSE en accroissant l’hostilité à leur égard et en justifiant les actions menées contre eux. Chacun de ces six hommes se savait personnellement menacé.
Cinq mois auparavant, Max Marchand avait échappé de justesse à la bombe qui fit s’écrouler l’immeuble de l’inspection académique où il résidait. En février 1962, lors d’un stage à Marly-le-Roi, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutene, Salah Ould Aoudia rencontrèrent, avec d’autres stagiaires des CSE, le conseiller du général de Gaulle pour les Affaires algériennes. Ils lui firent part de leurs inquiétudes sur la situation en Algérie, surtout dans les grandes villes. Bernard Tricot, qui n’ignorait pas le danger auquel ces fonctionnaires étaient exposés, leur demanda de regagner leur poste afin «de travailler coûte que coûte pour empêcher l’OAS d’établir le chaos ». Max Marchand avait profité de ce séjour pour tenter d’obtenir sa mutation à l’inspection académique de Belfort, qui venait d’être créée. Mais ce poste fut attribué à quelqu’un qui ne l’avait même pas sollicité. Rencontrant un collègue à sa sortie du cabinet du ministre, Max Marchand lui dit : « On a promis de me nommer en France, en juin, mais je n’atteindrai pas juin : ils auront ma peau avant. »
Le 15 mars 1962, les responsables des CSE sont venus, parfois de loin, à Château-Royal, un domaine d’El-Biar sur les hauteurs d’Alger où se trouvaient l’École normale de jeunes filles d’Alger, les bureaux et le siège des CSE, ainsi que ceux d’autres services de l’Éducation nationale et quelques logements de fonction, pour participer à la réunion organisée par Max Marchand. Malgré les précautions prises, l’OAS, au courant de cette réunion, avait décidé de frapper les imaginations en assassinant six d’entre eux, dont les noms soigneusement choisis figuraient sur une liste établie à l’avance.
Personne ne sera jamais arrêté ou inculpé pour ce sextuple assassinat. Et pourtant ! On a su assez vite qu’il était l’œuvre des tristement fameux commandos Delta dirigés par Roger Degueldre. Ce dernier a été reconnu par un témoin, sur photos. Mais s’il a été condamné et exécuté, c’est pour d’autres crimes que celui-là : arrêté le 7 avril 1962, il a été condamné à mort par arrêt de la Cour de justice militaire en date du 28 juin 1962, pour une série de plusieurs dizaines de crimes et délits commis jusqu’au 11 octobre 1961…
Grâce aux amnisties successives, ceux qui sont aujourd’hui encore vivants peuvent sans crainte raconter leur participation à ce massacre et, pourquoi pas ? en tirer gloire dans certains milieux. C’est ce qu’a fait Gabriel Anglade. Il s’est en particulier vanté auprès d’un historien américain, Alexander Harrison, d’avoir été celui qui, ce jour-là, avait tué Mouloud Feraoun, en donnant une version par ailleurs maquillée de l’événement.
Au cours de la nuit qui suivit cet assassinat

Germaine Tillion a écrit le texte suivant qui est
paru dans Le Monde du 18 mars 1962.
La bêtise qui froidement assassine
"Mouloud Feraoun était un écrivain de grande race, un homme fier et modeste à la fois, mais quand je pense à lui, le premier mot qui me vient aux lèvres c’est le mot : bonté...
C’était un vieil ami qui ne passait jamais à Paris sans venir me voir. J’aimais sa conversation passionnante, pleine d’humour, d’images, toujours au plus près du réel - mais à l’intérieur de chaque événement décrit il y avait toujours comme une petite lampe qui brillait tout doucement : son amour de la vie, des êtres, son refus de croire à la totale méchanceté des hommes et du destin.
Certes, il souffrait plus que quiconque de cette guerre fratricide, certes, il était inquiet pour ses six enfants - mais, dans les jours les plus noirs, il continuait à espérer que le bon sens serait finalement plus fort que la bêtise...
Et la bêtise, la féroce bêtise l’a tué. Non pas tué : assassiné. Froidement, délibérément ! ...
Cet honnête homme, cet homme bon, cet homme qui n’avait jamais fait de tort à quiconque, qui avait dévoué sa vie au bien public, qui était l’un des plus grands écrivains de l’Algérie, a été assassiné... Non pas par hasard, non pas par erreur, mais appelé par son nom, tué par préférence, et cet homme qui croyait à l’humanité a gémi et agonisé quatre heures - non pas par la faute d’un microbe, d’un frein qui casse, d’un des mille accidents qui guettent nos vies, mais parce que cela entrait dans les calculs imbéciles des singes sanglants qui font la loi à Alger...
Entre l’écrivain Mouloud Feraoun, né en Grande-Kabylie ; Max Marchand, Oranais d’adoption et docteur ès lettres ; Marcel Basset, qui venait du Pas-de-Calais ; Robert Aimard, originaire de la Drôme ; le catholique pratiquant Salah Ould Aoudia et le musulman Ali Hammoutène, il y avait une passion commune : le sauvetage de l’enfance algérienne - car c’était cela leur objectif, l’objectif des Centres Sociaux : permettre à un pays dans son ensemble, et grâce à sa jeunesse, de rattraper les retards techniques qu’on appelle "sous-développement". Dans un langage plus simple cela veut dire : vivre.
Apprendre à lire et à écrire à des enfants, donner un métier à des adultes, soigner des malades - ce sont des choses si utiles qu’elles en paraissent banales : on fait cela partout, ou, à tout le moins, on a envie de le faire. [...]
Et c’était de quoi s’entretenaient ces six hommes, à 10 heures du matin, le 15 mars 1962 ..."
Germaine Tillion
La bêtise qui froidement assassine

– Par Jean-Philippe Ould Aoudia –
« La bêtise qui froidement assassine » était le titre en Une du Monde du 18 mars 1962 qui reproduisait la lettre de Germaine Tillion, rédigée après l’assassinat le 15 mars par l’OAS de six dirigeants des Centres sociaux éducatifs que la déportée résistante avait créés. Pour elle, les criminels étaient : « Les singes sanglants qui font la loi à Alger ».
Le massacre du 7 janvier 2015 à Paris entre en résonance avec celui du 15 mars 1962 à Alger. Même si « Un crime n’en vaut pas un autre, [si] chaque crime a sa figure » comme l’avait écrit François Mauriac après celui de l’OAS, l’un et l’autre présentent de sinistres similitudes.
À commencer par le procédé pour tuer. Un commando de six tueurs, surarmés, entraînés et décidés avait fait irruption dans les locaux administratifs où se trouvaient réunis les principaux responsables d’un service de l’Éducation nationale qui avaient pour mission de transmettre à la jeunesse algérienne les traditions les plus nobles de l’enseignement républicain. À la main, ils tenaient un stylo.
Le 15 mars 1962, six noms inscrits sur une petite feuille furent appelés parmi les 18 présents dans les bureaux des Centres sociaux. Les six victimes furent alignées devant un mur à l’extérieur de la salle et mitraillées, puis achevées par des coups de grâce.
Une minute de silence fut respectée dans tous les établissements scolaires après la lecture d’un message du ministre de l’Éducation nationale de l’époque.
Notre association qui honore l’œuvre et la mémoire des six fonctionnaires de l’Éducation nationale, rend hommage aux douze victimes du massacre de la rue Nicolas-Appert et partage la douleur de leurs proches. Elle est aussi la nôtre.
Au-delà du procédé criminel, le but de ces deux tueries reste le même à cinquante ans d’intervalle. On a tué hier à Alger et on tue aujourd’hui à Paris ceux qui ont pour mission de permettre aux citoyens de réfléchir. Ces deux terrorismes, l’ancien et l’actuel, ont pour ennemis la République et ses valeurs.Porter atteinte à la vie est inacceptable, mais l’assassinat d’« intellectuels » choisis pour l’exemple prend une signification particulière, car il est attentat contre les valeurs qui transcendent l’Homme en voulant détruire ce qu’il y a de meilleur en l’Humanité.
Ceux qui voudraient faire la loi à Paris ne la feront pas et la liberté d’expression sera.
« Les singes sanglants qui font la loi à Alger », ne l’ont pas faite et l’amitié entre les peuples algérien et français demeure vivante.
Cet appel à résister à « la bêtise qui froidement assassine », Germaine Tillion l'a porté au Panthéon.Jean-Philippe Ould Aoudia
Communiqué du 10 janvier 2015
Jean-Philippe Ould Aoudia, fils de Salah Ould Aoudia, a publié, une enquête sur l’assassinat de Château-Royal (éditions Tiresias). Jean-Philippe Ould Aoudia enquête minutieusement, recoupe les documents, vomit les clauses des amnisties successives qui rendent le crime innommable et font taire les proches des victimes. Il n’a qu’un but : traquer les assassins de son père à El Biar, relire cette tuerie planifiée, établir les complicités en hauts lieux, pointer du doigt les inconscients et les aveugles, reconstituer l’atmosphère d’affolement à Alger au printemps de 1962, qui laissait proliférer l’exécution à la raflette entre deux anisettes et l’attentat méthodique des commandos surentraînés. [d’après Jean-Pierre Rioux, Le Monde du 20 mars 1992]
C'était le 19 mars 2014
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 9 Mars 2022 à 12:06
L’association
communique
Mardi 15 mars 2022, un hommage sera rendu aux six dirigeants des Centres sociaux éducatifs massacrés il y a soixante ans, le 15 mars 1962, à Alger, par l’OAS.
La cérémonie se déroulera à 9 heures précises, devant la plaque commémorative apposée au siège du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, 101 rue de Grenelle, Paris 8è.
Seront présents :
-Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, et son chef de cabinet ;
-des représentants du Monde combattant ;
-le représentant de Madame la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La levée de la limitation du nombre de participants permet aux personnes qui le veulent de s’inscrire rapidement auprès de :
Jean-Philippe Ould Aoudia
06 85 40 44 16

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 9 Mars 2022 à 09:32
Complément à l'article ci-dessous paru
le 13 février dernier
Un ancien appelé en Algérie témoigne
des ordres de torturer et tuer
les prisonniers
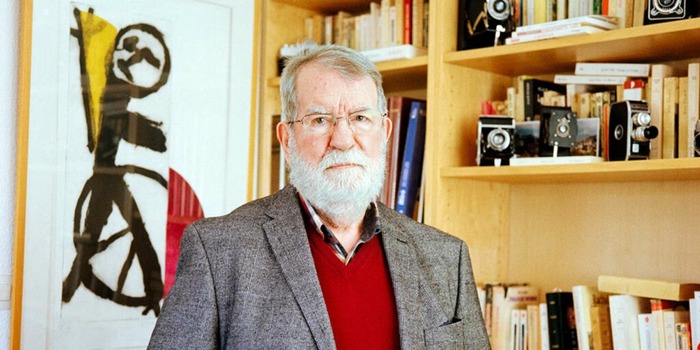
Jacques Inrep, ancien appelé en Algérie, revenant sur les photos qu’il a prises à l’armée de documents qui ont été transmis et publiés par Pierre Vidal-Naquet, demande l’ouverture réelle des archives. Dont les notes de service officielles de Massu et de Salan qu’il n’a pas eu le temps de photographier, ordonnant explicitement de pratiquer la torture et d’assassiner les prisonniers.
En complément des entretiens qu’il a donnés à L’OBS et au Monde M le magazine, Jacques Inrep, ancien appelé en Algérie de mai 1960 à août 1961, revient sur sa décision d’enfreindre la discipline de l’armée française et d’apporter un témoignage pour l’histoire en prenant en photo des documents militaires, estampillés « confidentiel », « secret » et « très secret », qu'il a transmis à l’historien Pierre Vidal-Naquet et qui ont été publiés par lui.
Il décrit aussi deux documents qu’il n’a pas eu le temps de photographier et que, depuis, en contradiction avec la loi qui régit les archives en France, les historiennes et les historiens qui ont travaillé sur la torture pratiquée par l’armée française durant la guerre d’Algérie, n’ont pas pu consulter.
Il demande qu'au-delà des annonces officielles sur l’ouverture des archives qui sont partielles et pas toujours suivies d’effet, l’accès aux archives militaires françaises sur cette période soit effectivement ouvert. Il faut aussi que les nombreux documents conservés par des militaires français de cette époque et qui se trouvent dans différents fonds privés soient remis aux Archives nationales, et que ceux qui sont encore vivants se voient déliés de la « consigne de silence » qui a été imposée par l'armée à la suite de ce conflit ; et qu'ils soient invités au contraire par les plus hautes autorités de la République à apporter leur témoignage pour l'histoire.
Alors que vont intervenir les commémorations de la fin de la guerre d’Algérie, la demande formulée par l’ancien appelé Jacques Inrep doit être entendue au plus haut sommet de l’Etat.
François Gèze, Gilles Manceron, Fabrice Riceputi et Alain Ruscio
Ouverture des archives ? Chiche !
par Jacques Inrep
Tout a commencé par une simple bagarre de gosses à la sortie de l’école primaire. Né en 1939, j’ai dû intégrer l’école laïque de mon petit village normand en 1944. Nous étions très nombreux et tous réunis dans une classe unique. Du CP aux grands du certif. J’étais, parait-il, doué pour les études. Hélas, une primo-infection pulmonaire me tint éloigné de l’école pendant un an. Lorsque je réintégrais la classe de mademoiselle Fournier, mon groupe, trois filles et sept garçons, commençait les apprentissages du CE2. L’institutrice décida que j’étais capable de sauter une classe. Pendant mon absence, deux garçons avaient pris le leadership du groupe. Mon retour les contraria. De l’étalage de nos connaissances à l’intérieur de la classe, le conflit se déplaça sur la place du village.
La scène fondatrice
Sincèrement, je pense avoir été à l’origine de la bagarre en traitant ces fils de paysans de « culs terreux ». S’ensuivit un échange de coups, d’orions et de diverses insultes. Puis un grand de 14 ans renforça le groupe de mes adversaires. A trois contre un, j’étais submergé. Un des protagonistes me traita de « Fils de rouge ! ». — « Non, mon père, il n’est pas rouge ! ». Un autre grand de 14 ans vint à mon secours et nous sépara. Je rejoignis la maison familiale en piteux état. Un œil au beurre noir. Un short déchiré. Une chemise en lambeaux. Pour me dédouaner des affres de cette rixe, à travers mes larmes, je tentais d’expliquer que j’avais défendu l’honneur de mon père, car ces deux petits merdeux l’avaient traité de » rouge ». Je vis alors mon paternel sourire. Avec tendresse, il m’expliqua que j’avais eu raison de le défendre, mais que ces deux morpions avaient raison, car il était « rouge » parce que communiste. Le rouge de la Révolution de 1789, le rouge de celle de 1917. Et il conclut par cette phrase sublime : « Les hommes naissent libres et égaux, et ils le demeurent quelles que soient leur race, leur religion ou leur philosophie ».
Cette phrase, dite avec tendresse et solennité, restera, à tout jamais, inscrite au plus profond de moi-même. Aujourd’hui, avec mon vocabulaire de psychanalyste, je pense qu’elle est de l’ordre d’une scène fondatrice.
La guerre d’Algérie
Quinze années avaient passé. Malgré des dispositions, j’avais décroché de l’école républicaine en troisième. J’avais intégré une administration avec pour tout bagage scolaire mon certificat d’études primaires. Malgré tout, j’allais me pourvoir d’une culture d’autodidacte, en lisant Balzac, Zola, Jean-Paul Sartre et Paul Nizan. Sans compter de nombreux auteurs anglo-saxons. Avec mon frère cadet, Michel, et mon père, nous étions fans de sport. Louison Bobet, Jacques Anquetil, Poupou… et Charly Gaul, le coureur cycliste aux semelles de vent. Michel Jazzy était notre idole. Mais nous ne nous contentions pas d’admirer ces vedettes, moi et mon frère, nous obtînmes quelques résultats en cyclisme ou en athlétisme. Notre adolescence fut aussi la période d’apprentissage de la citoyenneté. Aux repas, nous écoutions la radio et notre paternel associait, parfois, sur l’actualité pour enchainer en quelques phrases sur le Front populaire, la guerre d’Espagne ou la Révolution bolchevique. En ces temps d’adolescence, mes liens de fraternité allaient se consolider avec Michel. A travers notre amour du sport, mais aussi également à travers la littérature, le jazz… et bien sûr, la drague des jeunes filles en robe Vichy !
Formé par l’école laïque à la critique des situations sociale et politique, j’avais lu nombre de journaux, de France-Soir à Témoignage Chrétien, ainsi que la revue Les temps modernes. Ma conviction fut vite faite. La cause des Algériens luttant pour leur indépendance était juste. Je n’avais pas du tout envie d’aller les combattre. Seul hic, j’étais Français, et le service militaire obligatoire m’attendait.
Fort timide par nature, je n’eus pas le courage d’être insoumis. Ne sachant que faire, je demandais conseil à un ami de mon père, lui toujours encarté au PCF. Il me conseilla d’y aller, en Algérie, ce qui était la ligne du Parti. En 1959, la rage au cœur, je me présentais aux trois jours d’incorporation à Guingamp et naïvement j’effectuais les tests demandés. Résultat : je refus reçu par un civil, un psychologue, qui me donna un chiffre correspondant à mon QI, tout en m’annonçant que j’aurais dû passer le bac, et entrer à l’université. Je ne compris rien à ce discours.
A mon insu, l’armée avait déjà des projets pour moi. A Toul, lors de mes classes, je fus dirigé vers le peloton des futurs officiers ou sous-officiers. Au bout de deux mois, je refusais cet honneur en revendiquant le droit de rester deuxième classe. Grosse colère du capitaine et résultat immédiat : je fus viré du premier peloton et éjecté vers le septième dit « celui des brêles ». Première corvée. Première bagarre avec un sergent. Première semaine de prison. Ensuite les mois de taule vont s’enchainer. Les gradés vont me construire une image de « forte tête ». Après une nouvelle bagarre avec un capitaine, je vais être muté en mai 1960, en Algérie, dans les Aurès, là où avait commencé la guerre d’indépendance.
Fin avril 1960, avant mon départ pour l’Algérie, je vais passer quelques jours de perm à Alençon. Mes parents sont effondrés. J’eus une longue conversation avec mon frère, Michel. J’envisageais une issue fatale. Je luis demandais de conserver mes lettres et au cas où un malheur m’arriverait, de les adresser aux Temps modernes. J’ajoutais que si je trouvais des indices de la dérive fasciste de l’armée, je lui ferais parvenir ces preuves et nous convînmes d’un endroit dans la maison où il pourrait les planquer. Il y avait presque préméditation, mais ce n’était qu’une vague idée. J’ignorais alors que j’allais tomber, par hasard, quelques mois plus tard, sur des documents secrets. Arrivé à Batna, ma réputation m’avait précédé. De nouveau des bagarres et des insultes adressées à mes supérieurs, etc. De nouveau, prison, mais grande nouveauté : un séjour dans un bagne militaire semi clandestin.
J’écrivais régulièrement à mes parents, tout en leur cachant mes ennuis divers, ainsi que ma détresse, tant physique que psychologique. Il n’y a qu’à Michel que je racontais les horreurs de la guerre, et ma solitude liée à mon parcours de soldat rebelle. A part un ou deux, les appelés obéissaient aux ordres reçus, parfois en rechignant.
Les lettres que m’écrivait mon frère m’ont été d’un grand secours. Il me racontait ses perfs en demi-fond, une émission de « jazz dans la nuit », un livre qu’il lisait, une fille rencontrée au bal, les potins des étudiants de l’Ecole normale d’Alençon. C’étaient quelques éclairs de vie qui me parvenaient alors que j’étais quotidiennement confronté à la mort. Si je n’ai pas sombré dans la peur et la dépression, c’est en grande partie grâce aux lettres de mon frère. Sans compter, dans une moindre mesure, ma passion pour la littérature, qui m’aidait à me laver la tête de toutes ces horreurs vécues chaque jour.
Dès mon arrivée à Batna, j’ai compris rapidement que je m’étais trompé lourdement. Avant de partir, j’avais cru que ces histoires de torture ne pouvaient être le fait que de sadiques. Le constat était effrayant, l’armée française torturait à tour de bras. Il s’agissait d’un système institutionnalisé. Il y avait des unités spécialisées : DOP.et CRA. Des locaux, du matériel, des tortionnaires enfin.
Bien sûr, il est évident que tous les militaires de carrière, que tous les appelés, n’ont pas été des tortionnaires, ce serait injuste de l’écrire. Certains ont même combattu cette ignominie. Mais le « tribunal » des historien/nes est implacable : la torture était au centre de la sale guerre coloniale.
Dès les premières semaines de ma présence dans les Aurès, j’avais trouvé une « preuve », je pense qu’il s’agissait d’un tract du FAF (Front Algérie française), ancêtre de l’OAS. Je l’avais envoyé à Michel et une de mes lettres adressées à mon frère y fait référence à mots couverts. J’ai déposé ces lettres aux Archives départementales de l’Orne.
Les photographies
Mes quinze mois passés à Batna furent une suite de mutations diverses. J’étais la patate chaude que se refilaient les gradés. L’un d’eux eut cette réflexion : « Inrep, vous êtes un poids mort pour l’armée ». Sic ! Ayant refusé de devenir gradé, l’armée ne sut que faire d’un ostrogoth de mon espèce, elle m’avait fait faire un stage de secrétariat à Mourmelon. Dans les Aurès, j’avais complètement oublié ce détail. Fin 1960, l’armée s’en souvint et c’est ainsi que je me retrouvais muté au bureau du quartier urbain de Batna, comme secrétaire. Ma trajectoire de soldat au cours de mes 28 mois d’armée fut une suite de hasards successifs. Ainsi de ce refus de devenir gradé et de ce stage de secrétariat. Un colonel de la Légion étrangère (2° REC) vint prendre le commandement de notre petite unité. Curieusement, il me demanda de devenir son secrétaire particulier, alors qu’une bonne dizaine d’appelés étaient susceptibles de tenir ce poste. Il me tint un drôle de discours en me recevant, mon livret militaire à la main : « Je ne tiens jamais compte des écrits des autres ».
Le travail journalier ne se modifia guère, si ce n’est que trois tampons apparurent sur son bureau : « confidentiel », « secret », « très secret ». Autre curiosité, il installa son bureau dans un baraquement situé à environ trois cents mètres des locaux du Quartier urbain de Batna. Conséquence : j’y habitais seul vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Peut-être était-ce pour me tenir éloigné de mes petits camarades et de m’empêcher d’avoir sur eux une influence néfaste. Mon travail consistait à taper à la machine des notes de service, à répondre au téléphone, un standard me reliant à toutes les unités de Batna. Parfois la nuit, je restais éveillé près du poste radio PCR-10, pour suivre en temps réel les unités postées en embuscades.
C’est notamment par une circulaire de Pierre Messmer, ministre des Armés, du 18 juillet 1960, que j’ai pris connaissance des horreurs qui se tramaient en Algérie (n° 015682 MA/CC), en tapant la note de service n° 2273SB/2 diffusée le 11 avril 1961 dans le Secteur de Batna. Dans cette note, le ministre des Armées demandait qu’on cesse d’abattre des maquisards prisonniers. Or, cette note datant du 18 juillet 1960 n’a été transmise par le Secteur de Batna où se trouvait mon unité que neuf mois plus tard, et je constatais qu’au-delà du 11 avril 1961 on continuait à pratiquer les crimes de guerre prescrits par les généraux Massu et Salan en ne tenant pas compte de ce que disait la note de Messmer.
J’ai compris instantanément l’importance de cette note de service. En même temps, c’était comme si le ciel m’était tombé sur la tête. Cette patrie que j’aimais tant, celle des Droits de l’homme, se comportait comme une vulgaire chienne fasciste. La conséquence fut que je pris conscience du caractère institutionnel de la torture.
Lors de l’absence du colonel, je restais seul dans le baraquement ; je me mis à rechercher frénétiquement dans les dizaines de classeurs rangés sur des étagères. Rapidement, j’y découvris un nombre important de notes de service estampillées : « confidentiel », « secret », « très secret » ; toutes traitant soit de la torture, soit de la corvée de bois. J’étais effondré. Ma décision fut difficile à prendre. Se taire ? Voler ces notes de service ? Devenir un traître ? Mais aussi : devenir un témoin de l’histoire ? C’est certainement l’échec du putsch des généraux qui fit pencher la balance en faveur d’un témoignage.
Je décidais de subtiliser d’une façon ou d’une autre ces notes de service. Nous étions au bord de la guerre civile. Après le 13 mai 1958, la semaine des barricades, le putsch des généraux et les débuts sanglants de l’OAS. En fait, ce qui me décida, c’est que, si je ne le faisais pas, personne d’autre ne le ferait et le souvenir de toutes ces saloperies passerait à la trappe de l’histoire.
Mais comment procéder ? Il y avait plusieurs solutions éventuelles. Recopier à la main tous ces documents ? Beaucoup trop long, et surtout cela demandait la nécessité d’être seul dans le baraquement. Dérober toutes ces feuilles volantes ? Très risqué, le colonel pouvait s’apercevoir de la disparition des documents. Photographier ceux-ci ? C’est finalement cette troisième option qui obtint ma faveur.
Je fis un essai avec mon Semflex. Aie ! Son format carré ne convenait pas. En discutant avec un appelé du QG voisin, fana de photographie, sans rien lui dire de mes intentions, celui-ci me conseilla d’acheter un 24x36. Le Bled, le journal des bidasses, proposait dans une publicité l’achat d’un Foca Sport. Hic ! Je n’avais pas l’argent nécessaire. Je fis appel à la générosité de mes parents. Difficile de leur expliquer dans une lettre mes intentions. Finalement un chèque arriva et l’appareil photo me parvint quelques semaines plus tard.
Je décidais de procéder avec méthode. Je me fis une liste de toutes les notes de service à photographier et de leur place dans les différents classeurs et je fis le choix d’opérer un dimanche, le colonel ne venant jamais ce jour-là à son bureau.
Le dimanche 31 juillet 1961, après avoir déjeuné avec mes camarades du secteur du quartier urbain de Batna, je les quittais et rejoignis le baraquement où je m’enfermais à double tour. Il faisait lourd et humide. L’orage n’était pas loin. En short, j’enlevais ma chemise et pieds nus j’entrepris d’ouvrir le premier classeur. Mais, comme je l’ai expliqué lors d’une émission de France-Culture, je fis le mauvais choix. Il y avait deux possibilités : partir des documents du niveau du régiment pour remonter ensuite à travers la Division de Constantine jusqu’au Commandant en chef des forces armées basé à Alger ; ou bien partir du QG d’Alger et redescendre ensuite à travers les unités de la Division de Constantine jusqu’aux régiments. Hélas pour les historien/nes, j’optais pour la première solution.
Stressé par ma tâche… — le vol de documents secrets à l’époque équivalait à dix ans de forteresse ou douze balles dans la peau ! —, je procédais méthodiquement en essayant de photographier les notes de service qui me semblaient les plus significatives. La première pellicule terminée, je venais de photographier avec la seconde, une note de service, estampillée « secret », du général Massu (19 mars 1957)… je n’avais plus que deux documents à photographier, lorsqu’on toqua à la porte. Merde ! Le colonel !
Affolé, sur la pointe des pieds, je remis le classeur à sa place, puis comme si je revenais de ma chambre, j’ouvris la porte tout en bâillant : « Excusez-moi, mon colonel, j’étais en train de faire la sieste ». Le légionnaire tourna dans le baraquement, ouvrit les tiroirs de son bureau, consulta quelques dossiers, décrocha le téléphone, me demanda de lui apporter le compte rendu de la dernière nuit, remarqua mon Foca posé sur mon bureau, ne me posa aucune question, et finalement rejoignit son domicile. Malgré ma peur, j’arrivais à rester calme, cependant je n’eus pas le courage de retourner chercher le classeur où figuraient ces deux fameuses notes de service. Je m’attendais à ce que la Sécurité militaire vienne m’arrêter à tout moment. Finalement, rien ne vint.
Il me restait deux ou trois photos sur ma seconde pellicule. Je finis celle-ci à l’occasion de la découverte inattendue du site de Timgad. C’est un capitaine de chasseurs alpins qui nous y avait entrainés. Lors de la visite de ce site de ruines romaines, il nous demanda de réfléchir sur l’inanité des empires. Merci monsieur.
La transmission à Pierre Vidal-Naquet
La suite est plus connue ; à mon retour en France, je rencontrais Gilles Martinet, co-fondateur de France Observateur. Je lui remis les deux pellicules. Celles-ci furent développées par un photographe de l’Humanité, et Pierre Vidal-Naquet publia en 1963 La raison d’état (2) où une grande partie des documents secrets que j’avais photographiés figurent.
C’est par l’intermédiaire d’Edouard Depreux, responsable du PSU, que je pus rencontrer Pierre en 1963. Immédiatement, le courant passa entre nous. Je découvris un homme chaleureux, d’une grande rigueur scientifique. Avec lui, en le notant sur mon édition de La raison d’état de 1963, j’ai coché les documents qu'il a reproduits dans ce livre et dont il avait eu connaissance par mes photographies. En tout neuf documents parmi les vingt-deux que Pierre Vidal-Naquet a reproduits dans son livre (3).
J’eus une relation de compagnonnage intellectuel avec lui. Ainsi, en 1978, je fus très fier de lui offrir un exemplaire de mon mémoire de DESS de psychologie clinique, qui traitait de la torture.
Ensuite, et encore aujourd’hui, je fus de toutes les luttes syndicales, politiques, et sociétales. Dans ce parcours militant, j’adhérais à la LDH voilà quelques décennies. Je fus même responsable de la fédération du Gard plusieurs années. Je suis membre de l'Association des anciens appelés en Algérie et leurs ami(e)s contre la guerre (4acg).
Pour conclure, voici les deux notes de service qui sont restées gravées dans ma mémoire, que je n’ai pas eu le temps de photographier :
- du général Massu, document tamponné « secret » mais largement diffusé dans l'armée où il expliquait les différentes techniques à employer lors d’«interrogatoires poussés » : a) pressions psychologiques et menaces ; b) coups de poing ou de pieds ; c) utilisation de la « gégène » ou du courant 110 volts ; d) baignoire ou seau.
- du général Salan, alors qu’il était commandant en chef en Algérie. Elle comporte une phrase toute simple : « J’ordonne, que lors d’opérations, soient neutralisés sur place, tous les PAM ». Traduction de ce langage militaire : «j’ordonne de tuer sur place tous hommes pris les armes à la main ». En quelque sorte, il s’agit d’une directive ordonnant et autorisant la « corvée de bois ».
Ces notes de service ont continué à être appliquées dans le Secteur de Batna que j’ai quitté en août 1961, avec tout ce qu’elles impliquaient comme crimes de guerre.
Alors chiche, je mets au défi quiconque, historien-nes, responsables de nos institutions ou simples citoyens, de retrouver dans les archives militaires françaises ces deux notes de service et de les rendre publiques.
C’est un impératif pour l’histoire de notre pays, pour la défense et le respect de nos valeurs républicaines.
(1) Voir les recours qui ont dû être déposés au Conseil d’Etat pour obtenir la décision importante de sa part du 2 juillet 2022, CF Catherine Teitgen-Colly, Gilles Manceron et Pierre Mansat, Les disparus de la guerre d’Algérie suivi de La bataille des archives (2018-2021), L’Harmattan, 2021.
(2) Pierre Vidal-Naquet, La raison d’état, Editions de Minuit, 1963. Réédité par les éditions La Découverte en 2002.
(3) Il s’agit des documents qui figurent dans l’édition de La Raison d’état, Editions de Minuit, 1963, aux pages suivantes : un communiqué du ministre des Armées Maurice Bourgès-Maunoury du 15 mars 1957, page 107 ; une note de service du général Massu du 19 mars 1957, page 109 ; une note de service du colonel Trinquier et du R.P. Delarue d’avril 1957, pages 112 à 122 ; un témoignage diffusé par la SAS d’Orléanville sur le camp de Paul-Cazelles, page 123 ; une directive du ministre résidant en Algérie, Robert Lacoste, du 12 août 1957, page 185 ; un arrêté du lieutenant-colonel Barada, du 25 janvier 1959, page 235 ; une circulaire du colonel Renoult du 14 août 1959, page 241 ; une circulaire du ministre des Armées Pierre Messmer du 18 juillet 1960 diffusée par le commandant du secteur de Batna le 11 avril 1961, page 276 ; le rapport du lieutenant Chesnais de juin (?) 1961, page 288.
Source : Source : https://blogs.mediapart.fr/histoire-coloniale-et-postcoloniale/blog/080322/un-ancien-appele-en-algerie-temoigne-des-ordres-de-torturer-et-tuer-les-pri
« Tout le monde a le cul merdeux. C’est pour ça qu’on n’en parle pas, de cette guerre » : Jacques Inrep, un ancien d’Algérie face à soixante ans de non-dits
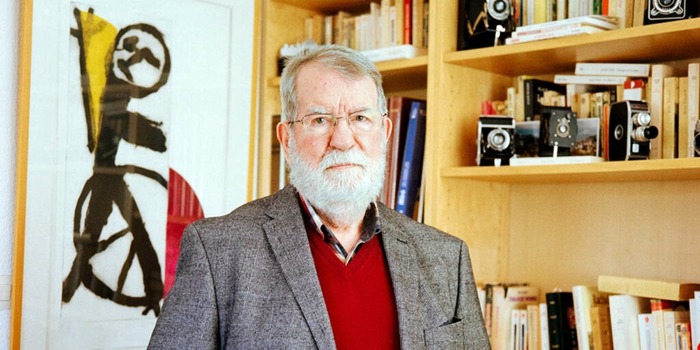

Jacques Inrep, chez lui à Bouillargues (Gard), le 25 janvier 2022. BAPTISTE DE VILLE D'AVRAY POUR M LE MAGAZINE DU MONDE
Envoyé en Algérie en 1960, Jacques Inrep en est revenu brisé, hanté par les horreurs d’une guerre qui ne disait pas son nom. L’ouvrier devenu psychanalyste, 82 ans, a su trouver les mots pour panser ses blessures. Mais contrairement à lui, la plupart des vétérans restent prisonniers d’un silence mortifère.
Après avoir passé quinze mois en Algérie, plongé au cœur de cette guerre que les discours officiels édulcoraient encore en « opérations de maintien de l’ordre », au mieux en « événements », Jacques Inrep est rentré le 17 août 1961 chez lui, à Mieuxcé, près d’Alençon, dans l’Orne. Il a 22 ans. Michel, son frère cadet, venu le chercher à la gare du Mans en Traction Avant, l’a conduit à l’hôtel-restaurant que tenaient ses parents.
Les vacanciers emplissaient l’établissement. Au cœur de l’été, il flottait un air de villégiature. Jacques s’est mis au lit en arrivant et a dormi vingt-six heures d’affilée. A son réveil, la famille a organisé une petite fête. Le champagne a été débouché. Une cantatrice a poussé un air d’opéra. Marie, la mère, s’est réjouie de revoir son fils en forme, amaigri mais bronzé.
Les questions des amis ont commencé à fuser. « Est-ce vrai qu’ils ne mangent pas de boudin là-bas ? » « Et que les femmes n’ont pas de poil à la zigounette ? » Que répondre à ça ? C’était aussi de sa faute, cette totale incompréhension : il avait tartiné des lettres lénifiantes aux siens, soucieux de les rassurer sur son sort. Il n’est qu’à son frère Michel que Jacques décrivait crûment la guerre du soldat Inrep.
Pour lui, elle a débuté en mai 1960 à Batna, au cœur des Aurès. Incorporé notamment dans un commando de reconnaissance avancée, l’appelé a subi plusieurs embuscades et vécu cinq attentats – quatre commis par des indépendantistes du Front de libération nationale (FLN) et par le Front Algérie française, prémices de l’Organisation de l’armée secrète (OAS). Il a découvert un garde champêtre berbère égorgé – le « sourire kabyle », disait-on alors – car soupçonné d’être un indicateur de l’armée française. Surtout, surtout, il a entendu hurler, la nuit, quand se taisait le bruit de la rue, que cessait le vacarme des camions, les prisonniers qu’on torturait à la gégène.
Abandonnés par l’armée face à une société indifférente
Et voilà qu’à son retour on lui parlait de cochonnailles et de poils pubiens… « Toutes ces questions tellement connes, ça m’a écœuré, se souvient Jacques Inrep. J’ai cassé une chaise et je suis sorti de la salle du restaurant. » René, son père, l’a rejoint dehors. « Il ne faut pas leur en vouloir, a-t-il tenté de le consoler. Ils ne peuvent pas comprendre. » René avait connu le même désarroi face à ceux de l’arrière, quarante-cinq ans plus tôt. Pendant la guerre de 14-18, il avait été blessé lors de la bataille de la Somme en 1916 et gardait des séquelles des gaz. Yves, le grand-père, un ancien poilu lui aussi, avait laissé une jambe quelque part sur le front. « Maintenant, tu fais partie de la tribu », a résumé le patriarche. La tribu de ceux qui ont fait la guerre. Eux comprenaient, mais les autres…
Les retrouvailles avec ce pays insouciant, qui n’avait que faire de ce qui se passait sur l’autre rive de la Méditerranée et avait déjà passé par pertes et profits cette sale guerre, ont donc été pénibles. Pour lui comme pour tant d’autres appelés d’Algérie. L’incompréhension, l’ignorance, l’indifférence les ont condamnés au mutisme. Soixante ans après les accords d’Evian, scellant la fin des hostilités le 18 mars 1962, c’est à une génération du silence qu’émarge Jacques Inrep. Il dit pourtant les reconnaître, les flairer dans la rue, ses pairs. A leur âge, bien sûr. Mais aussi à un regard, une attitude. « Je me dis : “Toi, t’étais là-bas.” »
Un jour, alors qu’il se promenait avec son frère rue aux Sieurs, l’artère commerçante d’Alençon, un pot d’échappement a claqué. « J’ai tenté de jeter mon frère au sol pour le protéger. » « L’Algérie, c’est fini », l’a engueulé Michel. Si seulement…
« Je suis revenu bien broyé. » Dans sa maison de Bouillargues, près de Nîmes, où il a posé ses valises après d’incessants déménagements, Jacques Inrep, 82 ans, raconte son histoire d’une voix lente, dépourvue d’émotion. Ils ont maintenant soixante ans, ces souvenirs. Le temps cautérise. Son métier aussi. Jacques Inrep a été infirmier psychiatrique puis psychanalyste. De quoi aider à comprendre, si ce n’est à expliquer. Contrairement à tant d’autres, parmi le 1,7 million de soldats envoyés en Algérie cadenassés à jamais dans leur détresse et une mémoire qui les ronge, il a pu identifier ce qui lui arrivait. Il a posé un diagnostic, mis un nom scientifique sur son état : stress post-traumatique.
Bien connu aujourd’hui, le trouble était, dans les années 1960, ignoré de lui comme de ses camarades et, plus grave, négligé par l’armée française, qui avait relâché les vétérans dans la nature sans aucun suivi. Des estimations, établies en 2000, quarante ans après les faits, concluaient que 350 000 anciens appelés souffraient toujours de troubles psychiques, notamment d’insomnies et de cauchemars.
Longtemps, l’ex-soldat s’est réveillé la nuit, en sursaut et en sueur, cherchant frénétiquement sa mitraillette sous l’oreiller. Un jour, alors qu’il se promenait avec Michel rue aux Sieurs, l’artère commerçante d’Alençon, un pot d’échappement a claqué. « J’ai tenté de jeter mon frère au sol pour le protéger. » « L’Algérie, c’est fini », l’a engueulé Michel. Si seulement…
Le soldat réfractaire
A son retour, Jacques Inrep a tenté de se dépatouiller comme il a pu avec ce fardeau. Il a commencé à mener une vie de patachon en Normandie. Il avait rompu avec sa fiancée avant de partir. Plutôt beau gosse, cheveu dru et brun, fine moustache, tel qu’il apparaît sur les photos d’époque, il s’est mis à collectionner les conquêtes féminines. « Je recherchais quelque chose de l’ordre de la vie », résume-t-il. Mais celui qui, avant sa mobilisation, passait pour timide et évitait les bagarres au bal de La Ferrière-Bochard avait désormais pris goût à l’affrontement et même à la castagne. « J’étais devenu beaucoup plus agressif, se souvient-il. Ma famille, mes amis m’ont trouvé changé. »
Avant de partir en Algérie, Jacques Inrep n’était guère engagé politiquement. « Vaguement de gauche », résume-t-il, suivant en cela une longue tradition familiale. Cette guerre qu’on veut lui infliger, il y est opposé par principe mais pas jusqu’à risquer la prison en tant qu’insoumis. Il se promet juste de ne jamais tirer sur un maquisard. Au fond, cette vie de soldat, ce parfum de plein air et d’aventure ne lui répugnent pas entièrement.
« Si les gens ne parviennent pas à parler de ce qu’ils ont vécu, c’est qu’il y a en permanence ça qui traîne : l’armée française a torturé à tour de bras. » Jacques Inrep
Ces illusions ne résistent guère. Il est envoyé au pays des Chaouis, un des principaux foyers indépendantistes à l’est du pays, précédé d’une réputation de forte tête acquise dès ses classes à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ce pedigree de réfractaire ne sera jamais démenti par la suite et le suivra dans son dossier, d’affectation en affectation. « J’étais la patate chaude qu’on se refilait », dit-il. A Batna, son expérience algérienne commence par l’accompagnement des cercueils plombés des soldats morts au combat et renvoyés en métropole. Un jour, il a ainsi rendu les honneurs à neuf « gus », comme s’appelaient eux-mêmes les soldats.
La réalité du colonialisme, la misère des populations algériennes lui sautent au visage, le minent à chaque fois qu’il pénètre dans un village. Il constate le racisme de nombre de pieds-noirs, doit menacer avec son arme un fermier : l’homme refuse l’eau de son puits aux conscrits qui protègent pourtant ses récoltes. L’alcoolisme des chambrées, l’angoisse et l’ennui qu’on noie dans la bière le désespèrent. Il est sans cesse en révolte contre l’autorité. Les punitions pleuvent. Il se retrouve ainsi à casser des cailloux sur une route en plein mois de juin, la boule à zéro.
Lanceur d’alerte contre la torture
Le putsch des généraux, en 1961, le fait carrément basculer. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1961, des généraux français opposés à l’indépendance de l’Algérie s’emparent du pouvoir à Alger. Avec d’autres soldats de la zone du Sud constantinois, Jacques Inrep s’oppose aux séditieux et remet dans l’avion l’officier putschiste qui venait les convertir. Ce qui lui vaut de posséder dans ses archives un mot de remerciement du général de Gaulle. L’autodidacte formé par la lecture de la revue Les Temps modernes de Sartre, le soldat qui emportait toujours un roman d’Ernest Hemingway ou de Graham Greene dans son treillis est définitivement convaincu de l’inanité de cette guerre.
L’usage de la torture le révulse. « J’ai découvert que ce que je pensais être les errements de quelques-uns étaient en fait un système organisé. » A Batna, il a vu la cave où se pratiquaient les interrogatoires. Il refuse d’y participer. Son copain Jeannot aussi : après avoir assisté à une séance comme secrétaire, cet ancien boxeur, un dur à cuire qui avait cogné un supérieur, a dit à son chef que ce n’était pas pour lui.
Ils n’étaient pas les seuls à s’être révoltés, insiste Jacques Inrep. « Si les gens ne parviennent pas à parler de ce qu’ils ont vécu, c’est qu’il y a en permanence ça qui traîne : l’armée française a torturé à tour de bras », explique-t-il. En Algérie, Jacques Inrep pousse plus loin l’insurrection morale. Affecté dans un bureau, il photographie, avec son petit appareil de marque Foca, des documents prouvant l’utilisation de cette pratique à grande échelle et sur ordre de la haute hiérarchie. Il sait qu’il risque la cour militaire. Il reviendra en France avec deux pellicules qui seront utilisées par l’historien Pierre Vidal-Naquet dans un livre paru en 1962 aux Editions de Minuit, La Raison d’Etat.
« Le lundi, il s’est pendu »
A peine rentré, Jacques Inrep s’engage au Parti socialiste unifié (PSU), une formation qui a toujours soutenu l’indépendance du peuple algérien. Ayant raté son brevet, n’ayant en poche que le certificat d’études, il cherche du travail. En ces temps de « trente glorieuses » et de plein-emploi, ce n’est pas le plus dur. On lui propose de reprendre son poste dans l’administration, au bureau des permis et des cartes grises, dans le service où il était entré à la fin d’une scolarité bâclée. « Je n’avais pas envie de finir ma vie dans un bureau. J’ai fait le choix de travailler en usine. »
Il entre chez Singer, à Alençon, comme ouvrier. Il est délégué CGT de la fabrique de machines à coudre qui compte 350 employés. Il y a là beaucoup d’anciens appelés. Une première fois, on lui signale que l’un d’eux déraille. A son poste de travail, dehors, l’ouvrier parle aux avions qui traversent le ciel. A la demande du chef du personnel, un ancien du contingent comme lui, le délégué syndical conduit son collègue dans un hôpital psychiatrique, où il est placé quinze jours sous neuroleptiques.
Jacques Inrep emmène deux autres copains dans ce même hôpital. Une femme médecin lui propose alors de travailler comme infirmier. Il accepte. Dans les années qui suivent, il croisera dans les couloirs nombre de patients alcooliques ou violents. Ils ont en commun d’avoir fait la guerre d’Algérie. Il se souvient particulièrement de l’un d’eux : « On m’avait dit qu’il montrait des photos pornos aux infirmières. » Jacques Inrep demande au malade de les lui montrer. « Il a sorti les photos et j’en ai pris plein la gueule. C’étaient des Algériennes nues qu’exhibaient deux ou trois soldats, des prisonnières qu’on torturait. »
L’infirmier se met en colère, exige que l’ancien appelé se débarrasse des clichés. Le coupable s’exécute. Les soignants, écœurés, le renvoient chez lui. Il revient spontanément le dimanche suivant. « L’interne de garde l’a foutu à la porte. Le lundi, il s’est pendu. » Pour la première fois, la voix de Jacques Inrep se fêle : « Même encore maintenant, je me dis qu’on a fait une faute. » Et puis une colère sourde éclate. « Tout le monde a le cul merdeux, résume-t-il. C’est pour ça qu’on n’en parle pas, de cette guerre. »
La théorie de l’obéissance aveugle
Parallèlement à son travail d’infirmier, il entame des études de psychologie dans les années 1970. Il découvre l’expérience de Stanley Milgram, qui a théorisé l’obéissance aveugle, jusqu’au-boutiste, intolérable, que peut accepter un individu soumis à une autorité. Il a vu ce phénomène à l’œuvre à Batna. Parmi les plus assidus aux interrogatoires figuraient deux paysans, un imprimeur de la CGT et un religieux.
« Ils n’étaient pourtant pas spécialement des pervers ou des sadiques. » Ils acceptaient pourtant d’être des tortionnaires. Dans le cadre de son DESS, Jacques Inrep consacre son mémoire à la privation sensorielle comme technique de torture. Après dix années de psychanalyse, où le vécu algérien « est revenu de manière très violente », il devient à son tour psychanalyste, au début des années 1980.
L’ancien soldat est retourné deux fois en Algérie, la première en 1973 avec des jeunes du PSU. Il a échangé avec des anciens maquisards du FLN et a été chaleureusement accueilli. Ce fut un réconfort. Comme l’ont été pour d’autres la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), une association d’entraide qui revendique encore 350 000 membres.
Le vétéran n’y a adhéré que tardivement, au début des années 1980, et a participé à quelques-unes de leurs agapes. « Cela rassemble des gens meurtris. Il y a là des garagistes, des avocats, des enseignants… Les gens se retrouvent dans une joyeuse ambiance. C’est un mélange de fraternité et de biture. » On y parle de tout sauf de la guerre. Lors d’une réunion, le témoin se souvient d’un participant qui s’était imprudemment lancé à raconter la sienne. Les autres, son épouse en tête, l’avaient rabroué. Ne pas réveiller les douleurs enfouies. Le silence toujours, comme une bulle protectrice.
La sortie du silence, la guérison impossible
Au tournant des années 2000, un article de la journaliste Florence Beaugé sur la pratique de la torture en Algérie paru dans Le Monde agit comme électrochoc. Jacques Inrep se décide alors à parler. Il témoigne lors d’une émission de France Culture, ce qui lui vaut intimidations, coups de téléphone injurieux et lettres anonymes. Puis il publie un récit couché sur le papier dix ans plus tôt, comme une thérapie personnelle. Après bien des refus d’éditeur, signe que la société était encore réticente à entendre cette parole, le livre est publié confidentiellement sous le titre : Soldat, peut-être… tortionnaire, jamais ! (Editions Scripta, 2003). Plus récemment, il a retrouvé son copain Jeannot mais l’a à peine reconnu dans l’homme fracassé qu’il avait en face de lui. Ils ne se sont plus revus.
Le 26 août 1960, à Batna, un adolescent a lancé un engin explosif sur un marché, au passage d’une patrouille de soldats dont Jacques Inrep faisait partie. L’attentat a fait cinq morts et une trentaine de blessés, tous algériens. L’homme qui était devant lui l’a protégé. Et fut déchiqueté. « Il y a un trou d’une demi-heure dans ma mémoire », raconte le rescapé. Il se souvient comme dans un songe d’être en train de ramasser les blessés, d’évacuer un gamin en pleurs. Puis de son errance dans un hôpital, couvert du sang des autres. Il se rappelle avoir enterré dans une haie de laurier un doigt trouvé sur place.
Cinquante-cinq ans plus tard, quand se sont produits les attentats de Charlie Hebdo, la prise d’otage de l’Hyper Casher, puis le massacre du Bataclan, tous ses souvenirs du 26 août 1960 sont brusquement remontés. « Je me suis mis à chialer. » Décidément, l’oubli reste interdit, la guérison impossible. Jacques Inrep touche de la France une pension d’ancien combattant : 600 euros par an.
Source : https://moustachebrothers.com/tag/merdeux/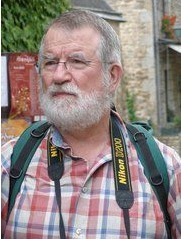
Le 7 avril 2014 je mettais en ligne un article concernant Jacques Inrep (lien ci-dessous). En relisant cet article j'ai constaté que Jacques Cros avait mis en ligne sur son site un article concernant aussi Jacques Inrep. Si vous cliquez sur le lien vous pourrez mieux prendre connaissance de cet appelé pour la sale guerre d'Algérie.
Michel Dandelot

 3 commentaires
3 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 8 Mars 2022 à 10:56
qui m’annonce le décès d’une femme d’exception : Madame Anne Beaumanoir

Ce 4 mars, à l'âge de 98 ans, est décédée en sa Bretagne natale Madame Anne Beaumanoir. Exemple d'une génération qui ne confondait pas l'engagement politique avec la posture, Annette représente celles et ceux pour qui, au combat contre le nazisme succédait celui contre le colonialisme.
Elle fut plus connue sous le nom d'Annette Roger, celle que les journaux de 1959 appelaient "la doctoresse rouge" après son arrestation par la police française alors qu'elle transportait en voiture un responsable du FLN. Avant de devenir porteuse de valise pour les indépendantistes algériens, Annette avait été Résistante au nazisme, passant dans la clandestinité et de ville en ville pour finir à Marseille où elle rencontra Jo Roger, communiste FTP qui devint son mari. Après guerre, le couple de médecins fit partie de l'équipe de pointe mondiale pour la recherche sur l'épilepsie sous la direction professeur Gastaut.
En 1956, Annette Roger-Beaumanoir fut la première chercheuse étrangère invitée à Moscou. Elle avait alors deux fils, Jean Henri et Gilles et quand elle fut arrêtée à Pont St Esprit en 1959, elle était enceinte d'un troisième enfant. Emprisonnée aux Baumettes, elle y croisa la jeune Djamila Bouhired qui était condamnée à mort.
Membre du réseau Jeanson, Annette n'attendit pas son procès (où elle fut condamnée par contumace à dix ans de prison). Après avoir mis au monde sa fille Myriam dans une clinique de Marseille, Annette s'évada et rejoignit Tunis où elle devient psychiatre de l'Armée Algérienne.
À l'Indépendance de l'Algérie, elle intègrera le premier gouvernement Ben Bella comme conseiller au ministère de la Santé. Dans l'urgence et le dénuement de la jeune République algérienne (un médecin pour 2000 habitants), Annette mettra en place tout le système d'éducation sanitaire et médicale qui lui semblait approprié. C'est l'époque où elle rencontre mes parents engagés dans des combats proches et s'intéresse comme eux à l'autogestion. Contrainte à la clandestinité après le coup d'État du 19 juin 1965 où Boumediene destitua Ben Bella, Annette se réfugie à Genève. Chef de service en psychiatrie à l'hôpital cantonal de Genève elle dirigea ensuite la Maison de l'épilepsie. C'est l'époque où je l'ai personnellement connue. Le destin d'Annette aura épousé les convulsions de l'Histoire et sa vie personnelle a été ravagée par la mort de deux de ses enfants. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'elle ressentait une grande culpabilité d'avoir tant sacrifié ses enfants à ses engagements politiques, quand elle avait pris conscience de la souffrance causée. Il est propre à sa génération que d'avoir fait des enfants dans l'élan vital de l'après-guerre, puis de les avoir sacrifié.e.s à la révolution et en particulier au combat anticolonialiste qui fut sans pitié.
Toutes mes pensées vont à Gilles Roger, son fils ainsi qu'à ses petites filles et petits fils.
Anne Beaumanoir est reconnue « Juste parmi les nations » le 27 août 1996 par l'institut Yad Vashem, en même temps que ses parents Jean et Marthe Beaumanoir.
Un hommage lui sera rendu Jeudi 10 mars à 14h au Pôle funéraire-crématorium public, 6 rue des Champs de Pies à Saint Brieuc. Ni fleurs ni souvenirs.
Condoléances sur www.pfi22.fr
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 7 Mars 2022 à 09:34
ll était une fois Gisèle Halimi

Le 24 juillet 2020, disparaissait la célèbre avocate. France 5 diffuse un documentaire retraçant l’histoire de cette femme de combat et de convictions.
Quand Gisèle Élise Taïeb vient au monde, sous le soleil tunisien en 1927, son père tarde à annoncer sa naissance. Pour cet homme aux valeurs traditionalistes, la naissance d’une fille est difficile à encaisser. Dès ses premiers instants, la condition de femme pèse de tout son poids sur les épaules de cette enfant que l’on connaît aujoued’hui sous le nom de Gisèle Halimi, avocate de combat.
La naissance d’une conscience révoltéeLe poids étouffant de sa condition de femme fait naître très tôt en elle un sentiment de révolte. À l’âge de 13 ans, la jeune Gisèle mène une grève de la faim pour n’être plus contrainte à servir ses frères. Un premier coup d’éclat qui s’avère payant. Cette victoire acte la naissance d’une conscience révoltée. Quand la peste noire de Vichy gagne la Tunisie, à la tête d’un commando, elle escamote le portrait du vieux maréchal. Poussée par l’envie de devenir avocate, elle quitte sa terre natale et débarque à Paris en 1945. Si son arrivée dans la capitale lui ouvre des horizons nouveaux, le rêve se retrouve terni. Racisme, antisémitisme et sexisme quotidien exacerbent au fond de sa chair sa condition de femme juive venue d’un autre pays.
Légalisation de l’avortement, criminalisation du viol, parité
Le temps des études est également celui des premières amours et du premier avortement clandestin. Quand se déclare la guerre d’Algérie, Gisèle Halimi prend fait et cause pour l’indépendance, et embrasse une carrière d’avocate politique. Pour elle, « la défense de l’indépendantisme et la cause des femmes sont un seul et même engagement ». Au cœur de ses plaidoiries, les crimes de guerre dont sont victimes les femmes algériennes. Les décennies suivant la fin du conflit verront l’avocate s’engager dans tous les combats féministes : légalisation de l’avortement, criminalisation du viol, parité. Mais également pour la dépénalisation de l’homosexualité, contre la guerre et le libéralisme.
Jusqu’à son dernier souffle
Si ce documentaire s’avère un bel hommage rendu à une femme dont le courage ne peut que susciter l’admiration, il souffre de quelques lacunes. Sa courte durée, d’à peine plus d’une heure, l’oblige à faire certains choix éditoriaux et à ne pas aborder certains combats menés par Gisèle Halimi. Il est par exemple dommage de le faire se terminer sur l’adoption du projet de loi sur la parité, début de couronnement d’un long combat mené sur plus d’une vingtaine d’années. En effet, loin de déposer les armes, Gisèle Halimi ne cessa jamais de combattre jusqu’à son dernier souffle, en écrivant des livres, en donnant des conférences et en intervenant dans les médias. Il n’aborde pas non plus ses engagements auprès de l’association altermondialiste Attac, dont elle fut l’une des cofondatrices, ou encore son engagement en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens.
Un considérable héritage de lutte
À sa mort, le 24 juillet 2020, A lire également également l’avocate militante laissa derrière elle un considérable héritage de lutte. Celui d’une lutte à la croisée des oppressions, née de sa conscience d’être femme, juive et colonisée, au sein d’une société corsetée par le racisme et l’antisémitisme, et dominée par les hommes. Le souvenir de sa vie ne cessera jamais d’être une intarissable source d’inspiration et d’espoir.
Si vous souhaitez visualiser le documentaire de France 5 disponible jusqu’au 6 mai 2022
Merci de cliquer sur le lien à la fin
Mais peut-être vous faudra-t-il créer un compte
c'est ce que j'ai fais
Célèbre avocate, Gisèle Halimi s'est éteinte le 28 juillet 2020, à l'âge de 93 ans. Rebelle et féministe, elle fut de tous les combats du XXe siècle : la lutte contre la colonisation, le patriarcat, les traditions et la domination des hommes. De la défense des indépendantistes algériennes à la parité, en passant par le droit à l'IVG et la pénalisation du viol, Gisèle Halimi a initié et accompagné la plus grande révolution sociale et culturelle de la seconde moitié du XXe siècle : l'émancipation des femmes.
Cliquez sur le lien
https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/3116019-gisele-halimi-la-cause-des-femmes.html
Gisèle Halimi au Panthéon : ce que cache la polémique
Gisèle Halimi au Panthéon : ce que cache
la polémique

Nous les anti colonialistes
Nous les appelés
Contre notre volonté
A la guerre d’indépendance
De l’Algérie
N'en déplaise à Madame
Fatima Besnaci Lancou
nous demandons toujours
l'entrée au Panthéon
de Gisèle Halimi !!!
Envisagée un temps par le président Emmanuel Macron, l’entrée au Panthéon de l’avocate Gisèle Halimi, figure anticolonialiste autant que féministe, serait désormais compromise. Et pas forcément pour les raisons que l’on imagine.
En janvier dernier, lors de la remise du rapport Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, on avait enregistré de vives réactions des deux côtés de la Méditerranée. Si, officiellement, les autorités algériennes semblaient rejeter en bloc ce texte – notamment parce que, à leurs yeux, il n’incitait pas suffisamment l’État français à la repentance – , en France, en revanche, l’accueil avait été plus contrasté mais en général assez favorable.
Ainsi, la plupart de ses préconisations pour apaiser les relations entre Paris et Alger et calmer les douleurs toujours vives des divers acteurs de la guerre près de soixante ans après les accords d’Évian, avaient plutôt été considérées par la grande majorité des commentateurs comme des mesures symboliques ou pratiques de bon sens. Avant qu’on oublie quelque peu le travail de Benjamin Stora au fil des semaines.
Dénoncer l’ensemble du rapport
Quatre mois après, alors qu’elle n’avait suscité que très peu de commentaires, l’une de ces mesures symboliques fait étonnamment l’objet d’une vive polémique en France. Il s’agit de « l’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, grande figure féminine d’opposition à la guerre d’Algérie », pour reprendre les mots de Benjamin Stora saluant l’avocate récemment disparue et qui avait courageusement défendu des militants et surtout des militantes du Front de libération nationale (FLN) risquant de lourdes peines pendant le conflit.
Certes, l’idée de lui accorder cet honneur peu commun – seules quelques dizaines de « grands hommes » sont inhumés au Panthéon – avait été critiquée dans une tribune signée par une cinquantaine de femmes se présentant comme « femmes et filles de harkis », et publiée par le Figaro. Mais le texte n’avait guère attiré l’attention. Il avait d’ailleurs pour principal but affirmé de dénoncer l’ensemble du rapport supposé « obéir à des considérations politiques et non historiques, au préjudice de la vérité sur les harkis ».
En clair, voulait-on dire, le texte de Stora ne prenait pas suffisamment en considération les revendications des descendants des soldats supplétifs de l’armée française pendant la guerre, injustement traités des deux côtés de la Méditerranée à l’issue du conflit.
Des dizaines de milliers de signatures
Mais voilà qu’à la mi-mai, un journaliste de la radio France Inter a déclaré à l’antenne avoir appris de bonne source – auprès d’un conseiller de l’Élysée, peut-on supposer – que l’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi ne ferait plus partie des gestes envisagés par le président Emmanuel Macron pour continuer à suivre les préconisations de Benjamin Stora (reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans l’assassinat de l’avocat nationaliste lié au FLN Ali Boumendjel, ouverture facilitée d’archives concernant la guerre, etc.).
Ce qui, jusque là, n’avait guère fait problème est alors devenu tout à coup une « affaire » très commentée dans les médias. Paradoxalement, non pas pour une raison directement liée à la mémoire de la guerre d’Algérie, mais parce que ce recul « probable » de l’Élysée a choqué… des militantes féministes.
Que s’est-il passé ? Il semble que le président français ait reçu récemment des représentants des harkis et qu’il les a entendus répéter les critiques émises dans la tribune du Figaro. De quoi l’inciter, peut-être, à ne pas se précipiter, à moins d’un an de l’élection présidentielle, pour honorer Gisèle Halimi, et, par là même, mécontenter les descendants des harkis, et peut-être aussi les « pieds-noirs », bien que ces derniers ne se soient pas exprimé sur le sujet.
Et c’est ce que la source élyséenne du journaliste de France Inter lui aurait confié. Ce qui n’a pas conduit avant tout, comme on aurait pu le supposer, les défenseurs des harkis à se féliciter. Mais qui a suscité une immense colère dans les rangs des organisations féministes françaises, lesquelles ont lancé une pétition qui a recueilli non pas une cinquantaine de signatures, comme la tribune du Figaro, mais des dizaines de milliers.
La raison en est simple. Gisèle Halimi est avant tout en France une figure du combat pour la défense des femmes : elle fut, grâce au célèbre procès de Bobigny en 1972, une pionnière parmi les défenseurs du droit à l’avortement et à la libre disposition de leur corps par les femmes. Elle fut également, à la suite d’un autre procès, en 1980, la principale responsable de la criminalisation du viol dans le droit français.
D’où l’importance, aux yeux des pétitionnaires, que revêt son entrée au Panthéon, indépendamment de son combat anticolonialiste. Une panthéonisation qui n’est peut-être même pas remise en cause, en tout cas pas définitivement, puisque Élisabeth Moreno, ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l’Égalité des chances, a tenu à faire savoir qu’elle soutenait cette initiative, sans être contredite.
Petit « guide »
Ainsi, il apparaît que le rapport Stora, loin d’être simplement oublié, est désormais devenu, non seulement, un petit guide permettant au gouvernement français de prendre certaines des mesures préconisées, mais aussi, un outil susceptible d’être utilisé par des groupes de mémoire et des chercheurs. Cette utilisation, tout en la détournant de son objet, dans le cas présent pour servir la cause féministe, mais aussi, en s’appuyant sur son contenu, tente d’infléchir la position des autorités des deux côtés de la Méditerranée.
C’est en effet ainsi qu’on peut interpréter les récentes revendications d’historiens algériens qui ont réclamé – notamment à la faveur d’une tribune publiée fin mars dans la presse d’Alger puis au cours d’un récent séminaire lors de la commémoration des massacres de Sétif en mai 1945 – que l’on ouvre plus largement l’accès, non seulement, aux archives françaises comme le demande Stora, mais aussi aux archives algériennes.
Loin d’être un simple rapport quasi-inoffensif, il est bien possible qu’il agisse implicitement à la manière d’une bombe à retardement. À suivre, donc.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 4 Mars 2022 à 13:48
Soutenir les Ukrainiens et refuser
les logiques de puissances

Dans la guerre de la Russie en Ukraine, quelles perspectives pour la paix ?
Vladimir Poutine poursuit seul son offensive en Ukraine. Malgré la résistance, Kyiv tombera certainement dans les prochaines heures. L’Ukraine s’apprête à être occupée par les Russes mais les Ukrainiens n’en resteront pas là. Ils se battront pour leur pays et leur indépendance.
Une fois la guerre entamée, elle est un état de fait. Il ne pourra y avoir de solution, ni dans la capitulation devant l’agresseur, ni dans la surenchère guerrière. Voilà trois décennies au moins que le monde est revenu aux errements de la realpolitik et du jeu des puissances. De facto, on n’a jamais eu autant de guerres que depuis que la Guerre froide s’est terminée.
Où la logique de guerre a-t-elle réussi ? La puissance américaine n’a pu empêcher les Talibans de revenir au pouvoir à Kaboul. Le Sahel n’a jamais été pacifié. La Syrie et la Libye restent meurtries. Le Moyen-Orient est toujours une poudrière. La guerre, disait Clausewitz, est la politique poursuivie par d’autres moyens. On en finit par oublier la politique. Et c’est là que le bât blesse.
En temps de guerre, le soutien politique passe par une aide matérielle aux combattants. Et consiste à rendre possible une vraie négociation. Les Ukrainiens ont besoin d’armes. Les Américains et les Européens ne gagneront pas à leur place.
Les guerres se gagnent aussi par la force des économies et la solidité des sociétés. Isoler économiquement l’agresseur est une arme incomparable. Isoler moralement le fauteur de guerre et le mettre au ban des nations devient la reine des batailles. Mobiliser partout où c’est possible les sociétés pour soutenir les agressés est la clef de toute victoire.
C’est aussi la clef des issues positives. Or, dans la foulée du conflit, l’Union européenne se voit en stratège militaire et de défense. Ses Etats-membres renforcent leurs budgets militaires. La Suède et la Finlande veulent intégrer l’OTAN. Ces choix sont dangereux. Ils nous conduisent à une escalade de la violence et nous dirigent vers un avenir macabre.
Voilà quelques décennies que l’on nous installe dans l’idée que l’état de guerre n’est plus une situation d’exception, que rien n’est plus dangereux que l’angélisme, que le renforcement des armées et de la défense passent devant tout autre priorité. C’est au nom de leur statut de puissance mondiale que les États-Unis ont préféré sacrifier les dépenses sociales pour conforter le budget militaire. Cela a-t-il empêché le relatif déclin de la superpuissance américaine ? La démocratie américaine en est-elle sortie grandie ?
On préfère la realpolitik au multilatéralisme, l’OTAN à l’ONU : notre monde en est-il plus sûr ? Emmanuel Macron veut nous proposer cette voie. C’est une folie qui servira de prétexte à la mise en cause de notre pacte social et de notre démocratie. Abandonner le peuple ukrainien serait un déshonneur et ne servirait pas la paix. Choisir la course à la puissance est tout autant une folie.
Source : http://www.regards.fr/actu/article/soutenir-les-ukrainiens-et-refuser-les-logiques-de-puissances
SOUVENONS-NOUS
Là où tout a commencé mais de cela personne n’en parle !
A quoi ont servi les 89 militaires français morts
en Afghanistan ?

Obsèques du sergent français Damien Buil, mort en Afghanistan
© MaxPPP
Dernière Marseillaise entonnée à Kaboul par les soldats français le 31 décembre 2014 car l’opération Pamir prenait fin officiellement elle avait débutée en 2001 pour lutter contre les talibans et Al-Quaïda. Treize années de présence en Afghanistan qui ont coûté la vie à 89 militaires français, dont le Sergent Damien Buil, tombé lors de l'embuscade d'Uzbin en 2008. Pour son père Jean-François Buil, ce retrait définitif a un goût plus qu'amer.
"Un très grand échec de l'OTAN"
"Mon sentiment est un sentiment de catastrophisme aigu, pour moi c'est un très grand échec de l'OTAN. 13 ans de conflit, 89 soldats français morts, 700 blessés. C'est un conflit qui n'a apporté que de la misère. Tous les jours je le revis".
Un conflit trop long, qui n'aura servi à rien, selon Jean-François Buil. "Ces barbus, ces talibans sont toujours là-bas, ils sont partout dans le monde. C'est comme une mafia. Mon fils, ses camarades, tous ces soldats sont morts pour rien. En 2011, il y avait 140 000 soldats en Afghanistan pour venir à bout de cette rébellion, ils n'y sont pas arrivés et, aujourd'hui, on s'en va. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un attentat. C'est l'insécurité totale".Le 31 décembre 2014 le dernier soldat français a quitté le sol afghan et passé le relais à une force turque. La presse nationale s'est contentée de relater l'événement, mais rares sont ceux qui ont dressé le bilan de cette opération.
C'est Jacques Chirac qui a pris la décision d'intervenir en Afghanistan en 2001, aux côtés de l'OTAN et à la demande des Américains, qui voulaient punir ceux qui selon eux soutenaient les terroristes à l'origine des attentats du 11 septembre.
L'objectif à l'époque, était en apparence noble : chasser les talibans de Kaboul, détruire les camps d'entraînement d'Al Qaïda en Afghanistan et reconstituer une armée afghane. Pour y parvenir, la France a envoyé plus de 70.000 soldats en Afghanistan. Le contingent français a atteint 4.000 militaires au plus fort des opérations, en 2010. Et cette intervention a coûté la vie à 89 soldats français et fait plus de 700 blessés.
L'un des épisodes les plus dramatiques a été l'embuscade tendue par des insurgés à une unité française le 18 août 2008 dans la vallée d'Uzbin, district de Surobi, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kaboul. Onze militaires français avaient alors été tués et 20 autres blessés.Treize ans plus tard, peut-on dire que les objectifs de 2001 ont été remplis? Les talibans n'ont été chassés que du coeur de ville de Kaboul et les résidents étrangers ne peuvent y circuler que dans un périmètre très restreint, ultra-surveillé et malgré tout toujours à la merci d'un attentat kamikaze ou d'une roquette.
A part ça, l’Afghanistan n’a sans doute jamais été dans une situation aussi préoccupante : les talibans sont plus puissants que jamais, contrôlant de très larges pans du territoire et organisant de véritables vagues d'attentats qui ont déjà fait plusieurs milliers de victimes innocentes.
La démocratisation mise en avant dans un second temps pour justifier notre présence militaire a définitivement tourné à la farce : la corruption, la criminalité, le trafic de drogue, la violence règnent partout. Et le pays est dirigé par un Hamid Karzaï qui négocie ouvertement son avenir avec les talibans, dont tout le monde sait qu’ils prendront immédiatement le contrôle total du pays à la minute même où les derniers militaires occidentaux auront quitté l’Afghanistan.
Et c'est le même Hamid Karzaï qui a décidé de baser son nouveau code pénal sur la charia, et notamment de réintroduire la peine de mort par lapidation pour les personnes mariées "coupables" d’avoir eu des relations sexuelles adultères. Une décision confirmée auprès des dirigeants américains et des responsables des Nations Unies par Rohullah Qarizada, membre de la commission sur la loi coranique, celui-ci déclarant : "Nous travaillons sur un projet de code pénal de la charia prévoyant que la lapidation sera la sanction de l’adultère s’il est confirmé par quatre témoins oculaires". Les personnes coupables du même "crime" sans être mariées s’en tireront beaucoup mieux : elles ne recueilleront, elles, qu’une centaine de coups de fouet...
Quand on dresse le bilan d'une opération, on ne peut passer sous silence son coût financier. Selon la commission de la défense de l’Assemblée nationale, la présence militaire française en Afghanistan a déjà coûté 3,5 milliards d’euros aux contribuables pour la période 2001-2013. Une somme qui n’inclut ni l’usure, ni la destruction des matériels aériens et blindés utilisés sur place, ni les frais médicaux, frais d’obsèques ou pensions d’invalidité, ni le coût du retrait progressif du contingent militaire français estimé entre 200 et 300 millions d’euros...
Tout ça pour ça, serais-je tenté de dire !
Ajoutons qu'en 2008, lorsque 11 soldats sont tombés dans une embuscade des talibans, de graves accusations avaient été portées par les familles contre l'incompétence de l'état-major et le manque de moyens dont disposaient les soldats. C'est ainsi qu'on a découvert que ces derniers étaient sous-équipés, souvent obligés d'acheter eux-mêmes leurs équipements pour remplacer celui fourni par l'armée française, soit inadaptés, soit de très mauvaise qualité.
Aujourd'hui, on est légitiment en droit de se demander à quoi ont servi ces 89 morts.
SOURCE : http://www.zinfos974.com/A-quoi-ont-servi-les-89-militaires-francais-morts-en-Afghanistan_a79842.html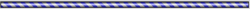
Pierre Barbancey, grand reporter, samedi 14 novembre 2015 : « Je suis actuellement en Irak. Ce pays qui a été démembré, ses communautés et ses confessions jetées les unes contre les autres, par une guerre voulue par les Etats-Unis en 2003. C'est sur ce terreau que s'est développé Daech, l'organisation de l'Etat islamique.
Des terroristes soutenus et aidés par des pays comme le Qatar, la Turquie et l'Arabie saoudite. Trois pays aux liens privilégiés avec la France qui leur vend des armes.
Il faut pleurer les morts du 13 novembre 2015 à Paris. Mais il faut aussi avoir en tête que les populations du Moyen-Orient vivent ce cauchemar au quotidien depuis des années.
La France officielle fait des guerres : Libye, Mali, Centrafrique, Irak... Toujours sous des prétextes humanitaires. Ce qui est un leurre. La guerre n'a jamais rien réglé, au contraire. La guerre ne peut pas toujours se regarder à la télévision. Si on accepte qu'elle ait lieu ailleurs, alors il faut s'attendre à ce qu'elle nous revienne dans la gueule un jour. C'est pour cela qu'il faut la paix. Une politique internationale de la France dédiée à la paix, pas une politique de gendarme, vendeuse d'armes et de captation des richesses d'autres pays… »
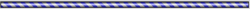
Que rajouter de plus ? Juste s'interroger sur l'opportunité des interventions de plus en plus nombreuses décidées après l’Afghanistan… Puisque maintenant le terrorisme est en France… et maintenant la France n’a plus le choix… elle doit protéger ses enfants… et pleurer les 129 victimes du 13 novembre 2015.
La France ne changera donc jamais, comme les harkis à la fin de la guerre d’Algérie, les interprètes afghans sont aussi abandonnés…

Et si la France s'occupait enfin
des interprètes afghans ?
En fin de semaine dernière, le Conseil d’Etat a renvoyé la France dans la corde sur le dossier des interprètes afghans. La décision est passée largement inaperçue et met notre pays devant ses responsabilités sur un sujet très symbolique. il mérite un petit coup de gueule. C'est le "monde à l'envers".
Un soldat afghan sur le site d'un attentat suicide à Kaboul fin novembre © AFP / NOORULLAH SHIRZADA / AFP
Et si la France se décidait enfin à s’occuper de ses interprètes afghans ? Ce serait comme un petit miracle, voyez, la magie de Noël…
D’abord, un rappel : de quoi et de qui parlons-nous ? Nous parlons de ces hommes, près de 800 au total, qui, de 2001 à 2014, ont aidé l’armée française en Afghanistan, tout le temps que nous y étions.
On les surnomme, par raccourci, les « interprètes afghans ».
Dans le jargon administratif, ce sont les PCRL, personnel civil de recrutement local. Concrètement, ils étaient chauffeurs, cuisiniers, simples ouvriers, fixeurs et parfois, oui, interprètes. Et de temps à autre, on leur confiait aussi des armes en cas de menace.
Et puis, progressivement, entre 2012 et 2014, l’armée française s’est retirée d’Afghanistan. Et les auxiliaires afghans eux, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Ils ne so

nt que 175 à avoir obtenu un visa pour la France.
Ceux qui sont restés sont perçus par les Talibans et les Islamistes afghans, comme des « collabos d’une ancienne armée d’occupation ». Ils sont menacés, contraints de se cacher. Il y a quelques semaines, l’un d’eux a été tué dans un attentat suicide à Kaboul.
Beaucoup ont pris la route de l’exil, via le Pakistan, ou la Turquie. Ils se retrouvent finalement en Russie, en Inde, en Grèce, aux Pays-Bas. La France les a, pour la plupart, laissé tomber.
En février 2017, en pleine campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron l’a même publiquement reconnu.
Il les a comparés aux harkis de la guerre d’Algérie et a qualifié l’attitude française de « trahison ». Et depuis ce discours ? Et bien pas grand-chose !
Un camouflet pour les autorités françaises
Les choses pourraient changer après cette décision de justice, vendredi dernier 14 décembre… Décision du Conseil d’Etat, donc la plus haute juridiction administrative.
En urgence, en référé, il se prononçait sur le cas de l’un de ses interprètes afghans, on va l’appeler monsieur A.
Il vit toujours à Kaboul, dans l’insécurité la plus totale et il n’ose même plus sortir de chez lui.
Et la décision est un camouflet pour les autorités françaises.
Que dit le Conseil d’Etat ? Il dit : la France doit protéger Monsieur A.
Je cite : « la carence des autorités publiques françaises est de nature à l’exposer, de manière caractérisée, à un risque pour sa vie ».
La justice enjoint le ministère des Armées à lui trouver une protection sous 8 jours. Cela s’appelle « la protection fonctionnelle », que la France doit à ses salariés.
Et Paris se voit également contraint de réexaminer la demande de visa de Monsieur A sous 2 mois.
Evidemment, tout cela pourrait faire jurisprudence et contraindre la France à revoir sa position d’ensemble.
Incompréhensible et scandaleux
Que font exactement les autorités françaises ?
Depuis 6 ans, il y a eu en tout et pour tout trois procédures administratives. La première, en 2012, a débloqué 70 visas. La deuxième, en 2015, en a débloqué une centaine.
Et Emmanuel Macron a déclenché une troisième procédure : un réexamen, pour « raisons humanitaires », des refus précédents. Il a fallu un an et demi (un an et demi !) pour enclencher ce processus.
Et finalement, le mois dernier, les anciens interprètes afghans ont été invités à aller déposer leurs demandes… au Pakistan ! Bref, faire Kaboul-Islamabad, au péril de leur vie (c’est l’une des routes les plus dangereuses au monde). Sans même la garantie de décrocher un visa. 4 d'entre eux ont fait le voyage pour rien.
Il y a eu 180 demandes à Kaboul. Et la France en a validé 43 seulement ! Pourquoi ce chiffre ? Mystère total. Opacité complète.
Les ministères des Armées et des Affaires étrangères se renvoient la balle et ne donnent aucune justification. Le seul argument parfois avancé pour justifier les refus, c’est « raison de sécurité nationale ».
Un argument assez curieux : on parle de personnes qui ont été recrutées par l’armée française : nous aurions donc eu recours à des supplétifs dangereux pour notre propre sécurité…
Quant à Monsieur A, il attend toujours, en ce mercredi 19 décembre, la mesure de protection désormais imposée par la justice.
Il est maintenant question d’un prochain arbitrage interministériel.
Répétons-le : on parle là d’hommes qui ont servi la France, qui ont risqué leur vie pour nous.
Et ils ne sont qu’une poignée, quelques centaines, ça n’a rien d’une invasion migratoire.
Un diplomate français, qui veut conserver l’anonymat (on le comprend), dit de ce dossier : « c’est incompréhensible et scandaleux ». Le fait est : la France ne se grandit pas dans cette affaire.
J'apprend, la mort d’un interprète afghan est scandaleux car comme pour les harkis en Algérie, la France de la honte, (enfin je rectifie ses dirigeants d'hier et d'aujourd'hui), a abandonné ses interprètes en Afghanistan…
« Bon je suis d’accord le meurtre du journaliste Jamal Khashoddi (je ne garantis pas l’exactitude de l’orthographe...) est révoltant. Mais que l’on ait pratiquement passé sous silence la mort de Qader Daoudzai, interprète afghan qui, après avoir servi l’armée française comme 800 autres auxiliaires, s’est vu refuser un visa pour la France comme 100 autres. Menacé de mort il sortait de chez lui malgré le danger pour gagner de quoi faire vivre sa famille. Samedi dernier il a été victime d’un attentat alors qu’il était observateur électoral pendant les élections législatives. Les Talibans ne l’ont pas oublié, la France si. Hollande lui a refusé un visa et Macron a confirmé. Voilà ».
HONTEUX

Mort d'un ex-interprète afghan de l'armée française "Ces personnes ont été trahies par la France"
Deux journalistes spécialisés ont révélé la mort d'un ancien interprète de l'armée française en Afghanistan lors d'un attentat-suicide à Kaboul. Interrogés par franceinfo, ils racontent le sort de ces centaines de traducteurs afghans, abandonnés par l'Etat français.
L'armée française a-t-elle abandonné ses alliés sur le terrain après s'être retirée d'Afghanistan ? C'est la question que pose la mort de Qader Daoudzai. Cet ancien interprète afghan, qui a travaillé pour les forces françaises entre 2010 et 2012, a été tué, samedi 20 octobre, lors d'un attentat-suicide à Kaboul. Dans une lettre adressée au Parlement français, il se disait victime de menaces et avait demandé un visa pour venir en France. Mais cette demande avait été refusée en 2015, comme celles de dizaines d'interprètes ayant collaboré avec l'armée française.
La mort de Qader Daoudzai a été révélée par deux journalistes : Brice Andlauer et Quentin Müller. Ensemble, ils ont enquêté pendant deux ans sur le sort des anciens interprètes de l'armée française, dont la vie est menacée en Afghanistan par les factions islamistes qui les considèrent comme des traîtres. Leur livre sur le sujet – Tarjuman, une trahison française – sera publié chez Bayard le 6 février prochain. Interrogés par franceinfo, les journalistes livrent en avant-première les grandes lignes de leur enquête.
France Info : Comment avez-vous appris la mort de Qader Daoudzai, ancien interprète de l'armée française en Afghanistan entre 2010 et 2012 ?
Brice Andlauer : Les anciens interprètes des forces françaises sont organisés en groupes en Afghanistan, et c'est par l'intermédiaire du chef d'un de ces groupes que nous avons appris la mort de Qader. Il a été tué lors d'une attaque-suicide dans un bureau de vote de Kaboul, en marge des élections législatives en cours dans le pays. Il laisse derrière lui une femme et trois petits garçons.
Quentin Müller : Dans une lettre adressée au Parlement français, Qader expliquait avoir travaillé en tant qu'interprète pour l'armée française pendant l'intervention en Afghanistan, entre 2010 et 2012. Il y demandait un visa pour se rendre en France et expliquait craindre pour sa vie dans son pays, mais sa demande a été refusée sans explication, en 2015. Ils sont aujourd'hui des centaines dans sa situation.
Qui sont ces traducteurs ? Quel était leur rôle auprès de l'armée française ?
Brice Andlauer : L'armée française utilise un terme spécifique pour ces personnes : Personnels civils de recrutement local (PCRL). Cette désignation regroupe toutes les personnes amenées à collaborer avec les forces françaises sur le terrain. Cela va du magasinier au cuisinier en passant par l'interprète, qui, lui, est particulièrement exposé puisqu'il accompagne les militaires français lors des opérations. Très concrètement, ce sont eux qui négocient auprès des locaux lorsqu'il faut réquisitionner une maison ou qui font la traduction lorsque les militaires interpellent un chef taliban. En Afghanistan, ils étaient entre 800 et 900 PCRL, parmi lesquels quelques centaines d'interprètes, même si les autorités refusent de communiquer des chiffres précis sur ce point.
Quentin Müller : L'écrasante majorité de ces interprètes sont des jeunes, nés dans les années 1980 ou 1990. Presque tous sont issus de la classe moyenne-supérieure, car ils sont éduqués. Ce sont des fils de médecins, de professeurs ou de militaires de l'armée afghane. Ces jeunes-là, l'armée française est allée les chercher directement dans le lycée français de Kaboul ou dans les universités. Mais après le retrait des troupes françaises, fin 2012, ils ont tous été abandonnés.
Leur vie est-elle menacée en Afghanistan ?
Quentin Müller : Evidemment ! Ces traducteurs sont considérés comme des traîtres ayant collaboré avec l'envahisseur. Une bonne partie de la société afghane pratique un islam très rigoriste et, pour les franges les plus radicales comme les talibans, ces personnes sont considérées comme des mécréants à abattre. Certains se sont fait tirer dessus ou ont vu des membres de leur famille se faire assassiner.
Brice Andlauer : Un des interprètes que nous avons rencontrés à Kaboul cet été a survécu à deux tentatives de meurtre et a aujourd'hui six impacts de balles dans le corps. Un interprète américain a été décapité et la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ces personnes ne trouvent plus de travail et déménagent régulièrement pour se cacher. D'autres se sont réfugiés à l'étranger. Nous avons trouvé la trace de certains d'entre eux au Sri Lanka, en Indonésie, en Russie, en Turquie ou en Europe. Ils ont emprunté la route des migrants.
Que reprochez-vous à l'Etat français ?
Quentin Müller : Après deux ans d'enquête, nous sommes en mesure de démontrer que les autorités françaises sont responsables de la mise en danger de ces interprètes. Ces personnes ont été trahies par la France et il n'y a aucune volonté de la part de l'Etat de leur venir en aide, malgré le devoir moral que nous avons vis-à-vis d'elles. Même si les comparaisons sont toujours délicates, nous sommes avec les interprètes afghans dans le prolongement historique de l'abandon des Harkis.
Que vous ont répondu les autorités ?*
Quentin Müller : Nos échanges se sont souvent arrêtés à quelques mails et des coups de fil de relance aux attachés de presse ou secrétaires de cabinets. Il y a un mois, le chef de cabinet de la ministre des Armées Florence Parly m'a accusé de harcèlement, après plusieurs échanges où on me promettait une réponse. Il y a une grande crainte de parler de ce dossier dans tous les ministères impliqués, car il suscite la honte. Très peu de fonctionnaires travaillent sur le sujet et ceux qui le suivent de près ont pour ordre formel de ne pas parler de cette affaire.
*Sollicité par France Info, le ministère des Armées n'a pour le moment pas apporté de réponses à nos questions. De son côté, le ministère des Affaires étrangères a réagi à la mort de Qader Daoudzai dans un communiqué. "Certaines demandes de visa ont été refusées car elles ne correspondaient pas aux cas de délivrance prévus par le droit applicable", explique le quai d'Orsay, précisant qu'"à ce jour plus de 100 anciens PCRL accompagnés de leurs familles ont été accueillis en France où ils ont été pris en charge".
Ardennes. Le sort incertain de Basir, ancien interprète pour l'Armée française en Afghanistan

Basir, 31 ans, ancien interprète en Afghanistan, est menacé d'expulsion / Charleville-Mézières, le 5 janvier 2018 / © Juliette Poirier / France 3 Champagne-Ardenne
Basir a 31 ans. Interprète en Afghanistan pour l'Armée française de 2011 à 2012, il est aujourd'hui logé au centre d'accueil des réfugiés de Charleville-Mézières et menacé d'expulsion.
Après Châlons-en-Champagne, Basir est désormais hébergé à Charleville-Mézières dans un centre d'accueil. L'Afghan de 31 ans était interprète pour l'Armée française dans son pays. En mai 2015, il a décidé de fuir.
"Comment protéger ma famille ?"
Un jour, un homme l'a reconnu dans un magasin de téléphones et s'en est suivie une violente bagarre. Il raconte :
J'ai décidé de quitter l'Afghanistan parce qu'on pouvait me retrouver à tout moment. Si on venait chez moi, comment aurais-je pu protéger ma famille ?
Grand brun aux yeux sombres, il arrive en France en décembre 2015. Un mois s'est écoulé depuis les attentats du 13 novembre. Les frontières sont fermées. Basir est bloqué.
"Parce que j'ai travaillé pour des Français, je serai tué"
Contraint de se rendre aux Pays-Bas, c'est là-bas qu'il devra effectuer une demande d'asile, qui sera refusée. S'il parvient finalement à rejoindre la France, pas sûr qu'il puisse y rester : on menace aujourd'hui de l'expulser.
S'ils me déportent aux Pays-Bas, on me renverra en Afghanistan et je serai tué. Parce que j'ai travaillé pour les Français, ils vont me tuer tout de suite soupire-t-il, impuissant.
Basir n'est pas le seul à avoir été abandonné à son propre sort. Le cas des interprètes afghans avait été pointé du doigt par Emmanuel Macron lors de sa campagne, en comparant le sort des interprètes afghans à celui des harkis lors de la guerre d'Algérie.
"Une trahison" selon le chef de l'Etat. Pourtant aujourd'hui, Basir a écrit deux lettres adressées au Ministère des Armées. Elles restent sans réponse. L'ancien interprète peut être expulsé à tout moment.► Cliquez sur le lien ci-dessous pour visualisez la vidéo correspondante :

Interprètes afghans de l’armée française : "Pourquoi ne les sort-on pas de là ?"
Près d'une cinquantaine d'ex-interprètes de l'armée française déployée en Afghanistan jusque fin 2014 ont réclamé mardi à Paris des visas pour leurs camarades restés coincés dans leur pays où ils affirment être régulièrement menacés.
Sous une pluie fine mais tenace, ils sont venus déployer des banderoles "Solidarité avec les interprètes en danger" sur l’esplanade des Invalides, à Paris, à proximité du ministère des Affaires étrangères. Une cinquantaine d'ex-interprètes de l'armée française en Afghanistan réfugiés en France ont réclamé des visas pour leurs camarades restés coincés sur place, et régulièrement menacés par les Taliban et l’organisation État islamique (EI).
>> À voir sur France 24 : "Le parcours du combattant
des interprètes afghans de l’armée française"
Selemani Mohamamd Ehsan, 65 ans, a fait le déplacement avec sa femme. Il a été interprète pour l’armée française de 2002 à 2012. Début octobre, avec leurs trois enfants et après en avoir fait la demande dès 2013, ils ont enfin pu obtenir un visa et fuir Kaboul où leur vie était menacée.
Depuis, ils sont logés dans un appartement à Verneuil-sur-Avre, dans l’Eure. "Le frère de ma femme, interprète pour l’armée allemande, a été tué", raconte le sexagénaire, enveloppé dans un épais manteau marine. "On est venus en France pour sauver notre vie et celle de nos enfants", lâche-t-il, tandis que son épouse, qui était juge à la Cour suprême d’Afghanistan, extirpe de son sac à main les papiers de toute la famille.
Difficile de créer des liens
Mais la vie en France est difficile, d’autant que la situation de l’un des fils, handicapé, requiert une prise en charge que le couple a de plus en plus de mal à assurer. "Les locaux n’aiment pas les étrangers et il est très difficile de créer des liens", ajoute l’ancien collaborateur de l’armée française, qui souhaiterait être relogé à Paris.
Pour l’heure, il est venu réclamer des visas pour les interprètes afghans qui n’ont pas eu la chance d’obtenir le précieux sésame et sont coincés dans leur pays où l’insécurité règne. Du fait de leur collaboration avec l’armée française, qui s’est retirée en 2014, ils sont menacés à la fois par les Taliban et l’EI.
>> À voir sur France 24 : "Le retrait français d'Afghanistan"
"Au total, l’armée française a travaillé avec 252 interprètes. Parmi eux, une centaine ont reçu un visa et sont aujourd’hui réfugiés en France. Il y a donc près de 150 personnes, avec leurs proches, qui attendent leur visa ou à qui on l’a refusé. La majorité d’entre elles sont restées à Kaboul", explique Mohammad Assef, un des organisateurs du rassemblement, qui a, lui, obtenu des papiers et a été accueilli à Metz, comme une trentaine d’autres interprètes et leurs familles.
"Déçus et choqués"
Aidés d’une demi-douzaine d’avocats, d'anciens interprètes afghans avaient déposé des recours devant le tribunal de Nantes mi-novembre 2016, pour contester le refus par l'État français de leur accorder un visa malgré les risques encourus. Mais ces requêtes ont été rejetées le 23 novembre.
"On ne comprend pas l’attitude des autorités françaises, on est déçus et choqués", fulimine un autre manifestant, qui ne souhaite ni donner son nom, ni être pris en photo, par peur de représailles pour lui ou des proches restés à Kaboul. "Les autres pays qui sont intervenus en Afghanistan ont protégé leurs collaborateurs quand ils se sont retirés ! Ils leur ont octroyé des visas, les ont aidés à trouver du travail dans leur pays ; seule la France se comporte de la sorte", juge-t-il.
La vie à Kaboul avant son arrivée en France en mai 2016 ? "Nous étions comme en prison, nous n’osions pas sortir, mon père a été menacé, une partie de ma famille m’a rejeté parce que j’avais collaboré avec les Français", raconte ce docteur de formation, qui s’est engagé auprès de l’armée hexagonale de 2005 à 2013 "pour aider à la reconstruction et à la paix" dans son pays.
Son voisin, qui s’abrite sous un parapluie pâle, raconte que son propre frère, interprète lui aussi, se terre dans la capitale afghane dans l’attente d’un visa. Lui a eu la chance d’en obtenir un, et vit désormais à Metz avec sa femme.
"Traîtres et infidèles"
Shafiq Ghorwal, 33 ans, également réfugié dans la ville-préfecture de Moselle avec sa compagne et ses trois enfants, a travaillé avec l’armée française de 2004 à 2014. "Avant le départ, on nous traitait de traîtres et d’infidèles, c’était très dangereux, dit-il. Nos camarades, nos amis avec qui on a travaillé 10 ans sont pris au piège là-bas, et on ne comprend pas pourquoi on ne les sort pas de là."
Au même moment, un rassemblement avait lieu à Kaboul à proximité de l'ambassade de France, pour réclamer "la protection" et la "solidarité de la France pour les interprètes en danger".
Au total, 70 000 soldats français ont été déployés en Afghanistan entre fin 2001 et fin 2014, dont 89 ont été tués et environ 700 blessés. Quelque 700 Afghans ont travaillé à leurs côtés, comme mécaniciens, employés de ménage ou interprètes. Une centaine parmi ces derniers ont bénéficié d'un processus de "relocalisation" en France. D'autres sont restés sur place ou ont tenté les routes de l'exil, parfois au péril de leurs vies.


Mali, treize morts pour rien ?
Le tragique accident qui a causé la mort de treize militaires au Mali le 25 Novembre a provoqué une réaction salutaire d’un ancien militaire français qui s’interroge sur la pertinence de l’intervention française au Mali. Voici son texte.
« Terrible accident, terrible nouvelle que celle de ces treize valeureux soldats tués dans cette collision d’hélicoptères dans la zone du Liptako Gourma, dite zone des trois frontières, lors d’une intervention de nuit face à un Groupe Armé Terroriste identifié comme faisant partie de l’EIGS (État islamique dans le Grand Sahara).
Dans les interrogations que cet incident ne manquera pas de soulever en France, viendront peut-être celles sur les raisons de la présence militaire française dans le Sahel. Sans nul doute cette intervention ne sera pas facile à être remise en question, car d’évidence elle arrange bien les desseins des factions aux commandes en Afrique ou en France
Des questions légitimes
Après presque sept années d’intervention, quel progrès réel observe-t-on ? Quelles améliorations ? La situation sécuritaire générale s’est-elle améliorée? Les populations locales vivent-elles mieux ? Et puis surtout, et au fond : de quoi s’agit-il ? De quoi on parle au-delà des discours rassurants ou moralisateurs ?
S’agit-il de lutter contre l’islam radical ? De défendre des intérêts d’entreprises minières ou pétrolières ? D’empêcher le génocide de chrétiens par des milices armées musulmanes radicales ? De participer au maintien au pouvoir de régimes politiques qui sont favorables à la France ? D’occuper le terrain pour que d’autres ne l’occupent pas à sa place ? De donner un bel os à ronger aux militaires plutôt que de les voir dans une situation extrême-devenir un éventuel contre-pouvoir face à un gouvernement contesté ?
La guerre, source de profits
L’importante question de savoir si cette politique africaine nous coûte ou nous rapporte devra être soulevée ! Et si elle est source de profits ou d’avantages, pour qui ? Les causes échappent à peu près tout le monde dans un pays endeuillé…
Tout ceci va donc peut-être être enfin mis à la lumière nue et crue du jour ! … Du moins si les journalistes -pour peu qu’il y en aurait encore- font bien leur boulot.SOURCE : https://mondafrique.com/mali-treize-morts-pour-rien/
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 4 Mars 2022 à 07:09

« Y’en a qui sont fiers du général Bigeard et « ses crevettes » moi je suis admirateur du général Pâris de Bollardière… Eh oui chacun ses valeurs et ses héros »
Le général qui s'éleva contre la torture lors de la guerre d'Algérie
Merci Mon Général

JACQUES PARIS DE BOLLARDIERE
Lors de la guerre d'Algérie -une guerre qui ne voulait pas dire son nom- le général Jacques Pâris de Bollardière s'est affranchi des règles de discipline en vigueur dans l'armée pour dénoncer jusqu'aux plus hauts niveaux de la hiérarchie militaire et au plus haut sommet de l'Etat, la pratique systématique de la torture contre les militants révolutionnaires du Front de libération nationale. Fort de ses convictions, il a osé s'opposer frontalement à un pouvoir politique tout puissant mû par les intérêts supérieurs inhérents à la raison d'Etat.
Né le 16 décembre 1907, le général de Bollardière est issu d'une vieille famille de la noblesse bretonne, fervente catholique. En dehors de la lignée ou du nom à particule, sa vraie noblesse fut bien celle du cœur et de l'esprit. Dans le sillage de son père et nombre de ses aïeux, Jacques Pâris de Bollardière embrasse très jeune la carrière des armes. A l'âge de vingt ans, il intègre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, après un cycle d'études au Prytanée national militaire de la Flèche. Après sa première affectation au 146ème régiment d'infanterie à Saint-Avold dans la Somme, le jeune soldat de Bollardière est affecté au 173ème régiment d'infanterie à Bastia en Corse. Ses supérieurs s'accommodent mal de l'indépendance d'esprit dont il fait montre dans l'exercice de sa mission militaire. Son caractère bien trempé ne l'empêche nullement d'accéder en 1932 au grade de lieutenant. Trois ans plus tard, il décide de changer de corps de rattachement et s'engage dans la Légion étrangère. A ses yeux, si le métier de soldat est d'obéir à des chefs militaires, il consiste aussi à servir une nation tant avec intelligence que courage et non d'obéir aveuglement. C'était là une ligne de conduite que Jacques Pâris de Bollardière va s'imposer avec constance tout au long de sa carrière dans l'armée.
Un militaire pétri de valeurs morales
Au déclenchement de la deuxième guerre mondiale, le ralliement de Jacques Pâris de Bollardière aux Forces françaises libres (FFL) lui vaut la destitution militaire par le régime de Vichy et une condamnation à mort. Quoi qu'il en soit, il était plus vivant que jamais dans son combat contre l'armée allemande et le fanatisme nazi. Il avait la certitude de servir non seulement la France, mais l'humanité entière menacée dans son devenir. Sans doute la rage dévastatrice des Allemands l'a-t-elle interrogé sur l'homme et les ressorts profonds qui commandent à ses actes. Peut-être a-t-il ressenti du dégoût, de l'abomination pour tous les excès que la guerre charrie dans son sillage.
En 1943, Jacques Pâris de Bollardière rejoint les services spéciaux de la France libre. Le 12 avril 1944, il est parachuté avec d'autres officiers à Mourmélon dans les Ardennes, ayant le commandement de la mission «Citronnelle» qui consistait à organiser le maquis des Manises. Mais une vigoureuse intervention militaire allemande compromet l'opération. Le 13 juin 1944, pas moins de 104 maquisards sont capturés et soumis à des interrogatoires sévères accompagnés de tortures, avant d'être tous fusillés et jetés dans des charniers. Témoin de telles atrocités, Jacques Pâris de Bollardière, alias «Colonel Prisme» pour les besoins de la mission Citronnelle, va en garder le souvenir le plus amer de la guerre. Il refusait de croire que la nature de la guerre emprunte à la nature humaine, que l'une est réductible à l'autre. Ses sentiments, ses pensées intimes le faisaient entrer, avec le recul du militaire, dans un débat de conscience sans fin. Deux aspects du même homme pesaient l'un avec l'autre, pour se fondre l'un dans l'autre par la vertu de la raison et du cœur.
Dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale, Jacques Pâris de Bollardière vécut une lourde expérience à la fois en tant qu'homme et en tant que militaire. Des grands bouleversements du monde, il tira des enseignements pleins de vérité sur les vertus et les bassesses humaines, les sincérités et les ruses, les lâchetés et les courages, les abandons et déshonneurs, les résistances et sacrifices. Il prit la mesure de l'abîme qui sépare les hommes et plus que tout cette part de folie destructrice qui atteint à l'essence même de l'humanité. Sa conviction était que la volonté de puissance de l'Allemagne nazie, ses ambitions démesurées au prix des pires cruautés étaient la rançon de la civilisation. Combattant volontaire de la France libre, son engagement répondait à un impératif moral indissociable des valeurs qui fondent le respect de l'homme. Où était la gloire dont l'humanité s'honore dans les sciences et le progrès s'il fallait mettre en perspective le coût humain exorbitant de la guerre, les destructions à grande échelle, les assassinats d'otages, les camps de concentration, la déportation ?
Les évènements tragiques de la deuxième guerre mondiale affectèrent Jacques Pâris de Bollardière au plus profond de son âme. Tout l'homme en sera profondément marqué pour la suite de sa carrière militaire. C'est lors de la guerre d'Algérie qu'il va donner la pleine mesure de ses convictions personnelles.
Un général partisan de la prééminence de l'action sociale sur la répression militaire en Algérie
Jacques Pâris de Bollardière est promu, à l'âge de quarante-neuf ans, général de brigade. Il est alors le plus jeune général de l'armée française. En juillet 1956, il fait l'objet, à sa demande, d'un détachement en Algérie aux heures les plus intenses des affrontements entre combattants du FLN et forces armées françaises. Affecté à la Division militaire d'Alger, il se voit confier le commandement du secteur Est de l'Atlas blidéen, situé entre les dernières limites de la banlieue d'Alger et les premiers contreforts des massifs de Kabylie. Une zone sensible, particulièrement innervée par les réseaux nationalistes, où étaient implantées les grandes exploitations agricoles de la Mitidja et une population indigène en grande partie employée à leur service. Comme en Indochine, Jacques Pâris de Bollardière découvre que la France n'était pas en guerre pour une cause mais contre un peuple. Le poids des injustices s'y faisait lourdement sentir. Les inégalités sociales se doublaient de la violence coloniale. Un contexte où la révolution armée y trouvait un foyer des plus favorables.
Avec le lieutenant de réserve Jean-Jacques Servan Schreiber, futur patron de «L'Express», Jacques Pâris de Bollardière met en place des unités baptisées «Commandos nomades», dont la mission consistait à établir des contacts avec les populations indigènes et instaurer des liaisons administratives avec les douars les plus reculés. Dans ce cadre de nombreux projets virent le jour, mais ils étaient immanquablement privés de lendemain, faute de crédits et de moyens. Depuis le 30 août 1955, l'Algérie vivait sous l'état d'urgence, une mesure que vint renforcer la loi sur les «pouvoirs spéciaux» adoptée le 16 mars 1956. Dès lors, le gouvernement était habilité à prendre les mesures exceptionnelles propres à assurer le rétablissement de l'ordre en Algérie. Dotée des pleins pouvoirs, l'armée entendait en faire le plus large usage afin de décapiter la rébellion. Le haut commandement avait désormais les coudées franches dans la conduite de la guerre d'Algérie. Ce qui frappait si fort Jacques Pâris de Bollardière, ce qui le bouleversait amèrement, c'est que depuis le déclenchement de la révolution armée, il régnait au sommet des hiérarchies civiles et militaires de l'appareil d'Etat, une sorte de bonne conscience qui témoignait d'un large consensus sur la politique de radicalisation de la répression contre les insurgés, sans que nul ne fasse la part du feu dans l'incendie. Eprouvait-il un amour pour cette terre ou peut-être n'éprouvait-il rien ? Mais il n'était guère indifférent à la condition du peuple algérien. Pour lui, l'Algérie n'était pas seulement un territoire dans l'immensité des terres fertiles dédiées à la colonisation, mais une chair vivante dont il éprouvait les sensations secrètes et les sollicitations invisibles. Ainsi se sentait-il tiraillé par ce champ de forces contradictoires qui le portaient, le repoussaient ou lui résistaient. Les vérités essentielles de l'humanité lui apparaissaient dans leur évidence. Au nom de quelle loi supérieure des hommes étaient-ils proscrits ? N'étaient-ils pas tous pétris de la mêmepâte humaine ? Ne partageaient-ils pas une même condition humaine ?
Fidèle à sa ligne de pensée, Jacques Pâris de Bollardière estimait que si la logique de la guerre est de tendre vers la paix, rien à ses yeux ne le laissait percevoir en Algérie où il était fait appel à un usage inconsidérée de la violence contre un adversaire qui luttait pour conquérir le droit de vivre dans la liberté. C'est dans l'action sociale destinée à l'amélioration des conditions de vie de la population algérienne qu'il voyait une chance de salut et non dans le sang versé sur fond d'affrontements sans merci. Une opinion empreinte de vérité que Jacques Pris de Bollardière va défendre avec conviction, pour avoir vu la réalité de la misère et de la détresse du peuple algérien. Seule une solution politique qui privilégiait le respect absolu de la dignité humaine lui semblait être en mesure de préserver un avenir de coexistence entre les deux communautés, coloniale et colonisée. A-t-il été entendu ? La classe politique restait sourde à l'évidence.
L'institutionnalisation de la torture
Jacques Pâris de Bollardière a été de tous les combats de la France libre qui le menèrent sur de multiples théâtres d'opérations. Il a connu la guerre d'Indochine et ses sanglantes batailles. Il fit deux séjours dans la péninsule indochinoise, de 1946 à 1948 et de 1950 à 1953 en tant que commandant des troupes aéroportées. Il se prit de sympathie pour le peuple vietnamien en lutte pour son indépendance et ne s'empêcha pas d'exprimer ouvertement sa répugnance pour la guerre qui lui était faite. En toutes circonstances, il fit preuve d'un courage physique exemplaire et sut montrer dans le même temps un sens élevé des valeurs humaines. Rechercher la victoire au prix de l'avilissement de l'adversaire n'entrait pas dans sa vision de la guerre. Mais c'est lors de la bataille d'Alger en 1957 que va se révéler l'homme dans sa pleine dimension.
Que dut être difficile ce jour où Jacques Pâris de Bollardière apprit de son service de renseignement que des musulmans dans son secteur de Blida, partie intégrante de la Division militaire d'Alger placée sous les ordres du général Massu, étaient enlevés de nuit, sans qu'il en soit informé. Dans l'ignorance de leur sort, il ne pouvait répondre à l'appel angoissé des familles. C'est ce jour-là de l'année 1957, en pleine bataille d'Alger, que tout a commencé. Le général Jacques Pris de Bollardière va faire de la dénonciation de l'usage de la torture contre les militants du FLN, un engagement personnel. Ce fut une implication si personnelle qu'elle en deviendra le combat de sa vie.
Bien malgré lui, le général de Bollardière s'est trouvé pris dans l'engrenage de la nouvelle stratégie mise en place par le général Massu, qualifiée de guerre antisubversive. Celle-ci incluait la libre pratique de la torture parmi les méthodes de nature à démanteler les réseaux du FLN et décapiter la rébellion.
En mars 1957, une directive du général Allard, commandant du corps d'armée d'Alger, recommande d'utiliser dans toute l'Algérie « les procédés employés à Alger et qui ont fait la preuve de leur efficacité ». A partir de là, des « centres de renseignement et d'action » sont mis en place en divers endroits du territoire algérien. C'est l'institionnalisation de la torture. Les plus hautes autorités de l'Etat légitiment son usage et cautionnent tous les dépassements de l'armée que la censure militaire couvre d'un silence de plomb. Avec le général Massu la torture est pratiquée systématiquement, sans la moindre retenue. A chaque attentat du FLN, les arrestations se multiplient, toute trace des détenus disparait, tous condamnés d'avance au supplice à huis clos, lors d'interrogatoires appelés pudiquement «interrogatoires poussées», où la torture dans toute sa barbarie faisait loi.
La villa Sesiny d'El-Biar abrita un des principaux centres de torture d'Alger. L'odeur de chair brûlée, les appels de voix désespérés, les silences au goût de sang où se nouait la mort, hantent à jamais les lieux. L'épreuve de la baignoire ou du bac à eau, celle de l'électricité qui faisait tourner la gégène à plein régime, ou encore celle de la bouteille si avilissante, témoignent des atrocités commises par des militaires vidés de toute substance humaine, aguerris à l'horrible rituel des interrogatoires musclés. Devant ces procédés dignes des pires actes de barbarie, le général de Bollardière avait la vision aigüe d'une France qui perdait ses repères. Le désarroi des jeunes soldats du contingent pris entre la désobéissance aux ordres et la menace de mesures disciplinaires ajoutait à cette sourde colère qui le tenaillait en profondeur.
«Le devoir d'Antigone»
«Seul contre tous», ainsi pourrait-on dire du général de Bollardière, dans sa dénonciation de la torture et ses graves dérives lors de la guerre d'Algérie. Devait-il se taire et par là même se rendre complice des partisans de la torture ? Comment fermer les yeux sur une pratique qui lui était intolérablement cruelle, qui le blessait au vif de ses sentiments profonds ? Le recours généralisé à « la Question » pendant la guerre d'Algérie ignorait les fragiles barrières de la conscience et de la morale. Les actes de torture étaient considérés comme de simples bavures dues à des militaires trop zélés. Le général de Bollardière ne se résigna pas à cet état de fait. La torture l'atteignait dans son honneur militaire. C'est ce pourquoi il en fera sa cause. Face aux intérêts supérieurs de la raison d'Etat, il oppose les limites indépassables de la conscience humaine. Aucun rempart ne le fera fléchir dans sa détermination. Le risque de compromettre sa carrière ne lui effleurait guère l'esprit. Ce fut le combat sans concession d'Antigone.
Dans un message du 18 février 1957, le général de Bollardière s'adresse à tous les officiers de son secteur de l'Atlas blidéen, en ces termes : « La tentation à laquelle n'ont pas résisté les pays totalitaires de considérer certains procédés comme une méthode normale pour obtenir le renseignement doit être rejetée sans équivoque, et ces procédés condamnés formellement ».
Ce qui apparaissait comme une faute de discipline militaire va provoquer un malaise au sein du haut commandement de l'armée et une gêne infinie dans les milieux officiels. Ayant résolument pris le parti de prendre ses distances avec le mensonge, l'oppression et l'abus de pouvoir, le général de Bollardière exprime d'emblée son mépris pour la stratégie du général Massu fondée sur l'arme de la torture. Par devoir de conscience, il refuse catégoriquement sa collaboration à cet ami de longue date, son camarade de promotion à Saint-Cyr. L'entretien qu'ils eurent ensemble le 8 mars 1957, tourna au dialogue de sourds entre deux positions diamétralement opposées. Ils sont en total désaccord.
En quête d'un interlocuteur susceptible de partager son point de vue, le général de Bollardière remonte par degrés la chaîne de commandement. Cette fois-ci il s'adresse au général Raoul Salan, commandant en chef de l'armée d'Algérie qu'il a connu en Indochine. L'entrevue ne lui laisse aucune illusion. Ni sympathie ni soutien. Un mur d'incompréhension se dresse inébranlablement entre les deux généraux. Rien ne semblait pouvoir remettre en cause la pratique de la torture, son opportunité et sa légitimité.
En cohérence avec ses principes, le général de Bollardière ne se résout pas à s'enfermer dans ce sordide pacte du silence qui entourait l'usage de la torture en tant que stratégie de lutte contre les militants révolutionnaires algériens. Il voulait arrêter ce cercle vicieux de l'enchaînement de la violence et de la surenchère de la haine.
Après Massu et Salan qui l'éconduirent poliment, le général de Bollardière reprit son plaidoyer auprès du ministre résident, Robert Lacoste. Ses arguments contre la torture répondent à un impératif moral qui relève du code non écrit de l'honneur. Il n'est point de commune mesure entre le métier de soldat et le métier de tortionnaire, ne cesse-t-il de répéter au cours de l'audience. Il met l'accent sur les aspects dramatiques de la guerre antisubversive à laquelle la France se livrait au mépris des valeurs éthiques qui devaient en temps de guerre imprégner l'esprit de l'armée. Rien ne le révoltait autant que ces opérations de lutte contre le « terrorisme urbain » où des militants révolutionnaires sont mis au secret et torturés à mort. Il plaide pour cette France grande par ses valeurs et ses principes. Il n'y avait pas, selon lui, une France métropolitaine et une France africaine en Algérie, il n'était qu'une seule France qu'elle s'établisse de ce côté-ci ou de ce côté-là de la Méditerranée et une seule armée au service de la nation qui ne pouvait souffrir, sans grand débat de conscience, de pratiques honteuses indignes de son prestige. Peine perdue. Robert Lacoste, le ministre résident, s'abstint tout au long de l'entretien, de formuler la moindre critique sur les méthodes peu orthodoxes du général Massu et ses fidèles paras chargés des basses besognes, ces « bérets rouges » devenus si familiers aux instruments et techniques de torture.
A l'issue de sa rencontre avec Robert Lacoste, le général de Bollardière se sentait terriblement seul. Il avait épuisé son ultime recours. L'incantation du militaire laissait place à la plus amère déception. Il s'était investi de toute sa personne contre la torture. Il mit tout son poids de général sans pour autant réussir à en interdire l'usage.
Le 7 mars 1957, le général de Bollardière adresse au général Raoul Salan une lettre dans laquelle il demande à être relevé de son commandement. Il lui était difficile de rester dans une armée chargée d'histoire et de traditions, où la conscience morale était abolie, où la torture faisait injure à la France. Il estimait, en conscience, ne plus pouvoir exercer sa mission militaire.
Après avoir abandonné son commandement en Algérie, le général de Bollardière décide d'expliquer son geste à l'homme à qui il voue une confiance absolue, le général de Gaulle. Il avait besoin de parler de son cas de conscience avec celui qu'il admirait comme aucun autre, et dont il était le compagnon dans l'ordre de la Libération.
Dans une interview donnée, le 15 novembre 1971, à l'hebdomadaire « Le Nouvel Observateur », le général de Bollardière déclare en substance : « Le général de Gaulle m'a reçu immédiatement. Pendant une heure ou davantage, je lui ai expliqué en détail les raisons qui m'avaient conduit à demander à être relevé de mon commandement... Il m'a écouté avec une très grande courtoisie. Je suis incapable, cependant, de vous dire ce qu'il a pensé de ce que je lui ai dit. Il a très peu parlé. Il a pris acte ».
En vain, le général de Bollardière ne put briser le complot de silence noué autour de la torture en Algérie. Toutes les censures avouées ou occultes étaient de la partie. Les services de l'armée et de la police contrôlaient étroitement journalistes, photographes et cameramen afin de faire obstacle à leur travail d'investigation et d'information du grand public. Les gouvernements successifs, les différents corps constitués au premier rang desquels l'armée, entreprirent dès le début de la bataille d'Alger, de proposer aux médias une version des évènements expurgée de la torture. Celle-ci est passée sous silence, comme du reste toutes les exactions commises par l'armée française étaient mises sous le boisseau. Nombre de médias jouaient de bon gré le rôle de relais des pouvoirs civil et militaire. Une rhétorique de guerre manichéenne vantait la noblesse de l'action française en Algérie, la fidélité des musulmans à la France et leur refus de suivre les insurgés du FLN, l'ennemi juré du gouvernement de la métropole.
Fidèle à ses principes jusqu'au bout
Guère entendu, abandonné de tous ou presque, le général de Bollardière est mis à l'écart. Il sera nommé sur des fonctions honorifiques qui l'éloignent de tout commandement. Il garde un profond ressentiment envers tous ceux qui ont couvert de leur autorité l'usage de la torture, sous ses multiples formes, pour faire échec à l'insurrection armée et humilier les âmes. Cependant, il se refuse de reconnaitre sa défaite. Il ne peut accepter d'être traitre à ses principes, à la cause pour laquelle il s'est battu avec obstination. Une juste cause par sa dimension éminemment éthique.
Par un concours de circonstances, le général de Bollardière ne va pas tarder à rebondir sur la question de la torture en Algérie. Un évènement inattendu lui en donne l'opportunité. Le directeur de « L'Express », Jean-Jacques Servan Schreiber, publie en janvier 1957 un ouvrage intitulé « Lieutenant en Algérie », où il apporte un témoignage accablant sur les dures réalités d'une guerre coloniale qu'il a vue et vécue en tant qu'officier rappelé sous les drapeaux en août 1956. L'absurdité de la guerre d'Algérie s'y lit en filigrane. La réaction du ministre de la Défense nationale, Maurice Bourges Maunoury, ne se fait pas attendre. Jean-Jacques Servan-Schreiber doit répondre du chef d'inculpation d'atteinte au moral de l'armée. C'est l'occasion rêvée pour le général de Bollardière d'apporter non seulement son soutien plein et entier à cet officier qui a servi sous ses ordres pendant les dix mois qu'il a passés en Algérie, mais aussi de dénoncer publiquement les graves dérives qui entachaient l'action de l'armée et mettaient à mal les principes éthiques qui fondent la conception de la dignité et de l'intégrité physique de la personne humaine. Des principes qui ne pouvaient supporter la moindre dérogation. L'usage de la torture en Algérie prouvait tout le contraire. Le général de Bollardière se sentait le devoir moral de s'affranchir des règles strictes de l'armée quant à l'expression des opinions personnelles et d'ignorer les châtiments de la justice militaire. Il va porter la question de la torture sur la place publique et mettre le peuple français face à une sordide réalité, celle de la guerre d'Algérie dans toute sa vérité et son horreur.
Le 27 mars 1957, le général de Bollardière adresse une lettre à « L'Express », reprise dans « Le Monde » du 29 mars, dans laquelle il met l'accent sur « l'effroyable danger qu'il y aurait pour la France à perdre, sous le prétexte fallacieux d'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à présent la grandeur de sa civilisation et de son armée ».
L'écrit du général de Bollardière fait grand bruit. Le secret d'Etat bien gardé sur la torture en Algérie est désormais connu de tous les Français. Le voile sur la torture est enfin levé par un dignitaire de l'armée. Le silence de connivence des plus hautes autoritésest brisé. Dès lors, le débat sur la torture s'invite dans les médias et les cercles officiels. Des témoignages directs de soldats viennent alimenter la polémique. Le peuple français vit un véritable drame de conscience. A l'étranger, l'image de la France est sérieusement écornée.
En conséquence de sa prise de position contre la torture qu'il rendit publique dans la presse, le général de Bollardière, héros de la Résistance, est frappé d'une sanction de soixante jours d'arrêt de forteresse. Il avait fait sciemment acte de désobéissance, sachant bien qu'un officier en activité n'a pas le droit d'exprimer ses opinions dans la presse sans avoir au préalable obtenu l'accord du ministre des armées.
Le départ anticipé à la retraite comme dernier recours
Le 21 avril 1961, en réaction à une conférence de presse que tint le général de Gaulle au cours de laquelle il se prononça pour une « Algérie algérienne », quatre généraux d'armée, en l'occurrence Jouhaud, Challe, Salan et Zeller, prennent le pouvoir à Alger dans l'objectif de s'opposer à toute politique d'abandon de l'Algérie française. C'est le putsch des généraux, un coup d'Etat militaire qui sera vite mis en échec par le gouvernement de la métropole. A la suite de cet événement inédit où des officiers généraux de premier rang se dressaient contre les institutions de la République, le général de Bollardière demande sa mise à la retraite après trente années de service actif dans l'armée. Sa décision est irrévocable. Pour ce militaire si fortement attaché à ses principes, qui n'eut de cesse de faire le procès de la torture en Algérie, la conjuration des généraux lui était intolérable. Il n'avait plus sa place dans une institution qui trahissait l'esprit de l'armée, tel qu'il le concevait.
Une vie dédiée au combat pour l'homme
Droit, noble d'esprit et vaillant, le général de Bollardière, Bollo comme l'appelaient les militaires, a toujours placé les exigences majeures de l'homme qu'il était au-dessus des intérêts étroits et des surenchères de la classe politique. La pureté des principes qui l'animèrent toute sa vie durant en porte témoignage. Ce brillant officier supérieur s'est fait le critique sévère de tout un système politico-militaire qui érigea la torture en arme de combat lors de la guerre d'Algérie. S'il n'a pas été entendu, il n'en fut pas moins dérangeant. Nul autre officier de son rang ne conçut respect plus vif de la dignité inhérente à l'être humain, y compris envers son propre ennemi. En cela, ses convictions proclamées et son engagement inflexible ne se démentirent pas, malgré les obstacles, les manœuvres hostiles, les tentatives de discrédit et de disgrâce. Par ses vertus humanistes, il a su prouver que le courage pour un militaire de son rang n'était pas seulement de combattre l'adversaire, mais aussi de refuser un combat qui supposerait admis le recours à cette pratique peu glorieuse, dégradante, qu'est la torture dans toute sa terreur. Il a refusé de servir dans une armée dont les chefs, aussi combatifs fussent-ils, avaient fait abstraction de toute conscience.
En dénonçant l'usage la torture pendant la guerre d'Algérie, le général de Bollardière n'avait pas la prétention d'écrire l'histoire, il voulait seulement ouvrir une brèche dans le mur de silence monolithique des politiques, des parlementaires et des membres du gouvernement. Son action aura eu le mérite de placer la question morale au-dessus de la question coloniale. Pénétré de cette vérité, le général de Bollardière n'a eu de cesse d'interpeller le gouvernement de la métropole sur la nécessité impérieuse d'interdire la torture pratiquée par l'armée française en Algérie, convaincu qu'une telle décision se situait, par essence universelle, au-dessus des considérations politiques.
En 1972, à la sortie de l'ouvrage que le général Massu a consacré à la bataille d'Alger, le général Jacques Pâris de Bollardière écrit en réplique : « Bataille d'Alger, bataille de l'homme ». C'est une réponse cinglante à Massu où il réfute sa version des faits et met les évènements en perspective. Il se confie en ces termes : « Massu a-t-il dit toute la vérité ? Il proclame en tout cas, avec une certaine forme de courage, les raisons qui l'ont poussé à assumer la terrible responsabilité d'actes abominables. Mais le vrai courage ne consiste-t-il pas à se voir soi-même sous le regard de celui qu'on vient de supplicier ? Cet autre dont nous avons nié les droits et la dignité ». Ces mots témoignent, à n'en pas douter, de la grandeur d'âme qui caractérisait cet acteur privilégié de la guerre d'Algérie.
En dépit du strict devoir de réserve auquel il était astreint, autrement dit un quasi devoir de se taire, le général de Bollardière a osé dire non à la torture. Entre le silence et la conscience, il a choisi de ne pas se compromettre dans un silence coupable, ni de cautionner des méthodes et des pratiques que sa conscience reprouvait totalement. Il fit montre d'un engagement sans faille pour le respect de la dignité de la personne humaine dans cette Algérie en lutte qui avait pris visage d'enfer par le fait des tortures, des mutilations et de la mort pour finir.
Le général de Bollardière fit le choix de l'homme sur le militaire. Un choix non pour une quelconque ambition politique, mais pour la morale. S'il fut brimé de tout commandement, ce n'était pas la sanction d'une nation, mais bien celle d'un pouvoir politique. La France coloniale aux prises avec sa fureur, ses aveuglements et ses surdités avait besoin de voix comme la sienne pour qu'elle revienne à la raison. L'histoire retiendra la détermination irréductible dont fit preuve ce général, unique entre tous, dans son combat contre l'usage de la torture lors de la guerre d'Algérie.par Djamal Kharchi
Auteur. Ex-Directeur Général de la Fonction Publique - Docteur en sciences juridiquesJeudi 3 mars 2022
SOURCE : http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5310393
Jacques de Bollardière, le généralqui refusa la torture
C’est dingue ça, le militaire le plus décoré de la Résistance a été le seul à avoir dénoncé la torture en Algérie, il a fait 2 mois de forteresse, a viré non-violent puis anti-nucléaire, et je n’avais JAMAIS entendu parler de lui !
On honore les résistants aux nazis, un petit peu moins à ceux contre Vichy (c’est compliqué etc.), mais il ne faut pas faire trop de pub aux militaires qui ont résisté à l’État tortionnaire (en Algérie ou ailleurs)….
Un héros, super connu il y a 50/60 ans :
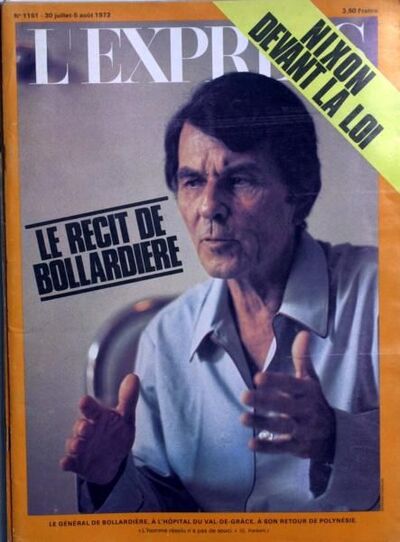
et hop, rayé des mémoires !
Après le soldat inconnu, le général inconnu…
La fabrique du crétin, c’est un métier…
Seconde partie du billet sur la quasi-censure du documentaire de 1974 lui ayant été consacré… (dingue, sans Gazut, on n’aurait presque rien su sur lui…) Eh, devenez cinéastes les jeunes !
Le documentaire caché : le général non-violent
Eh bien comme les grandes chaînes ont caché ce documentaire pendant 60 ans, on va le montrer ici – et je vous encourage à en faire de même…

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour voir
le documentaire complet :
Source : Youtube, André Gazut

Il y a soixante ans, le général Jacques de Bollardière condamnait la pratique de la torture

Jacques de Bollardière est le seul officier supérieur à avoir condamné ouvertement la pratique de la torture pendant la guerre d’Algérie.
En 1957, il tente par tous les moyens de dénoncer “certains procédés” en vigueur dans la recherche du renseignement en Algérie. Sa prise de position publique lui vaut une sanction de soixante jours d’arrêt …

Un carrefour Bollardière à ParisParis a son carrefour Général-de-Bollardière. Il a été inauguré le jeudi 29 novembre 2007. Il est situé à l’angle de l’avenue de Suffren et de l’avenue de La Motte-Piquet, prés de l’École militaire. La décision avait été prise à l’unanimité du conseil municipal. La plaque porte une seule mention : « Compagnon de la Libération ». Ses titres de résistance sont en effet des plus glorieux, étant l’officier français le plus décoré par les alliés. Le nom de Bollardière, cependant, incarne encore l’honneur militaire, et l’honneur tout court, pour un autre théâtre d’opérations. Promis aux plus hautes fonctions, le général de Bollardière eut le courage de dénoncer la torture pendant la guerre d’Algérie, ce qui lui valut deux mois de forteresse. La présence de ceux, Algériens et Français, qui ont été de cette histoire, présence souhaitée par Simone de Bollardière, signifie que ce combat n’est pas oublié.

Jacques Pâris de Bollardière est né le 16 décembre 1907, à Châteaubriant. Il sort de Saint-Cyr en 1930.
En 1939, il est lieutenant à la Légion Étrangère dans le Sud marocain ; il reçoit le baptême du feu à Narvick.Résistant de la première heure, il rejoint l’Angleterre en juin 1940, et participe à tous les combats des F.F.L. avec la 13e Demi-brigade de la Légion Étrangère. En avril 1944, il commande la mission Citronnelle dans le maquis des Ardennes. Jacques de Bollardière a été le soldat le plus décoré de la France libre : grand officier de la Légion d’honneur, compagnon de la Libération, deux fois décoré du DSO (Distinguished Service Order ) …
Après un commandement en Indochine à la tête des troupes aéroportées, il est instructeur à l’École de Guerre. En 1956, il est muté en Algérie, et, en juillet de la même année, il est nommé général.
Jacques de Bollardière tente par tous les moyens de dénoncer “certains procédés” en vigueur dans la recherche du renseignement.
En mars 1957, il demande à être relevé de son commandement en Algérie – sa lettre à Salan lui demandant de le relever :
Au même moment, Jean-Jacques Servan-Schreiber, redevenu directeur de l’Express, est inculpé d’atteinte au moral de l’armée pour avoir publié plusieurs articles relatant son expérience algérienne et dénonçant l’attitude du gouvernement français. Il demande alors à son ancien chef, de Bollardière, de lui écrire une lettre de soutien ; celle-ci parut dans l’Express du 29 mars 1957 :
Le 21 mars 1957
Mon cher Servan-Schreiber,
Vous me demandez si j’estime que les articles publiés dans « L’Express », sous votre signature, sont de nature à porter atteinte au moral de l’Armée et à la déshonorer aux yeux de l’opinion publique.
Vous avez servi pendant six mois sous mes ordres en Algérie avec un souci évident de nous aider à dégager, par une vue sincère et objective des réalités, des règles d’action à la fois efficaces et dignes de notre Pays et de son Armée.
Je pense qu’il était hautement souhaitable qu’après avoir vécu notre action et partagé nos efforts, vous fassiez votre métier de journaliste en soulignant à l’opinion publique les aspects dramatiques de la guerre révolutionnaire à laquelle nous faisons face, et l’effroyable danger qu’il y aurait pour nous à perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l’efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu’à maintenant la grandeur de notre civilisation et de notre Armée.
Je vous envoie l’assurance de mon estime …
Note Berruyer : Il y avait une vraie presse à l’époque…
Sa lettre fait grand bruit et lui vaut, le 15 avril, une sanction de soixante jours d’arrêt à la forteresse de la Courneuve. Après quoi il est mis à l’écart : nommé successivement en Afrique centrale (A.E.F.), puis en Allemagne.
Le putsch d’Alger d’avril 1961 l’amène, à 53 ans, à prendre une retraite prématurée : “le putsch militaire d’Alger me détermine à quitter une armée qui se dresse contre le pays. Il ne pouvait être question pour moi de devenir le complice d’une aventure totalitaire”.
Il s’occupe alors de formation professionnelle des adultes. Quelques années plus tard, il est l’un des fondateurs du Mouvement pour une Alternative non-violente, et publie en 1972 : Bataille d’Alger, bataille de l’homme.
Jacques de Bollardière s’est toujours référé à son éthique chrétienne, pour affirmer le devoir de chacun de respecter la dignité de l’autre. Il a écrit : “La guerre n’est qu’une dangereuse maladie d’une humanité infantile qui cherche douloureusement sa voie. La torture, ce dialogue dans l’horreur, n’est que l’envers affreux de la communication fraternelle. Elle dégrade celui qui l’inflige plus encore que celui qui la subit. Céder à la violence et à la torture, c’est, par impuissance à croire en l’homme, renoncer à construire un monde plus humain.”
Jacques de Bollardière est décédé en février 1986, mais sa veuve, Simone de Bollardière, est l’une des signataires de l’appel des douze : le 31 octobre 2000, douze personnes, dont Henri Alleg qui survécut à “la question” et Josette Audin veuve d’un jeune mathématicien qui succomba, ont demandé une condamnation publique de l’usage de la torture pendant la guerre d’Algérie.
L’inacceptable
« Vers le début de janvier 1957, tout s’accéléra soudain et devint menaçant. Une violente poussée de terrorisme plonge Alger et sa région dans la fièvre. Pour faire face à la situation on met en place une nouvelle organisation de commandement dans laquelle mon secteur se trouve englobé. Le général Massu, commandant la 10ème Division parachutiste, en est le chef. Les pouvoirs civils abandonnent entre ses mains la totalité des pouvoirs de police qu’il décentralise aussitôt jusqu’au dernier échelon de la hiérarchie dans la division parachutiste. […]
Des directives me parviennent, disant clairement de prendre comme premier critère l’efficacité et de faire passer en priorité les opérations policières avant toute pacification. Des femmes musulmanes atterrées, viennent m’informer en pleurant que leurs fils, leur mari, ont disparu dans la nuit, arrêtés sans explication par des soldats brutaux en tenue camouflée et béret de parachutistes. […]
Quelques heures plus tard, je reçois directement l’ordre de faire exécuter immédiatement par mes troupes une fouille de toutes les mosquées du secteur pour y chercher des dépôts d’armes. Je refuse d’exécuter cet ordre reçu dans des conditions irrégulières et que je juge scandaleuses ; j’estime de plus qu’une telle provocation risque de ruiner les efforts de plusieurs mois. Je demande alors à être reçu immédiatement par le général Massu.
J’entre dans son vaste bureau […] Je lui dis que ses directives sont en opposition absolue avec le respect de l’homme qui fait le fondement même de ma vie et que je me refuse à en assumer la responsabilité.
Je ne peux accepter son système qui conduira pratiquement à conférer aux parachutistes, jusqu’au dernier échelon, le droit de vie et de mort sur chaque homme et chaque femme, français ou musulman, dans la région d’Alger…
J’affirme que s’il accepte le principe scandaleux de l’application d’une torture, naïvement considérée comme limitée et contrôlée, il va briser les vannes qui contiennent encore difficilement les instincts les plus vils et laisser déferler un flot de boue et de sang…
Je lui demande ce que signifierait pour lui une victoire pour laquelle nous aurions touché le fond de la pire détresse, de la plus désespérante défaite, celle de l’homme qui renonce à être humain.
Massu m’oppose avec son assurance monolithique les notions d’efficacité immédiate, de protection à n’importe quel prix de vies innocentes et menacées. Pour lui, la rapidité dans l’action doit passer par-dessus tous les principes et tous les scrupules. Il maintient formellement l’esprit de ses directives, et confirme son choix, pour le moment, de la priorité absolue à ce qu’il appelle des opérations de police.
Je lui dis qu’il va compromettre pour toujours, au bénéfice de la haine, l’avenir de la communauté française en Algérie et que pour moi la vie n’aurait plus de sens si je me pliais à ses vues. Je le quitte brusquement.
En sortant de chez lui, j’envoie au général commandant en chef une lettre lui demandant de me remettre sans délai en France à la disposition du secrétaire d’État à la Guerre.
Un faible espoir m’anime encore. Le général Massu n’est pas au niveau de commandement où se conçoit une politique et où se décide l’emploi des forces armées.
Je demande l’audience du Général commandant en chef et du ministre résidant . Je leur parle d’homme à homme et sors de leur bureau tragiquement déçu. J’ai le coeur serré d’angoisse en pensant à l’Algérie, à l’Armée et à la France. Un choix conscient et monstrueux a été fait. J’en ai acquis l’affreuse certitude.
Le lendemain, je prends un avion pour Nantes où m’attend ma famille. »
P.-S.
Le général de Bollardière est le seul officier supérieur qui n’ait pas été réintégré dans ses droits à la suite de la loi de réhabilitation de novembre 1982.
====================================================================================================================================================================Le général de Bollardière par sa femme
Source : Youtube
Interview Simone de Bollardiere 2004
Source : Youtube
==================================================================================
Jacques de Bollardière, le général qui refusa la torture – Archive vidéo INA
Source : Youtube, INA, 26-06-2001
Reportage. Portrait du général Jacques PARIS DE BOLLARDIERE, qui refusa d’appliquer la torture pendant la guerre d’Algérie. Des associations se battent pour qu’un film suisse qui lui a été consacré, réalisé en 1974 et intitulé “Le général de Bollardière et la torture”, soit diffusé en France. Le commentaire sur images d’illustration et extraits du film alterne avec les interviews de sa veuve Simone PARIS DE BOLLARDIERE, et d’André GAZUT, réalisateur du film. Images d’archive INA
Institut National de l’Audiovisuel==================================================================================
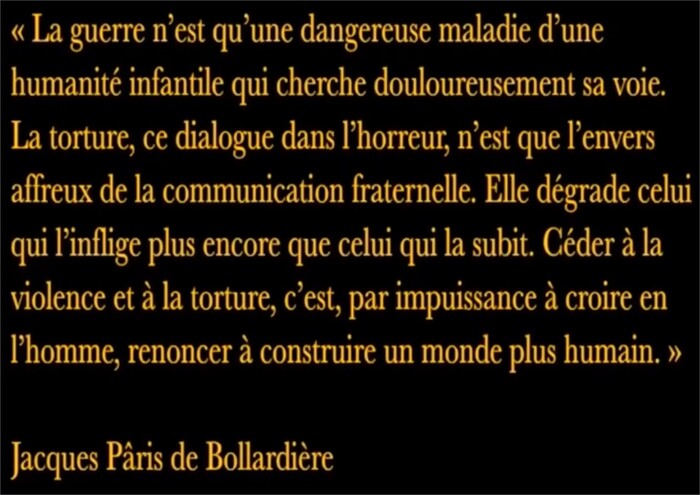
SOURCE : Jacques de Bollardière, le général qui refusa la torture
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 3 Mars 2022 à 08:02
3 mars 2022
Enrico Macias évoque de nouveau sa venue
en Algérie

Au crépuscule de sa vie, le chanteur français Enrico Macias ne désespère toujours pas de retourner un jour en Algérie, son pays natal. Dans un entretien publié, ce lundi 12 septembre, sur le quotidien régional Nice Matin, le chanteur de 83 ans est revenu encore une fois sur son vœu de visiter l’Algérie qu’il avait quittée, il y a plus de soixante ans. Tout en précisant qu’il n’est pas interdit de séjour en Algérie de manière officielle, Enrico Macias reconnaît toutefois la difficulté de voir son souhait exaucé.
Plus de soixante années après son départ d’Algérie, les blessures du chanteur Enrico Macias restent à vif. A chacune de ses nombreuses sorties médiatiques, celui qui a vu le jour à Constantine et qui a vécu une partie de sa jeunesse dans cette ville de l’Est algérien, ne cesse d’évoquer son rêve de visiter à nouveau son pays de naissance. Une question qu’il a soulevée à nouveau dans un entretien accordé ce lundi 12 septembre à Nice Matin.
Tout en refusant d’être le porte-parole des pieds-noirs, Enrico Macias avoue toutefois que la blessure de l’exil ne pourra jamais être refermée, soixante années après avoir quitté l’Algérie pour rejoindre la France. "Jamais. Pas tant que je porterai le deuil de mon beau-père Raymond", répond le chanteur. "Il faudrait une réconciliation entre tous les enfants d’Algérie, harkis, pieds-noirs et berbères", ajoute-t-il.
Pour Enrico Macias, la paix devra aujourd’hui laisser place à la haine, dans les relations entre les peuples français et algériens. "Quand on subit des épreuves comme la violence ou la guerre, on n’a pas envie de reproduire la même chose. Je n’ai pas d’esprit de revanche. J’ai choisi d’être prévenant et gentil parce que quand les gens sont gentils, on les agresse moins", affirme l’auteur de "J’ai quitté mon pays".
Enrico Macias affiche son désaccord avec Macron à propos de la colonisation
A une question sur son interdiction de séjour en Algérie et son souhait d’y revenir un jour, Enrico Macias répond : "Je ne suis pas interdit de séjour. Plus exactement, il n’y a rien d’officiel. J’ai failli y aller à trois reprises. A chaque fois, les autorités-pas la population- ont fait en sorte que ce voyage ne se fasse pas". Enrico Macias garde-t-il l’espoir de revenir un jour en Algérie ? "Maintenant je suis prudent. A 83 ans, je me suis fait une raison. Cela n’empêche pas la souffrance", répond-t-il.
Tout en refusant de répondre au polémiste Eric Zemmour qui affirmait qu’"on ne peut pas être un nazi lorsqu’on est juif", le chanteur a tenu par contre à exprimer son désaccord avec Emmanuel Macron qui avait qualifié "la colonisation de crime contre l’humanité". "Je ne suis pas d’accord. Un point c’est tout. Si j’avais eu l’occasion de le rencontrer, je lui aurai dit en face", explique Enrico Macias.
Sur cette question, le chanteur populaire a déjà été confronté aux défenseurs de la cause algérienne pendant la colonisation. Son débat avec Giselle Halimi reste encore dans les mémoires. L'avocate du FLN a entre autres expliqué au chanteur la différence entre antisémite et antisioniste. La colonisation française est considérée par les défenseurs des droits humains et pas seulement les Algériens comme un crime contre l'humanité. En 2022, seuls les nostalgiques de l'Algérie française continuent encore à le nier.
SOURCE : https://observalgerie.com/2022/09/12/societe/enrico-macias-venue-algerie/

"J'ai reçu trop de mauvais coups": Enrico Macias ne veut plus parler de ce qui fâche
Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, les blessures du chanteur restent à vif. Souvent agacé, le chanteur s'emporte contre Emmanuel Macron qui qualifie la colonisation de "crime contre l'humanité".

"Je ne sais pas ce qui va arriver. J’ai perdu mon procès, je suis ruiné. Mais j’essaye de ne pas trop y penser", confie le chanteur. Photo Dylan Meiffret
C’est un entretien crénelé de silences. Il faut deviner les soupirs de lassitude, l’agacement qui perce entre les réponses. "Je ne veux pas parler de politique", maugrée souvent l’interprète. "Seulement de mes chansons et de ma musique. J’ai reçu trop de mauvais coups."
Enrico Macias est à l’aise lorsqu’il évoque ses débuts au Théâtre de verdure de Nice, cette ville "si importante dans [sa] carrière" où il est "toujours heureux de revenir". Il sourit en revivant ses vacances en famille à Saint-Raphaël et Fréjus, où il ira égrener ses notes le 17 septembre (concert le 17 septembre à 20h30 au théâtre Le Forum de Fréjus.
Oui, mais… Enrico n’est pas n’importe quel artiste de variétés. Depuis soixante ans, il met des mots sur les maux d’un peuple déraciné. Son regard d’homme de paix, frappé au cœur, dit quelque chose de l’histoire tourmentée de notre pays. Jusque dans ses réticences à s’exprimer.
Il y a 60 ans, en interprétant "Adieu mon pays" à la télévision, vous êtes devenu l'un des porte-parole des pieds-noirs. Ce statut ne vous a jamais pesé ?
C’est un privilège, mais aussi une responsabilité énorme. Cela dit, je ne me considère pas comme un porte-parole. J’ai simplement raconté mon histoire…Vous pensez que la blessure de l'exil pourra se refermer un jour ?
Jamais. Pas tant que je porterai le deuil de mon beau-père Raymond [assassiné par le FLN en 1961 à Constantine, ndlr]. Il faudrait une réconciliation entre tous les enfants d’Algérie, harkis, pieds-noirs, berbères.L’assassinat de Cheikh Raymond a provoqué votre départ d'Algérie, onze mois avant la fin de la guerre. Comment avez-vous fait pour éviter la haine ?
Quand on subit des épreuves comme la violence ou la guerre, on n’a pas envie de reproduire la même chose. Je n’ai pas d’esprit de revanche. J’ai choisi d’être prévenant et gentil, parce que quand les gens sont gentils, on les agresse moins…Vous êtes toujours interdit de séjour en Algérie. Espérez-vous y retourner un jour ?
Je ne suis pas interdit de séjour. Plus exactement, il n’y a rien d’officiel. J’ai failli y aller à trois reprises. À chaque fois, les autorités – pas la population ! - ont fait en sorte que ce voyage ne se fasse pas. Alors maintenant, je suis prudent. À 83 ans, je me suis fait une raison. [Long silence] Cela n’empêche pas la souffrance.Vous avez déclaré que vous quitteriez la France si Marine Le Pen accédait au pouvoir. Or, de nombreux pieds-noirs votent à droite ou à l'extrême droite. Ils se trompent de colère ?
[Très agacé] Quand on m’a posé la question, on m’a piégé. Je voulais juste dire que j’étais contre les idées de cette dame. Je respecte le vote et l’opinion de chacun. Même au sein de ma propre famille…Quid de Éric Zemmour, qui affirme qu'on ne peut pas être un nazi lorsqu'on est juif ?
Je n’ai aucune envie de parler de Zemmour ! Aucune !En 2017, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de "crime contre l’humanité". Qu’en pensez-vous ?
[Glacé] Je ne suis pas d’accord. Un point, c’est tout. Si j’avais eu l’occasion de le rencontrer, je lui aurais dit en face.Que restera-t-il de la culture pied-noir dans dix ans ?
Des humoristes comme Robert Castel, la musique orientale qui est liée à l’identité pied-noir. Aucune ethnie ne sera éliminée de la société française.Vous n'avez été candidat qu'une seule fois à une élection : en mars 1992, aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la liste menée par Bernard Tapie. Cela vous a vacciné de la politique ?
Je l’ai fait pour Bernard Tapie que j’adorais. Je n’étais pas en position éligible ; c’était ma façon de combattre l’extrême droite. [Silence] J’ai toujours été un citoyen engagé, dès lors qu’on m’a donné les moyens de l’être.En 1997, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, vous a nommé ambassadeur itinérant pour la paix et la défense des enfants. Un mot sur le conflit en Ukraine ?
Allez demander à des spécialistes ! Moi, je suis pour la paix dans le monde entier.Depuis 2008, vous vous battez pour conserver votre villa de Saint-Tropez. Vous avez été condamné à rembourser 30 millions d'euros. Serez-vous contraint de quitter les lieux ?
Décidément, vous ne posez que des questions embarrassantes ! Je ne sais pas ce qui va arriver. J’ai perdu mon procès, je suis ruiné. Mais j’essaye de ne pas trop y penser.En avril, à l'Olympia, vous avez eu une extinction de voix. Pendant deux heures, le public a chanté à votre place. Sa fidélité vous surprend ?
Mieux que cela : elle me ravit. J’aurais dû partir et annuler. Mais je suis resté, spectateur de mon propre concert ! Je crois que je suis le seul chanteur au monde à avoir fait cela.En décembre, vous aurez 84 ans. Le mot "retraite" ne fait pas partie de votre vocabulaire ?
Comme Aznavour, je chanterai jusqu’à mon dernier souffle.C'était en 2019 au temps du Hirak en Algérie
Enrico Macias ne nous dit pas tout !!!
mais il espère que la jeunesse algérienne
qui n'a pas connu la guerre d'indépendance
sera plus tolérante pour lui ?

Cliquez sur ce lien pour d’abord l’écouter :
https://www.facebook.com/Algerie360/videos/792959824405239/
Invité de l'émission C à vous ce vendredi 22 mars, Enrico Macias s'est confié sur la crise actuelle en Algérie et son possible retour dans ce pays où il est interdit de territoire depuis 1961.
Il est et restera l'un des chanteurs les plus connus en France ! Aujourd'hui, alors qu'il vient de célébrer ses 80 printemps, Enrico Macias ne semble toujours pas prêt à prendre sa retraite. Une décision qui fait le plus grand bonheur de ses nombreux fans et qui semble même lui octroyer une seconde jeunesse. Invité de l'émission C à vous sur France 5 ce vendredi soir, le chanteur est venu pour parler de son dernier projet fou : un rôle dans une série Netflix.
Mais avant d'aborder la promotion de l'interprète du titre Les filles de mon pays, le journaliste Antoine Genton semblait bien décidé à connaître le ressenti de son célèbre invité sur la crise politique qui fait actuellement rage en Algérie et qui s'oppose au cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. En effet, si on ne le présente plus aujourd'hui, nombreux sont ceux qui oublient le fait qu'Enrico Macias est né et a grandi dans ce pays d'Afrique du Nord.
Il est interdit de territoire depuis 1961
« Ça me donne de l'espoir que tout va changer » affirme alors le chanteur face aux journalistes de l'émission. Et même s’il admet être très « frustré » de ne pas pouvoir se rendre en Algérie (il a été interdit de territoire en 1961 après avoir affiché son soutien à Israël), Enrico Macias se dit « prêt à prendre tous les risques » pour y retourner. Une preuve de son attachement à ce pays qu'il n'a jamais oublié et pour lequel il voue encore une admiration sans équivoque.
Persuadé de l'amour des Algériens à son égard, le chanteur aux dizaines de millions d'albums vendus ne paraît toutefois pas convaincu de son retour sur la terre de ses ancêtres. En effet, même si les manifestations actuelles semblent promettre un changement dans la politique actuelle et son possible retour, l'homme précise que son « cas personnel n'a rien à voir avec ce mouvement ». Des révélations émouvantes de la part de ce chanteur au grand cœur touché par de nombreux malheurs ces dernières années.
Mais Enrico Macias n'a jamais démenti cela :

Enrico Macias et la guerre d’Algérie :
Quand Gaston chassait du Fellaga...
Enrico Macias est un homme redoutable. Militant sioniste déclaré, il a toujours entretenu des rapports ambigus avec l’Algérie, dont il a largement contribué à imposer cette image de pays de la douceur de vivre et de la kémia, une image qui a nourri tant de nostalgie chez les pieds-noirs.
Ses tirades sur le pays du soleil et de la haine, de la joie de vivre et de la passion, ce pays perdu dont on ne se console jamais, ont arraché des larmes à de nombreuses générations de pieds-noirs. Mais Gaston Ghenaïssia – le vrai nom de Macias – n’a jamais abordé le volet le plus sombre de son histoire algérienne. Il n’a jamais dit comment il a lui-même contribué à mettre le feu à ce pays bien aimé.
Il a, en fait, réussi à maintenir un voile pudique sur son militantisme de cette époque, un militantisme qui l’a mis dans la même tranchée que Maurice Papon ! Enrico Macias évoque régulièrement sa volonté de revoir son «pays natal», et comment il en est empêché. Sa visite devait se faire en 2007, en compagnie de Nicolas Sarkozy. Auparavant, il avait affirmé que le président Abdelaziz Bouteflika lui-même l’avait invité, mais que des méchants, héritiers de la tendance obscurantiste du FLN, s’étaient opposés à son retour.
Qu’en est-il au juste ? A Alger, on affirme officiellement qu’Enrico Macias peut se rendre en Algérie quand il veut, mais qu’il est hors de question d’en faire un évènement politique. Certains fonctionnaires montrent un certain embarras devant le tapage médiatique provoqué par Enrico Macias lui-même. «Il n’a pas envie de revenir, il ne viendra pas, et il le sait parfaitement», a déclaré, sûr de lui, un ancien haut responsable.
«Et ce n’est pas seulement à cause de son soutien public à Israël», ajoute-t-il, estimant que le thème Algérie ne constitue pour Enrico qu’un «fond de commerce». Pour cet homme, qui avoue avoir apprécié la musique de Enrico dans sa jeunesse, Enrico Macias ne reviendra pas en Algérie parce qu’il y a commis des crimes pendant la guerre de libération.
Selon lui, Enrico faisait partie d’une milice locale, les «unités territoriales», composées de partisans de l’Algérie française, qui formaient des milices de supplétifs de l’armée coloniale. L’unité à laquelle appartenait Enrico Macias a commis de nombreuses exactions, et a participé à des ratonnades, affirme cet ancien haut fonctionnaire. A cette époque, Enrico Macias est un jeune artiste prometteur, qui joue dans la troupe du «Cheikh Raymond», le plus célèbre artiste juif de Constantine.
Raymond Leyris est alors au faîte de sa gloire : notable de la communauté juive, ami des «arabes» de la ville, il est riche et célèbre. Sa musique est si appréciée qu’une jeune recrue FLN, en pleine guerre d’Algérie, rejoint le maquis ALN en wilaya II avec des disques de «Cheikh Raymond », nous raconte un ancien moudjahid qui a passé toute la guerre dans le Nord Constantinois ! Raymond Leyris n’avait pas d’enfants.
Il en a adopté deux, dont Enrico Macias. Celui-ci est donc à la fois l’enfant adoptif, le disciple et l’héritier de Cheik Raymond. A-t-il été l’héritier en tout ? Seul Macias pourra le dire. En tous les cas, les réseaux FLN avaient alors une conviction. Pour eux, Raymond Leyris avait été contacté par les services spéciaux israéliens.
Il organisait des collectes, montait des réseaux, et travaillait en sous-main avec les services spéciaux israéliens, qui avaient alors un objectif : organiser le transfert massif des juifs des pays arabes vers Israël. En Algérie, leur première cible était Constantine, avec ses 25.000 à 30.000 juifs : il y avait presque autant de juifs à Constantine que dans les grandes villes israéliennes. En mai 2005, le journal israélien Maariv citait un ancien officier du Mossad chargé de piloter l’opération.
Cet officier affirme avoir recruté deux agents, Avraham Barzilaï et Shlomo Havilio, qui arrivent dans la région de Constantine début 1956, sous la couverture de modestes enseignants. Quatre mois plus tard, une grenade explose dans un café fréquenté par les Juifs de Constantine, rue de France. S’ensuit une opération de vendetta organisée par les cellules mises en place par le Mossad, selon l’officier en question. Les ratonnades font de nombreux morts.
L’historien Gilbert Meynier, qui l’évoque dans une de ses études, et parle de «pogrom», est contraint à une longue mise au point. (http:// etudescoloniales.canalblog.com/archives/ 2007/03/14/4319574.html). Quel est le rôle exact de Raymond Leyris ? Difficile à dire. Mais l’homme surfe déjà sur une vague de célébrité et de respectabilité. Artiste adulé, il a atteint une renommée qui va au-delà des communautés. Il est le notable juif par excellence.
Il garde le contact avec les arabes qui veulent préserver la communauté juive ; il reste l’interlocuteur des autorités coloniales au sein de la communauté juive ; il poursuit une activité clandestine avec le Mossad. Mais peu à peu, les réseaux FLN acquièrent la certitude que Cheikh Raymond n’est plus un artiste aussi innocent. Il est partie prenante dans l’action de réseaux que le FLN n’arrive pas encore à identifier. Des témoins avaient vu des armes transportées à partir de chez lui, en pleine nuit.
Au FLN, la prudence reste de mise. Des consignes strictes sont données pour tenter de conserver de bonnes relations avec la communauté juive. Des contacts réguliers sont établis. Début 1961, le FLN envoie de nouveau un émissaire auprès des notables de cette communauté. L’émissaire envoie un message à Raymond Leyris, et prend rendez-vous. L’organisation fonctionne alors selon un cloisonnement très strict. L’émissaire du FLN est tué alors qu’il gagnait le lieu du rendezvous.
Ce fait, troublant, intervient après d’autres évènements suspects. L’organisation du FLN en tire une conclusion : seul Raymond Leyris pouvait avoir organisé la fuite pour permettre aux autorités coloniales d’éliminer le responsable du FLN. Les anciens moudjahidine de la Wilaya II, qui étaient opérationnels à ce moment là, sont toutefois formels : aucune instance du FLN n’a prononcé un verdict clair contre Raymond Leyris.
Aucun responsable n’a, formellement, ordonné une exécution. Mais le doute planait, et dans le Constantine de l’époque, ce n’est qu’une question de temps. Le 22 juin 1961, neuf mois avant le cessez- le-feu, Raymond Leyris croise Amar Benachour, dit M’Djaker, membre d’une cellule locale de fidayine, qui l’abat en plein marché, devant des dizaines de témoins. La personnalité de Amar Benachour, l’homme qui a abattu Raymond Leyris, posera aussi problème.
Il s’agit en effet d’un personnage qui répond peu au profil traditionnel du moudjahid. Benachour est plutôt un marginal, plus branché sur le «milieu» que sur les réseaux nationalistes. Ce qui a d’ailleurs jeté une ombre sur l’affaire : Benachour a vécu jusqu’au début du nouveau siècle, mais l’opération qu’il a menée a toujours été entourée de suspicion, certains n’hésitant pas à parler de provocation ou de manipulation.
Plusieurs moudjahidine qui étaient dans la région au moment des faits continuent d’ailleurs à soutenir l’idée d’une manipulation. La mort de Raymond Leyris accélère le départ massif des juifs de Constantine, un exode largement engagé auparavant par les catégories les plus aisées. Mais la mort de Raymond Leyris sonne également le début d’une opération de vengeance meurtrière, à laquelle Enrico Macias participe, selon des moudjahidine de la Wilaya II.
Il est impossible d’établir exactement le bilan exact des expéditions punitives. En 1956, après l’attentat de la rue de Constantine, Gilbert Meynier n’écarte pas le chiffre de cent trente morts. En mai 1961, la même folie furieuse se déchaîne mais, curieusement, affirme un constantinois qui a vécu les évènements, les Juifs de Constantine étaient plus préoccupés par l’idée de départ que par la vengeance.
A l’exception d’Enrico, qui garde un silence pudique sur cet période, se contenant d’évoquer la mémoire de Raymond Leyris, un homme innocent doublé d’un artiste qui aimait la vie, mais qui a été assassiné par le FLN, selon lui. Selon cette image, très médiatique, Enrico lui-même n’était qu’un jeune homme amoureux de la vie et des filles, un modeste instituteur de campagne, devenu un immense artiste grâce à son talent.
A Chelghoum Laïd, où il a enseigné, son nom est connu mais il est presque impossible de trouver des gens qui l’ont côtoyé. A Constantine, par contre, un spécialiste de la musique affirme que de nombreux «ouled el bled» lui rendent visite régulièrement en France. Par ailleurs, le discours de Enrico Macias a longtemps bénéficié d’une cacophonie chez les responsables algériens, qui n’ont jamais adopté une position claire sur le personnage.
En fait, côté algérien, plusieurs points de vue se côtoyaient : ceux qui faisaient l’éloge de l’artiste, ceux qui prônaient la réconciliation, ceux qui dénonçaient son soutien à Israël, et ceux qui étaient d’abord soucieux d’établir les faits historiques. Un ancien haut fonctionnaire affirme toutefois que Enrico n’avait aucune chance de revenir en Algérie. Les anciens pieds- noirs étaient classés en plusieurs catégories, explique ce fonctionnaire.
Enrico Macias fait partie d’une sorte de liste rouge officieuse, qui comporte les noms de militaires, colons et ultras ayant commis des exactions. Ceux-là ne peuvent pas entrer en Algérie, dit-il. Autre détail troublant dans l’histoire d’Enrico : quand il sévissait au sein des «unités territoriales», il collaborait avec un personnage célèbre, Maurice Papon ! Celui-ci a en effet exercé comme préfet à Constantine, où il a contribué à organiser de redoutables escadrons de la mort.
Milices, unités paramilitaires, escadrons de la mort, tout ce monde collaborait joyeusement quand il s’agissait de réprimer. Des témoins sont encore vivants. Autre curiosité dans l’histoire de Enrico Macias en Algérie : les Ghenaïssia, sa famille, sont des Algériens pure souche, installés en Algérie depuis plusieurs siècles, affirme un historien. Ils se sont francisés à la faveur du décret Crémieux, qui offrait la citoyenneté française aux Juifs d’Algérie, en 1871.
A partir de là, les Juifs se sont rapprochés de l’administration coloniale, accédant à l’école et à la citoyenneté. Mais une frange des Ghenaïssia a gardé son ancienne filiation, prenant le chemin inverse de celui de Enrico Macias. Ainsi, Pierre Ghenaïssia, né à Cherchell, a rejoint les maquis du FLN en mai 1956 dans la région du Dhahra, entre Ténès et Cherchell. Il est mort au maquis un an plus tard dans la région de Chréa, près de Blida, comme combattant de l’ALN. A l’indépendance de l’Algérie, une rue de Ténès, sur la côte ouest, a été baptisée à son nom. Quelques années plus tard, elle a été rebaptisée rue de Palestine!
SOURCE : Enrico Macias et la guerre d'Algérie: Quand Gaston chassait du fellaga... (lequotidien-oran.com)Abed Charef
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 2 Mars 2022 à 11:12
Guerre d’Algérie. Pieds-noirs, harkis :
la valise ou le cercueil (?)

Pieds-noirs, harkis, environ un million de rapatriés d’Algérie ont rejoint la Métropole après 1962. Comme ici ces personnes montant à bord du Ville d’Oran, le 25 mai 1962. | AFP
Début 1962, personne ne pense que l’indépendance de l’Algérie puisse signifier l’exode quasi total et définitif d’une communauté d’un million de personnes, souvent enracinée dans le pays depuis plusieurs générations.
Le slogan nationaliste algérien « la valise ou le cercueil » semble dater de l’immédiat après la Seconde Guerre mondiale. Il figure, fin 1946, tel un faire-part entouré d’un liséré noir sur la couverture d’un ouvrage du journaliste Paul Reboux s’interrogeant sur la pérennité de la présence française en Afrique du Nord.
À l’époque, la communauté française d’Algérie considère cette éventualité comme inimaginable. Elle n’envisage pas de renoncer à une terre où, depuis plusieurs générations, se sont développés une culture et des modes de vie constitués d’apports essentiellement méditerranéens, Espagnols, Italiens, Maltais, Mahonnais ayant façonné une langue, une cuisine, des pratiques religieuses et des us et coutumes dont personne n’imagine la disparition. Pas plus que ne veulent envisager leur départ, les descendants de Français de Métropole installés en Algérie après avoir fui la misère des villes ou de certaines zones rurales, essentiellement au sud de la Loire ou en Alsace-Lorraine. Dans ce dernier cas, au contraire de ce que l’on croit parfois, plus souvent avant 1870 que pour échapper à la domination allemande après la défaite.
La communauté juive, forte de 120 000 personnes aux origines souvent bien antérieures à la colonisation, mais devenue française par le décret Crémieux de 1870, partage une longue histoire, même si parfois conflictuelle, avec la majorité musulmane du pays. À ce titre, l’idée d’un exil lui est également étrangère.
450 000 départs en mai et juin 1962
Après 1954, au fil des ans, le « maintien de l’ordre » devenant guerre, l’insécurité augmentant, l’éventualité d’un État bientôt indépendant se précisant, l’inconcevable devient réalité. Ceux que l’on commence à nommer « pieds-noirs » quittent progressivement l’Algérie. Ainsi, à Constantine, le 22 juin 1961, l’assassinat par le FLN de Cheikh Raymond, figure légendaire de la musique andalouse et symbole de la population juive de la ville, déclenche le départ massif de cette dernière, forte de 30 000 personnes.

Une femme et ses enfants désireux de gagner la Métropole viennent de débarquer du « Ville d’Oran » à Marseille le 26 mai 1962. | AFP
Après la signature des accords d’Évian, le flux vers la Métropole devient panique de survie avec un pic de 450 000 départs en mai et juin. À Oran, les massacres d’Européens en juillet 1962 et les exactions commises un peu partout dans le pays par des éléments incontrôlés suscitent un exil définitif ou, au moins, la volonté de s’éloigner d’une terre que certains envisagent de retrouver à l’automne, avec l’espoir d’une situation stabilisée.

Plaque commémorative du rapatriement des Français d’Algérie, à Port-Vendres | DR
À l’automne 1962, en comptant ceux qui sont restés et ceux qui reviennent, demeurent encore en Algérie plus de 200 000 Européens. Un nombre qui ne cesse de diminuer avec les mesures d’expropriation et de nationalisation décidées par le président Ben Bella. Ce dernier n’a jamais souhaité voir se maintenir en Algérie une communauté ne correspondant nullement à sa conception « arabo-musulmane » de la nation algérienne.
La tragédie des harkis
Les supplétifs musulmans de l’armée française, encore en service ou l’ayant été cherchent également les chemins de l’exil, sachant leur vie en danger et ce, malgré les accords d’Évian précisant l’exclusion de « toute mesure de représailles ».
La tragédie de ces harkis est aussi liée au refus du gouvernement français de les accueillir massivement avec leurs familles sur le sol métropolitain. Quelque 60 000 d’entre eux parviennent cependant à gagner la France où ils sont parqués dans des camps ou des implantations plus ou moins insalubres. Ceux qui sont restés, et avec des nuances selon les régions, sont au mieux emprisonnés et parfois jugés, au pire, mis à mort de manière atroce. Le bilan de ces victimes n’a jamais pu être établi mais ne saurait être inférieur à un chiffre de 20 000 victimes.
« LA VALISE OU LE CERCUEIL »
PAR TRAMOR QUEMENEUR dans mensuel 903

Quel autre choix se profile pour les pieds-noirs à l'heure de l'indépendance algérienne ? Sinon le « retour » dans un pays qu'ils connaissent peu.
Contrairement à une idée reçue, le slogan « La valise ou le cercueil » n'apparaît pas à la fin de la guerre d'Algérie, avec l'Organisation armée secrète (OAS). Il commence à se diffuser juste après la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, à Sétif, la répression d'une manifestation nationaliste algérienne fait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de morts. Pour les Algériens, qui venaient de participer aux combats de la Libération, la rupture est définitive : l'indépendance se conquerra par les armes. Déjà, en 1946, dans un tract nationaliste distribué à Constantine, il est question de « la valise ou [du] cercueil » pour les Européens. L'historienne Annie Rey-Goldzeiguer signale que le slogan s'étale sur les murs, de Biskra à Djidjelli. Et l'écrivain Paul Reboux titre son livre Notre (?) Afrique du Nord. Maroc. Algérie. Tunisie. La valise... ou le cercueil ! (Chabassol, 1946).
Le spectre de cette alternative morbide réapparaît au début de la guerre d'Algérie, particulièrement après l'offensive du Constantinois, le 20 août 1955, au cours de laquelle le FLN s'en prend à la population civile, faisant 123 morts, dont 71 Européens. Les jours suivants, la répression est une nouvelle fois terrible : au moins 7 500 Algériens sont tués. Un fossé sanglant sépare de plus en plus les communautés, a fortiori avec les attentats aveugles des partisans de l'«Algérie française » puis du FLN à Alger à partir d'août 1956. Dès lors, il n'existe plus qu'une alternative : l'indépendance ou l'«Algérie française». Or, pour beaucoup, l'indépendance symbolise la valise, voire le cercueil. Ce sera donc l'« Algérie française » à tout prix. Les autres sont considérés comme des traîtres.
Au moment du 13 mai 1958, avec le retour du général de Gaulle, les lignes bougent. Les « fraternisations », largement organisées par le 5e Bureau de l'armée (l'action psychologique), laissent penser à un nouvel avenir commun. Les gens y croient. Mais il faudrait que les comportements changent résolument. Un an plus tard, de Gaulle déclare d'ailleurs à Pierre Laffont, député d'Oran et directeur de L'Écho d'Oran : « L'Algérie de papa est morte, et si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. » Ces termes ne peuvent évidemment manquer de renvoyer à ce terrible cercueil... Or, la naissance de l'Algérie nouvelle n'est pas celle que les ultras de l'« Algérie française » veulent. De nombreux Européens d'Algérie, que l'on appelle de plus en plus les « pieds-noirs », s'en remettent à eux, persuadés qu'ils vont protéger leurs intérêts. Dans les grandes villes, le calme règne à nouveau (après les attentats de 1956-1957), mais, dans les plus petites et les campagnes, c'est l'insécurité, voire la terreur qui préside : attentats et assassinats d'un côté, exécutions et ratonnades de l'autre. Certains commencent à déménager dans les cités d'envergure. Les plus prévoyants (et souvent les plus riches) envoient leurs enfants suivre leurs études en métropole, ou même leur famille s'y installer.
La peur gagne les Français d'Algérie
Le climat politique devient de plus en plus délétère : les violences entre Algériens et Français se doublent d'affrontements franco-français, en particulier lors de la « semaine des barricades » en janvier 1960 : les manifestants pro-« Algérie française » tirent sur les forces de l'ordre. On relève 20 morts et environ 150 blessés. La population européenne d'Algérie se sent de plus en plus au pied du mur. C'est alors que l'OAS fait son apparition à Alger, pendant le « putsch des généraux » en avril 1961. En son sein, des activistes de l'« Algérie française », mais aussi des militaires en rupture de ban, rompus aux techniques de propagande. Les slogans portent : «OAS veille », « OAS voit tout, entend tout »... et le fameux « La valise ou le cercueil »... Il faudrait soit soutenir l'OAS, soit partir ou mourir. Fatale alternative. L'organisation multiplie les actions de masse lui assurant un soutien populaire : manifestations sonores à grand renfort de casseroles ou de klaxons, pendant lesquelles les pieds-noirs scandent trois coups brefs et deux longs pour « Al/gé/rie fran/çaise ». Mais elle mène aussi des actions ciblées, tuant des Français libéraux, favorables aux négociations ou à l'indépendance de l'Algérie, des membres des forces de l'ordre françaises et de nombreux Algériens.
Lors d'un voyage du général de Gaulle en Algérie en décembre 1960, des pieds-noirs sortent dans les rues, décidés à se faire entendre. Mais, n'attendant aucune directive du FLN, la population algérienne descend aussi dans les rues. La peur gagne les pieds-noirs. Les départs commencent à s'accroître. Les plus politisés mais aussi les plus démunis s'accrochent à l'OAS. Sa violence se déchaîne à mesure que le cessez-le-feu se rapproche, mais elle perd progressivement ses soutiens. Après la déclaration du cessez-le-feu le 19 mars 1962, l'OAS considère d'ailleurs l'armée française comme une armée d'occupation. Le 23, elle investit le quartier pied-noir de Bab el-Oued et tue six appelés du contingent français. Trois jours plus tard, elle organise une manifestation pour désenclaver le quartier. De nombreux pieds-noirs y participent. Rue d'Isly, des coups de feu d'origine inconnue claquent, les militaires français répliquent, les manifestants sont fauchés. On relève 54 morts et 140 blessés. Les pieds-noirs plongent dans le désespoir. Si l'OAS leur interdit de partir afin de poursuivre la lutte pour l'«Algérie française », ces derniers ne sont pas prêts à mourir.
Certains décident de rester...
À Alger et dans les grandes villes, l'atmosphère est apocalyptique. L'OAS assassine au hasard, fomente des attentats à la bombe. Côté algérien, des civils et des militaires sont enlevés, disparaissent. On ne les reverra plus. En hâte, de nombreux pieds-noirs préparent leurs valises. Ils laissent derrière eux biens, souvenirs, ancêtres dans les cimetières. Ils attendent des jours pour trouver un bateau pour Marseille, Toulon, Port-Vendres ou Sète, ou, pour les plus riches, embarquer dans le premier avion pour Marseille, Paris ou Toulouse. Tant mieux si l'on y connaît quelqu'un, tant pis pour les autres. 120 000 pieds-noirs partent en mai 1962, 355 000 en juin : un tiers de tous les pieds-noirs en un seul mois. Sur la Méditerranée ou au-dessus, c'est la noria des navires et des avions.
Le 5 juillet, à Oran, alors que l'indépendance est fêtée par les Algériens, des tirs d'origine indéterminée conduisent à un déluge de feu puis à une traque des pieds-noirs. Une centaine d'entre eux sont tués, tandis que les derniers clandestins de l'OAS partent sur des chalutiers vers l'Espagne franquiste. Malgré le danger, certains restent pour régler leurs affaires ou sont déterminés à ne pas quitter leur maison. Ils sont encore 200 000 en septembre 1962 et 150 000 au milieu de l'année suivante. Leur nombre, cependant, continue ensuite à décroître. Au drame du départ ont succédé les tourments de l'installation en France : rejet des métropolitains confinant au racisme et à la xénophobie, difficultés pour trouver un logement, un travail. Les plus âgés ne se remettront jamais véritablement de cet exil, tandis que les plus jeunes se lanceront à la conquête de la métropole.

On ne peut refaire l´Histoire, «La valise ou le cercueil» appartient à Salan, Ortiz, Lagaillarde et consorts. Personne ne pourra rien y changer. Cette Française restée en Algérie le prouve
Par micheldandelot1 le 28 Février 2018Nous l’apprenons aujourd’hui Cécile Serra est décédée le vendredi 18 mars 2016, elle aurait eu 98 ans en juin de la même année… Elle était la preuve vivante qu’il était possible de vivre (même très âgée en ce qui la concerne) dans l’Algérie indépendante.
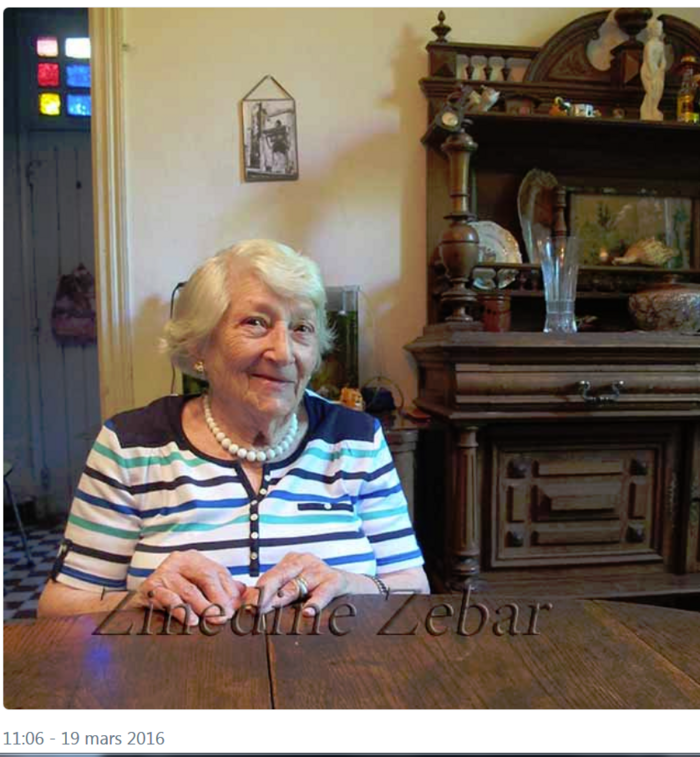
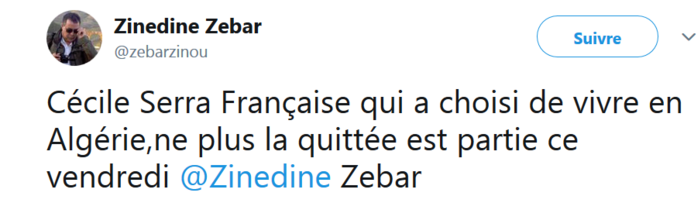
Emouvant témoignage
de la doyenne des Français en Algérie
(98 ans)

Cécile Serra : «Je suis espagnole d'origine, française de nationalité et algérienne de cœur.»
Cécile Serra, la doyenne des Français d’Algérie qui avait décidé de rester vivre dans notre pays au lendemain de l’Indépendance, alors que beaucoup d’Européens avaient choisi de partir, a expliqué, dans un entretien paru dans la Lettre d’information de l’ambassade de France à Alger, Binatna, les raisons qui l’ont amené à ne pas se séparer de la terre qui l’a vu naître.
Du haut de ses 98 ans, Mme Serra, comme aiment à l’appeler ses voisins avec affection, ne garde que de bons souvenirs de son vécu sur les hauteurs d’Alger, à Bir Mourad Raïs précisément, où elle est née en 1919, mais aussi à Alger où elle vit aujourd’hui.
Et lorsqu’on lui demande pourquoi avoir choisi de rester en Algérie à l’Indépendance et si elle avait eu peur à l’époque pour sa vie, sa réponse est sans détour : «Pourquoi serais-je partie ? J'avais toujours vécu ici. Et puis, je n'ai jamais eu peur. Peut-être parce que je n'ai jamais été confrontée à quoi que ce soit qui aurait pu me faire peur.
J'aime ce pays. Il y a tout ici : la mer, la montagne… Vous savez, je suis espagnole d'origine, française de nationalité et algérienne de cœur», tranche-t-elle. Et sa relation avec son voisinage qui sait évidemment ses origines européennes ? «C’est simple : je ne peux aller nulle part sans que l'on m'interpelle : comment tu vas, Mme Serra ? Les gens viennent me rendre visite, m'apportent à manger... C'est trop ! Mon congélateur déborde ! Et c'est sans parler de tous ceux qui m'écrivent !», tient-elle à témoigner à propos de cette relation si particulière, si intense, si chaleureuse qu’elle entretient avec tous ceux qui la connaissent. «Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter tout cela mais, en tout cas, je suis une vieille dame gâtée», finit-elle par avouer comme pour marquer d’une pierre blanche les rapports profondément humains qui la lient à ses voisins algériens.
Quels souvenirs garde-t-elle de son enfance qui coïncidait avec les années 20 du siècle dernier ?
Là, nostalgique, la dame remonte le temps et égrène les images, les unes plus belles que les autres, qui ont coloré ses tendres années. «Birmandreïs (ancienne appellation de Bir Mourad Raïs, ndlr), à l'époque, c'était la campagne. Les champs s'étendaient à perte de vue. Il n'y avait pas de route. A la place, c'était des rangées et des rangées de figuiers de barbarie», raconte-t-elle, avant de poursuivre : «Et puis, nous sommes venus à Alger et mon père a fait construire la villa que j'habite encore aujourd'hui. Le dimanche, il nous emmenait à la mer dans sa carriole. Nous y passions la journée, à nous baigner et à pêcher. On ne s'ennuyait jamais ! "
Amine Sadek

Le départ des pieds-noirs
et l’Histoire
Les conditions du départ massif et précipité des pieds-noirs en 1962. Et comme les réactions à un écrit de presse sont ce qu´est le filet pour la pêche, il y a eu aussi celles des falsificateurs qui veulent «triturer» l´Histoire pour accuser les Algériens d´avoir chassé les Français d´Algérie.
Certains vont même jusqu´à attribuer le slogan lancé à l´époque par l´OAS «la valise ou le cercueil», au FLN.
Mme Cécile Serra est une preuve vivante que les Algériens n´ont jamais chassé personne et que ceux, parmi les Français qui ont choisi de rester en Algérie en 1962 n´ont pas eu pour seul choix le «cercueil». Des mois marqués par «la politique de la terre brûlée» menée par l´OAS (Organisation armée secrète des ultras d´Algérie).
C´est cette même OAS qui détenait les moyens de communication (journaux, radios et télévision) pour lancer ses mots d´ordre et slogans comme le fameux «la valise ou le cercueil». D´ailleurs, le dernier attentat de cette organisation criminelle, à la veille de l´Indépendance, fut l´incendie de la bibliothèque de l´université (faculté centrale d´Alger). L´ALN n´a quitté les maquis pour rentrer en ville qu´après l´Indépendance.
Quant au FLN, il était décimé à Alger depuis l´assassinat de Ben M´hidi en 1957. Ce n´est pas la zone autonome que voulait ressusciter à Alger après le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, le commandant Azzedine, ni la faible autorité du «Rocher noir» des accords d´Evian, ni les barbouzes envoyés par De Gaulle qui pouvaient changer le cours de l´histoire.L´objectif de l´OAS, en poussant les pieds-noirs à quitter l´Algérie, était clair. Il s´agissait, ni plus ni moins, que de tenter de paralyser le pays.
Tous les postes de commande étaient, en effet, entre les mains de cadres et personnels de maîtrise uniquement pieds-noirs.
La colonisation avait laissé derrière elle 99% d´Algériens analphabètes. C´est ce que le Parlement français appelle «l´oeuvre civilisatrice» dans sa loi du 23 février 2005. Il faut admettre que dans de telles conditions, les Algériens ont relevé un défi historique en réussissant à prendre les commandes au pied levé et remettre en marche le pays.
Cela dit et aussi vrai qu´on ne peut refaire l´Histoire, «la valise ou le cercueil» appartient à Salan, Ortiz, Lagaillarde et consorts. Personne ne pourra rien y changer.

« Je suis née en Algérie, je mourrai
en Algérie »
Cécile Serra, doyenne des Françaises à Alger, évoque sa jeunesse dans le pays qui va célébrer le 55e anniversaire de son indépendance.
« Eh! oh! Dites donc, le photographe. Attention, hein, ne me prenez pas de trop près. Sinon on va s'apercevoir que j'ai quelques rides. » A 98 ans, Cécile Serra ne manque pas d'humour. « Je suis coquette, je l'ai toujours été », corrige-t-elle, en souriant, un joli collier de perles autour du cou.
A Alger, tout le monde connaît cette vieille dame pimpante, installée depuis près d'un siècle dans un des quartiers chics de la ville. Ses voisins algériens sont aux petits soins pour elle. Ils se relaient devant la grille en fer de sa maison pour savoir si tout va bien, si elle ne manque de rien. « J'aime bien discuter avec tout le monde. Les jeunes en particulier. Je leur dis : Vous avez voulu l'indépendance. Pas de problème, c'est normal. Mais alors pourquoi cherchez-vous tous à partir? Restez. C'est un paradis ici, il y a mille choses à faire. »
La doyenne de la communauté française, elle, n'a jamais voulu quitter le pays. Ni après l'indépendance en 1962 (dont on célébrera le 55e anniversaire). Ni pendant la décennie noire (1991-2002), la guerre civile entre le pouvoir et les groupes islamistes qui a fait près de 200 000 morts. Ici, c'est chez elle.
« Je suis rentrée en France, une fois en 1964, pour rendre visite à ma famille. Avec mon mari Valère, décédé en 1986, nous sommes allés à Avignon, Toulon, Monaco. Mais nous avions des plaques d'immatriculation algériennes. Nous nous sommes fait arrêter sans arrêt, les gens nous regardaient avec un drôle d'air. Nous ne nous sentions pas les bienvenus… Après avoir traversé l'Espagne, on a décidé de rentrer le plus vite possible. Je pleurais de joie en ouvrant la porte de ma maison. Je suis née en Algérie, je mourrai en Algérie. »

Dans son jardin verdoyant, la vieille Simca Aronde des années 1950, qui appartenait à son époux, est recouverte de mousse. La télé fonctionne toute la journée, quand l'antenne ne déraille pas. Près du poulailler en bois, quelques canards déplumés grattent la terre durcie par le soleil. Le potager est envahi par les herbes folles.
Cécile Serra était couturière.Elle a commencé à travailler en 1934 et s'est arrêtée il y a quatre ans seulement, les doigts usés par le temps. Aujourd'hui, il lui reste des photos jaunies sur son buffet Henri II, et des souvenirs en pagaille. « Si vous saviez, si vous saviez », raconte-t-elle inlassablement.
Son Algérie, c'étaient des sorties en bateau entre copains pour pêcher la crevette. Des promenades dans la montagne à la recherche de champignons savoureux. Le désert, les méchouis, le thé à la menthe et les repas que l'on préparait pendant « au moins » trois jours.
En 2003, elle fait la bise à Jacques Chirac, en visite à Alger. Elle aurait aussi aimé croiser Sarkozy, en 2007, mais cela « n'a pas pu se faire ». La politique algérienne, la maladie de Bouteflika, ça, elle s'en fiche un peu.
Malgré les guerres, malgré les morts, elle assure n'avoir « jamais été menacée, jamais inquiétée ». Au crépuscule de sa vie, elle ne garde en mémoire que les instants précieux. « Je dis à mes amis : Surtout, quand je partirai, ne pleurez pas. Car j'ai vécu heureuse dans un pays merveilleux. »
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 1 Mars 2022 à 08:00
Une préfiguration de la violence raciste
de l’OAS de 1961-1962
Les ratonnades d’Alger en 1956
par Sylvie ThénaultSylvie Thénault est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la colonisation française en Algérie et de la Guerre d’indépendance algérienne.
« Merci à Sylvie Thénaut pour cette vidéo qui démontre une fois de plus l'œuvre civilisatrice ??? de la France coloniale.
Il est opportun à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie que la colonisation soit reconnue comme crime D'ÉTAT contre l'humanité.
Important de transmettre ce passé colonial aux générations d'aujourd'hui.
Michel Dandelot »
Le 29 décembre 1956, les obsèques du notable Amédée Froger, assassiné la veille à Alger, rassemblent des milliers d’« Européens ». En exploitant de nombreuses archives, Sylvie Thénault reconstitue l’assassinat, les obsèques et les violences racistes exercées par des participants à l’encontre des « musulmans », ainsi que les suites judiciaires. Elle montre que les violences qualifiées de « ratonnades », « non pas celles des autorités et de leurs représentants mais bien celles de Français, nés là-bas, se nourrissent d’un rapport de domination, empruntant à toutes les formes d’oppressions possibles (économiques, sociales, politiques, juridiques, culturelles) et s’ancrent dans un espace urbain ségrégué ». Ci-dessous un entretien donné par l’autrice au quotidien algérien L’Expression, ainsi qu’une vidéo de l’émission avec Sylvie Thénault et Annette Wievorka diffusée par la radio RCJ.
Les ratonnades d’Alger, 1956.
Une histoire de racisme colonialAlger, samedi 29 décembre 1956. L’Algérie française porte en terre l’un de ses meneurs, Amédée Froger, tué la veille en sortant son domicile. La nouvelle de l’assassinat fait grand bruit, en Algérie, mais aussi à Paris, en raison de la personnalité de la victime, haute figure locale de la défense de la cause française. Ses obsèques à Alger rassemblent des milliers de personnes. Surtout, elles sont l’occasion de violences racistes, que les contemporains nomment « ratonnades ». Elles visent les « musulmans », comme les Algériens sont appelés dans cette société-là.
S’appuyant sur des sources variées, dont des archives policières et judiciaires inédites, Sylvie Thénault enquête sur ces événements pour les inscrire dans la longue durée coloniale. Trop souvent résumés à des actions ponctuelles et paroxystiques, ou associées aux attentats de l’OAS à la toute fin de la guerre, ces violences – non pas celles des autorités et de leurs représentants mais bien celles de Français, nés là-bas – se nourrissent d’un rapport de domination, empruntant à toutes les formes d’oppressions possibles (économiques, sociales, politiques, juridiques, culturelles) et s’ancrent dans un espace urbain ségrégué.
Sylvie Thénault plonge le lecteur au cœur de la société coloniale algérienne, traversée de brutalités et de peurs, au plus près de cette foule d’anonymes, qui ont été partie prenante de la Guerre d’indépendance algérienne. C’est ainsi un autre récit de ce conflit qu’offre ce livre.
« La société coloniale est fondée sur l’injustice »Entretion avec Kamel Lakhdar-Chaouche, publié par L’Expression le 26 février 2022.
Source
L’assassinat de Amédée Froger, le 28 décembre 1956 à Alger, n’était pas un attentat contre un civil européen. Par la notoriété de la victime, l’acte visait un symbole du colonialisme. Qu’en pensez-vous?Les deux ne sont pas contradictoires. Froger est à la fois un civil au sens où il n’appartient pas aux forces de l’ordre (ni armée ni police) mais oui bien sûr, cet homme est aussi un symbole - et d’ailleurs, je l’utilise ainsi dans l’écriture, pour présenter, dans la première partie, la société coloniale et ses injustices dans tous les domaines : la dépossession foncière, la représentation politique avec deux collèges d’électeurs mais aussi, plus largement, la domination économique et sociale. Plus encore, il était le symbole du refus de toute évolution dans l’Algérie coloniale. Il est en effet représentatif de ces élus locaux qui se dressaient contre toute mesure entamant leur suprématie.
Le nom de Froger est lié à l’histoire de la dépossession des terres opérée à Boufarik où il était, des années durant, maire et cumulait plusieurs fonctions. Faites-vous, à travers l’histoire de Froger, le procès du système colonial français en Algérie ?
Comme historienne, je n’instruis pas de procès. Ce n’est pas mon rôle. Votre question est cependant pour moi révélatrice - et très importante ! En effet, je crois qu’il y a une façon erronée de concevoir l’objectivité en histoire, sur les questions de colonisation. L’idée est répandue qu’être objectif, c’est équilibrer les points de vue en contrebalançant tout élément négatif par un élément positif - ainsi, par exemple, le développement économique et l’installation d’infrastructures (pourtant tous deux très limités !) sont opposés aux violences. C’est évidemment absurde et indécent au regard de ce que valent les vies humaines. Comment mettre les deux en balance ? Je ne vois pas pourquoi, comme historienne, je devrai corriger systématiquement les inégalités que je constate ! Pour être claire, j’analyse la société coloniale et je dis ce qu’elle était : une société fondée sur l’injustice en tous domaines. Et cela avec une explication fondamentale qui, je pense, structure l’ensemble de mon livre : il s’agit d’une colonie de peuplement dans laquelle la majorité algérienne devait être maintenue dans l’infériorité, en permanence et dans tous les domaines - c’était la condition sine qua non du maintien de la colonisation. Il y a obligatoirement ségrégation dans une société comme celle-là. À mon sens, il y a de quoi justifier une condamnation morale de la colonisation mais je ne cherche pas à faire clivage, ni à culpabiliser les uns et victimiser les autres. Je pense que je fais plutôt un travail d’analyse au service d’une pédagogie : je démontre la logique de ségrégation de cette société, pour bien faire prendre conscience de ce qu’était la colonisation, avec la conviction que cette logique ne peut être que réprouvée.
Vous avez souligné dans les premières parties de votre livre la création de milices et de groupes d’auto-défense armés qui dépendaient directement des colons. Ces derniers avaient déjà créé depuis 1906 les dispositifs restreints de sécurité (DRS). Pourriez-vous nous en dire plus sur leurs influences, leur introduction dans les milieux d’affaires, administratif, politique et médiatique ?
Je propose une vision différente de la société coloniale. Je ne pense pas les colons armés et investis dans le maintien de l’ordre comme des éléments s’infiltrant dans les milieux dont vous parlez. Je parle plutôt, dans mon livre, d’une minorité coloniale en lutte pour sa suprématie. En ce sens, il n’y a pas infiltration des colons dans les milieux évoqués mais bien plus, ceux que vous appelez les « colons » sont les membres d’une société algéroise dominante dans toutes ses composantes, avec des élites exerçant des fonctions diverses : économiques, politiques, administratives, médiatiques, comme vous dites. Et tous ces milieux sont de fait liés. Il ne s’agit pas de penser les colons comme séparés des autres et cherchant à jouer un rôle de lobby en s’infiltrant dans tous les secteurs. Je pense qu’il s’agit d’une société où les élites sont de fait en relation, en connivence... ou en conflit. Ainsi, Froger et les maires qu’il représente ont des relations avec des journalistes, des responsables administratifs et politiques et parfois, tous œuvrent dans le même sens mais parfois aussi ils s’opposent les uns et les autres. La Fédération des maires du département d’Alger que Froger dirigeait était elle-même traversée par des tensions internes. Froger incarne une ligne dure, refusant toute réforme. Je pense plutôt explorer un milieu social dans toutes ses composantes et avec son fonctionnement.
Peut-on dire que ces colons constituaient un groupe social détaché à la fois des communautés françaises mais aussi musulmanes ?
Non, je ne dirais pas cela. Je vois la société coloniale plutôt comme une société clivée, d’abord, sur un critère que l’on peut appeler « racial » : cette société, d’abord, fondamentalement, sépare ceux qu’on appelait les « Européens » et les « musulmans ». J’utilise le qualificatif « racial » au sens que les spécialistes de la colonisation lui donnent : non pas un terme renvoyant à une définition biologique mais un terme cumulant des critères physiques (bien sûr, l’apparence physique joue !), des critères culturels et des critères sociaux : comment s’habille-t-on ? quelle langue parle-t-on ? Quelle religion pratique-t-on ? Dans quel quartier ou immeuble vit-on ? quels lieux de sociabilité fréquente-t-on ? etc. Puis ensuite, chaque groupe a sa propre stratification sociale avec ses propres élites mais les hiérarchies n’en sont pas du tout les mêmes. Chez ceux qui étaient appelés les « musulmans », les élites sont extrêmement réduites en nombre et leurs pouvoirs sont bien moindres que ceux des élites françaises. Je cite dans mon livre des statistiques de l’époque très révélatrices sur les échelles de revenus et les catégories socioprofessionnelles par exemple.
On comprend dans votre livre que les fervents défenseurs de l’Algérie française avaient plusieurs fois organisé des opérations de provocations visant les milieux des Français musulmans. Vous-même avez écrit que la police se contentait de rapporter dans ses procès-verbaux que des incidents ou des assassinats d’Européens étaient d’origine criminelle, désignant les musulmans comme étant responsables. Doit-on s’interroger sur la crédibilité des archives judiciaires et policières, ouvertes aujourd’hui ?
Il faut toujours s’interroger sur les archives ! C’est la règle d’or du métier d’historien. Jamais les archives ne parlent d’elles-mêmes, elles ne livrent pas la vérité clés en main, pas plus qu’elles ne sont systématiquement mensongères. Mais considérées toutes ensemble, croisées avec d’autres sources (j’utilise beaucoup la presse dans mon livre), elles nous permettent d’approcher au mieux le passé, ses événements, les sociétés aujourd’hui disparues. J’espère l’avoir démontré dans mon livre : l’écriture de l’histoire est un exercice d’équilibriste, nécessitant de multiplier et croiser les sources avant d’en analyser le contenu sans céder à la facilité. Il reste toujours des pans du passé qui échappent à notre connaissance, tout simplement parce qu’ils n’ont pas laissé de traces : pas de traces écrites à l’époque ou des traces écrites douteuses, pas de témoignage enregistré à l’époque non plus alors qu’aujourd’hui les témoins disparaissent ou leurs mémoires deviennent défaillantes. J’ai essayé de restituer cela au mieux : les faits étayés et les doutes restants, sans que cela interdise totalement d’écrire l’histoire et de dire les faits. Je voulais en particulier dire ce qu’était le racisme colonial, non pas en termes de représentation mais le racisme en actes. Le racisme meurtrier.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 28 Février 2022 à 09:42
J’ai donc vu les 6 épisodes
d’ « En guerre pour l’Algérie »


Car ils sont sur mon blog depuis le 23 février dernier. Je regrette toutefois que la parole n’a pas été donnée à une victime de l’OAS. Pourquoi Raphaëlle Branche ? Je sais que Jean-François Gavoury ou Jean-Philippe Ould Aoudia auraient aimé témoigner aussi. L’un comme l’autre ont eu leur père assassiné par cette organisation terroriste et criminelle, responsable de 2700 victimes en Algérie et en France, avant et après le 19 mars 1962. Je constate une fois de plus qu'il est plus facile de donner la parole au bourreau plutôt qu'au descendant de sa victime.
Michel Dandelot
Donc ces 1er et 2 mars vous pourrez les voir sur ARTE.
C'est par le biais des témoignages que Rafael Lewandowski et Raphaëlle Branche ont choisi de revenir sur la guerre d'Algérie. Soixante ans après la signature des accords d'Evian en mars 1962, la série ARTE "En Guerre(s) pour l'Algérie" revient en six épisodes sur la guerre d'Algérie du point de vue de ceux qui l'ont vécue. La professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Nanterre Raphaëlle Branche est l’invitée pour revenir sur cette série documentaire qui se penche sur des témoignages intimes pour raconter ce conflit à hauteur individuelle.
Les témoignages inédits de 66 acteurs
du conflit ont été recueillis.

En guerre(s) pour l'Algérie
En 1954, la guerre de libération algérienne commence, ébranlant le régime colonial français installé depuis 1830. C'est le début de huit longues années de conflit acharné, un des plus traumatisants du siècle. A l'occasion des 60 ans des accords d'Evian, cette série documentaire livre un récit aussi éclairant que touchant, en alliant archives et témoignages de celles et ceux qui ont vécu cette guerre, en Algérie, en France ou en exil.
Ils sont civils algériens ou français d'Algérie, militants indépendantistes ou membres de l'OAS, appelés du contingent ou militaires de carrière, porteurs de valise ou combattants. Tous étaient restés silencieux ou discrets. Pour la première fois, ils ont accepté de raconter leur guerre d'Algérie, ces huit années d'un des conflits les plus traumatisants du XXe siècle. Ils s'appellent Brahim, conducteur de l'autocar Biska-Adès attaqué le 1er novembre 1954 par des insurgés, point de départ symbolique de la dernière guerre coloniale française ; Abdelkader Bakhouche, un ancien officier du FLN, qui raconte ses 283 attentats ; l'ancien capitaine parachutiste Roger Saboureau évoque les "ratissages" à la recherche des rebelles ; Stive décrit les viols de femmes perpétrés par sa compagnie et l'exécution des hommes etc.
Six épisodes
Au total, 66 témoins et acteurs des deux camps se sont confiés à l'historienne Raphaëlle Branche et le réalisateur Rafael Lewandowski pour nourrir une série documentaire produite par l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) pour Arte. Enrichie d'images d'archives parfois inédites, En guerre(s) pour l'Algérie sera diffusée par la chaîne franco-allemande sous la forme de six épisodes chronologiques de 52 minutes les 1er et 2 mars, à l'occasion du 60e anniversaire de la fin du conflit.
Elle sera aussi disponible sur la plateforme éducative Lumni Enseignement. Les 180 heures d'entretien seront également mises en ligne en intégralité sur le site de l'Ina.
En avant-première vous pouvez visionner les 6 épisodes en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022071/en-guerre-s-pour-l-algerie/

 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 27 Février 2022 à 08:07
Revue de presse
Algérie : quelle relation avec la France
60 ans après l'indépendance ?

A l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la sociologue Samia Chabani, le président de l'Association des Pieds Noirs Progressistes, Jacques Pradel, et la documentaliste d'origine algérienne, Fatima Sissani, retracent les liens entre Marseille et l'histoire algérienne.
La ville située dans le sud de la France, a accueilli des milliers de français d’Algérie rapatriés après l’indépendance algérienne de juillet 1962.
"Sur 800 000 habitants à Marseille, près de 200 000 à 300 000 sont concernés, à un titre ou à un autre, par l'Algérie et l'histoire de la guerre d'Algérie, qu'ils soient descendants d'immigrés algériens, ou pieds noirs, harkis, rapatriés.... Cela constitue donc, dans la ville et dans le récit urbain, une part considérable de l'histoire de Marseille. " a déclaré Samia Chabani, sociologue et présidente de l'association Ancrages à Marseille.
En 60 ans, l'Algérie a traversé de multiples crises avec la France, souvent alimentées par la politique intérieure. Malgré les critiques de part et d’autres de la méditerranée, les relations entre les deux pays restent stables jusque dans les années 90.
" Nous sommes actuellement devant l'école Bugeaud, enfin, l'ex école Bugeaud, dans le troisième arrondissement de Marseille. Le nom de cette école, et de la rue éponyme, a donné lieu à de nombreuses protestations pour débaptiser l'école puisqu'il fait référence au maréchal Bugeaud, qui a participé à la conquête de l'Algérie, mais qui était connu pour ses pratiques absolument infâmes. " a ajoutéSamia Chabani, sociologue et présidente de l'association Ancrages à Marseille.
La guerre d’indépendance de huit ans achevée avec la signature des accords d’évian le 18 mars 1962 a causé des dégâts à la fois matériels et immatériels. Dans les années 90, cette histoire commune n’est pas toujours assumée sereinement par les pouvoirs comme par les sociétés.
" Les jeunes n'ont pas le poids des temps difficiles que les autres générations, les générations précédentes, ont connu. __Ils sont libérés de cela. Ils sont évidemment beaucoup plus ouverts à la réalité de l'histoire. " a expliquéJacques Pradel, président de l'Association des Pieds Noirs Progressistes.
Selon les historiens français, un demi-million de civils et de combattants sont morts - dont 400 000 Algériens - tandis que les autorités algériennes insistent sur le fait que 1,5 million de personnes ont été tuées.
Lorsqu’il arrive au pouvoir en 2017 le président français Emmanuel Macron a œuvré pour guérir les blessures du passé grâce a une série de gestes officiels et symboliques. Il a toutefois refuser de s’excuser pour le colonialisme.
Cette décision, ajoutée au commentateur du président qui a remis en question l'existence de l'Algérie en tant que nation avant l'invasion de la France dans les années 1800.
En réponse à cela, l'Algérie a annoncé le retrait de son ambassadeur en France après ces mots.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visualiser une vidéo :
https://fr.africanews.com/embed/1852576

60 ans après la guerre d’Algérie. « J’ai servi dans la cuvette d’ Ait Ouabane »
Ancien conseiller général de Rennes et directeur de cabinet d’Edmond Hervé, François Richou était un jeune appelé de 20 ans quand il a été affecté en grande Kabylie, au 39e régiment d’infanterie, entre novembre 1958 et novembre 1960.

François Richou sur une mule utilisée pour les déplacements d’unités en Algérie. | OUEST-FRANCE
À Rennes, François Richou est connu comme ancien conseiller général de Rennes et directeur de cabinet d’Edmond Hervé qui fut le premier maire socialiste de Rennes. Aujourd’hui, il est régulièrement porte-drapeau du Souvenir français lors des cérémonies mémorielles à Rennes. Pendant la guerre d’Algérie, François Richou était un jeune appelé de 20 ans quand il a été affecté en grande Kabylie, au 39e régiment d’infanterie, entre novembre 1958 et novembre 1960. Démobilisé et redevenu journaliste, il retourne en Algérie en mars 1962. Il témoigne.
Dans quelles circonstances partez-vous la première fois en Algérie ?
J’avais 20 ans en 1958, j’ai grandi à Angers. Depuis un peu plus d’un an, je travaillais à la rédaction du Courrier de l’Ouest. Je suis parti en juillet avec le contingent 58-1 C au 5e régiment d’infanterie de Blois pour suivre la formation des quatre mois de classes avant le départ pour l’Algérie. On y apprenait à faire la guerre, sur les terrains militaires.

François Richou a été conseiller général de Rennes et directeur de cabinet d’Edmond Hervé, premier maire socialiste de Rennes. | OUEST-FRANCE
Mais on faisait surtout la garde, car il y avait des risques d’attentats dans les gares, les stations-service, les casernements… Nous l’avons fait, par exemple, à Salbris, en Sologne, où il y avait un dépôt de munitions. J’ai appris à monter et démonter des fusils américains alors qu’en Algérie nous avions un matériel français.
J’ai eu une permission de 48 heures pour aller dire au revoir à ma famille. J’espérais rester comme observateur, j’étais convaincu que c’était une bêtise de faire la guerre. Je n’aurais pas dû le dire, j’ai été envoyé… Nous avons mis les paquetages dans les camions, puis avons défilé à pied jusqu’à la gare de Blois.
« Certains d’entre vous ne reviendront pas »
Je me souviendrai toujours la foule massée sur le chemin, de chaque côté de la rue. On lisait dans leurs yeux de la tristesse, il n’y avait pas de protestation mais une forme de gravité. Les gens voulaient montrer de la sympathie aux appelés.

François Richou montrant la région dans laquelle il a servi en Algérie entre 1958 et 1960. | OUEST-FRANCE
Nous étions plusieurs centaines. Le train était très ancien, tout en bois, sans possibilité de s’allonger. Sur le quai de la gare, le colonel présent a fait un discours. « Certains d’entre vous ne reviendront pas », a-t-il dit. Nous avons mis 24 heures pour rejoindre le port de Marseille. Une fois sur place, 24 autres heures dans le centre de tri de l’armée avant d’embarquer sur le « Ville d’Alger » qui n’était vraiment fait pour des passagers mais les cales étaient énormes. Dans le golfe du Lion, il y a eu une tempête, c’était l’enfer.

Le calot de François Richou pendant son service en Algérie de novembre 1958 à novembre 1960. | OUEST-FRANCE
Où avez-vous servi en Algérie ?
Le lendemain matin, nous sommes descendus en colonne du bateau avant de marcher le long des quais d’Alger. On passait devant des médecins, on nous faisait un vaccin supplémentaire puis une tasse de thé avant de reprendre nos affaires. Le lendemain, c’était la dispersion. J’ai été affecté en grande Kabylie, avec le 2e bataillon du-39e régiment d’infanterie (2-39e) qui revenait du Maroc. Dans le paquetage, j’avais un sarouel, et des sandales du désert. Puis, on a eu des treillis et des chaussures à clous. Puis des chaussures de montagne, comme les chasseurs alpins.

François Richou montrant sa casquette dit « Bigeard » qu’il portait pendant la guerre d’Algérie. | OUEST-FRANCE
Nous avons très vite été envoyés sur le terrain pour des missions variées. D’abord avec la compagnie opérationnelle qui partait en opération tous les trois ou quatre jours, parfois plus, et au retour on avait 24 heures de repos. Ça se passait essentiellement dans la cuvette des Ait Ouabane, un territoire d’une longueur de 10 à 15 km et 4 à 5 km de large. Ça montait jusqu’à 2300 mètres, avec une végétation assez, variable selon l’altitude, notamment des forêts de cèdres, et de la rocaille avant le sommet. Ce n’était l’Algérie que j’avais imaginé, avec du sable et des palmiers.
Sur place, on ne pensait qu’à la mission que nous devions remplir à l’instant. Il ne fallait surtout pas perdre ses affaires et suivre le mouvement.
« Des cris horribles, quinze hommes décapités »
Avez-vous été marqué par une mission en particulier ?
Nous avions été réveillés dans la nuit par des cris épouvantables en provenance d’un petit village à 300 mètres de notre campement. Sur place, c’était un bain de sang. Nous avons découvert quinze corps d’hommes décapités, entourés de femmes et de vieux. Les fellaghas venaient de passer, ils avaient tué ces hommes qui travaillaient en France et qui étaient revenus en vacances en Algérie. On a appelé au secours pour que des hommes des environs s’occupent des dépouilles et assurent le rite des funérailles musulmanes.
Puis nous avons reçu l’ordre de poursuivre les fellagas. On nous a donné des rations de combat. La neige commençait à tomber, nous avons suivi leurs traces, vers On a suivi leurs pas, ça semblait se dirigeait vers le massif du Djurdjura. Nous avons marché des heures, dormi en chemin, puis repris la traque. Nous les avons rattrapés le troisième jour, après avoir été ralentis à plusieurs reprises par des tireurs qui couvraient leur fuite.
Ils s’étaient abrités dans une grotte. Ils étaient une vingtaine. Nous avons fait le siège de la grotte en nous rapprochant difficilement. Des tirs nourris ont été échangés. C’était mon baptême du feu. Pendant tout ce temps, avec un petit porte-voix, le sous-lieutenant qui nous commandait leur demandait de se rendre. On voulait faire des prisonniers pour qu’ils rendent des comptes. L’un d’eux a voulu sortir, les autres lui ont tiré dans le dos…
À la fin de la journée, l’assaut a été donné. Nous avons tiré de nombreuses grenades à fusil, puis lancé des grenades à main. ll a fallu grimper pour s’approcher de l’entrée. J’étais devant dans une équipe de grenadiers voltigeurs. J’ai envoyé une bonne vingtaine de grenades dans la grotte. Au bout d’un moment, plus personne ne tirait.
Une katiba de 60 hommes attaque le camp
Avez-vous été confronté au feu ?
L’accrochage le plus important, c’est quand j’étais détaché à 1500 mètres d’altitude, dans une ancienne colonie de vacances des chemins de fer à Tikjda, avec des soldats de la 27e division d’infanterie alpine. Nous avions à peu près tous le grade de caporal, répartis en cinq sections de trente, une grosse compagnie de 150 hommes. À tour de rôle, on commandait un groupe, montait la garde en faisant des opérations autour du poste qui était ravitaillé par convoi qui venait une fois par mois. Un dimanche soir, les fellaghas nous ont attaqués. L’après-midi, on se distrayait, on avait bu des bières, et on s’était couchés tôt. On dormait de sommeil et d’ivresse avant d’être réveillée par une importante fusillade. La patrouille venait de sortir et était tombée sur les fellaghas qui étaient en train d’entourer le poste.

Une photo prise par François Richou, lors d’un « accrochage » avec des fellaghas. | OUEST-FRANCE
Nous recevons l’ordre de sortir « en étoile » pour réoccuper si possible la montagne autour du camp, qui était dans le creux d’une cuvette. Les fellaghas étaient sur les pentes, c’était une katiba de passage. Ils devaient être une soixantaine, équipés d’un petit mortier de 60 mm. Il y a eu un mort parmi nous et plusieurs blessés. Nous les avons rattrapés, dans les sommets, la rocaille. Nous sommes restés au contact toute la journée, la nuit et une partie de la journée suivante avant de décrocher. Ils avaient laissé un groupe pour nous retenir.
Aviez-vous l’occasion d’échanger avec la population locale ?
Pendant les six derniers mois de mon service en Algérie, j’ai été nommé adjoint à un chef de poste de regroupement des populations. J’étais sous-officier de renseignement-contact pour collecter des renseignements sur les fellaghas. J’allais chez les gens avec un interprète et un garde du corps. On m’offrait souvent le café.
Ces échanges vous permettaient-ils aussi de collecter du renseignement d’utilité militaire ?
Un jour, à la fin de l’été 1960, une famille m’a dit qu’ils se faisaient racketter par les fellaghas sur le chemin du marché. J’y suis allé. J’ai pris un caporal engagé et un harki. Tous les trois, nous nous sommes habillés en civil, et sommes allés sur la piste pour attendre les premiers villageois avant de nous joindre à eux. Nos armes étaient cachées sous un burnous et j’avais un panier pour cacher le poste radio. Rien ne disait qu’on était des soldats français, on pouvait être des fellaghas.
Nous les avons enfin repérés, ils étaient trois : un homme portait un fusil en bandoulière, sur le chemin, l’autre était à côté de la piste, au milieu, il y avait une femme assise sur une chaise qui ramassait l’argent. Les villageois se sont cachés quand ils ont compris qu’il allait se passait quelque chose. Nous nous sommes retrouvés à découvert sur la piste. L’un des hommes nous a visés, mais mon fusil-mitrailleur était prêt, j’ai tiré le premier et je l’ai touché. Il s’est enfui, le second homme aussi. La femme s’est retrouvée seule. C’était une personne de plus de 50 ans. Elle nous a raconté sa vie, elle était chargée de la trésorerie.
« Oublie tout ça » m’a-t-on dit à mon retour
Comment êtes-vous accueillis par vos proches à votre retour ?
En novembre 1960, quand je rentre, j’aurais dû être joyeux, mais je suis triste car ça a été difficile de quitter les copains. La fraternité d’armes, ça existe. Je les côtoyais depuis deux ans, voire plus pour ceux que je connaissais depuis les classes. « Oublie tout ça » me disait-on. J’ai compris que ce n’était pas la peine de parler de tout ça, c’était dérangeant. La famille s’est réunie très nombreuse pour fêter mon retour, mais j’étais l’enfant de la famille qui revenait, pas un soldat.
Je suis allé voir très vite mon directeur au journal le Courrier de l’ouest. Quand j’ai évoqué mon retour à la rédaction, il m’a dit « vous savez, on ne vous a pas attendu ». J’ai répondu : « je sais, mais selon la loi, je dois retrouver mon travail ». Pendant quelques semaines, j’ai repris le boulot à Angers, puis j’ai été envoyé à l’agence de Saumur. Nous étions deux journalistes. J’ai passé mon permis assez vite pour être mobile.
Retournez-vous en Algérie ?
À partir du 19 mars (date des accords d’Evian), j’avais une seule idée en tête : partir en reportage en Algérie. J’avais d’abord un accord avant la hiérarchie ne revienne sur sa décision en arguant que « tout venait de toute façon des agences de presse ».
De toute façon, je voulais y aller. À l’époque, j’avais demandé plusieurs fois la carte de journaliste, sans la décrocher. Nous nous sommes quittés en bons termes quand même. Ils m’ont offert le train jusqu’à Marseille, en me disant d’envoyer des articles. J’en ai envoyé un seul qui ne m’a jamais été payé d’ailleurs…
J’ai rejoint l’Algérie en avril. J’ai eu les papiers pour avoir un laissez-passer en prétextant un problème familial. J’avais un cousin qui pouvait m’héberger à Boufarik dans la Mitidja, la plaine la plus prospère.
Que découvrez-vous sur place ?
J’ai vu qu’Alger était une ville en état de siège alors que la campagne, en tout cas celle de Boufarik était assez tranquille. J’ai été jusqu’à Blida. J’ai parlé avec des gens qui se présentaient comme des FLN sortis du Maquis. La guerre OAS-FLN c’était seulement dans les villes. Je suis resté un mois et demi en Algérie, mais je suis reparti fin mai- début juin, en même temps que les pieds noirs. Les bateaux étaient pris d’assaut. Je suis allé à l’aéroport d’Alger pendant 48 heures. Mon cousin s’est débrouillé avec un équipage. Je me suis retrouvé dans la cabine d’un avion Constellation, je suis arrivé de nuit à Marseille.
Que faites-vous à votre retour ?
Je ne sais pas trop ce que j’allais faire. J’ai essayé de vivre à Paris. Je me suis engagé bénévolement avec la LICA (Ligue contre l’antisémitisme), devenue ensuite la LICRA, qui accueillait les Pieds noirs. Puis j’ai fait connaissance avec Charles Hernu à l’époque (qui sera ministre de la défense sous la présidence de François Mitterrand). C’était mes premiers pas en politique…
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 25 Février 2022 à 20:24
LE MOUVEMENT DE LA PAIX CONDAMNE FERMEMENT
LES ACTES DE GUERRE
DE LA RUSSIE
Et appelle partout à l’action
pour dire non
à la guerre

Des manifestations étaient déjà proposées dans tout le pays dès le 12 février dernier et le Mouvement de la Paix appelait à des temps forts le samedi 26 février, mais aussi le mercredi 2 mars.
La situation nouvelle les rend indispensables pour crier :
Non à la guerre !
Oui aux solutions non-violentes, politiques, diplomatiques et négociées dans l’esprit de la Charte des Nations Unies et avec les Nations Unies comme cadre privilégié d’élaboration des solutions politiques et diplomatiques.
Oui à la réduction des dépenses d’armement, à l’élimination des armes de destruction massive et à la mise en œuvre du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN).
Oui à des négociations entre tous les pays Européens sur les conditions de la paix et d’une sécurité mutuelle en Europe dans l’esprit de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (dit aussi l’acte final d’Helsinki). Pour une Europe de paix et de coopération, pour un système de sécurité mutuelle en Europe, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la dissolution de l’OTAN.
Partout, multiplions les manifestations pour dire « non à la guerre oui à la négociation » en inscrivant notre action dans les mobilisations en cours à travers l’Europe et dans le monde entier, avec des temps forts : samedi 26 février, mercredi 2 mars et samedi 5 mars 2022.
A Paris, le jeudi 24 février 2022
Le Mouvement de la Paix
62 ANS APRÈS L’EXPLOSION
DE “GERBOISE BLEUE”
DANS LE SAHARA ALGÉRIEN
(Première explosion atomique française)
Français·es et Algérien·ne·s au coude à coude
Pour la paix, le désarmement nucléaire et l’amitié entreles peuples
A l’occasion du 62ème anniversaire de la première explosion d’une bombe atomique française (Gerboise bleue) dans le Sahara algérien, le Mouvement de la Paix français, le collectif Paix et Développement Algérien et l’association Farhwa Fatma N’Soumeur se sont rencontrés le 12 février 2022 et ont fait la déclaration suivante :
« Nous réaffirmons notre solidarité dans l’action pour la Paix et l’amitié entre les peuples et notre attachement plus particulier au développement des liens d’amitié entre le peuple algérien et le peuple français, développement auquel nous travaillons conjointement depuis 24 ans.
Nous réaffirmons notre exigence d’une élimination totale des armes nucléaires en application du Traité de Non-Prolifération Nucléaire (TNP) et du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).
Nous souhaitons que nos deux gouvernements ratifient le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires. Si le gouvernement algérien a une longueur d’avance puisqu’il a signé le TIAN nous souhaitons que le gouvernement français rattrape son retard en signant et ratifiant au plus vite ce traité.
Nous souhaitons que nos deux Etats participent à la prochaine réunion de mise en œuvre du TIAN qui aura lieu à Vienne en juillet 2022.Le Mouvement de la Paix français souhaite que la France assume totalement ses responsabilités pour ce qui concerne les conséquences des essais nucléaires en Algérie.
Nous souhaitons conjointement que les coopérations nécessaires entre les deux gouvernements se développent pour que la France procède aux travaux de décontamination des zones qui ont subi les essais nucléaires français.
NON à la guerre, OUI à un espace euro-méditerranéen de paix.
Vive l’amitié franco-algérienne ! vive la Paix ! »
Paris, le 12 février 2022
Le Mouvement de la Paix français, Le collectif Paix et Développement Algérien et l’association Farhwa Fatma N’Soumeur.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par micheldandelot1 le 25 Février 2022 à 08:44
Guerre d'Algérie : la France coloniale avait aussi
"ses camps de concentration"...
en Kabylie (Livre)

Un nouvel ouvrage vient de relever le couvercle sur les crimes du colonialisme français en Algérie. Il s'agit de : "Le Journal d'un pacificateur" d'Hugues Robert qui relate son histoire personnelle et celle de son père, Jean-Marie Robert, ancien sous-préfet d'Akbou, en Kabylie (Algérie).
Le livre, comme l'a expliqué l'auteur lors de son passage sur le plateau de Tv5 monde, relate les exactions commises en Algérie occupée par l'armée coloniale. Étant né en Kabylie où il a vécu une partie de son enfance, Hugues Robert raconte comment il a pu changer son regard envers son propre père qu'il considérait comme "un démon".
"C'était lors d'un voyage en Algérie et plus particulièrement en Kabylie (100 km à l'est d'Alger). J'ai alors découvert comment mon père était finalement pour l'Algérie algérienne et contre le système colonial qui n'a rien fait pour ce pays en 130 ans de décolonisation", raconte-t-il.
Selon son récit, Jean-Marie Robert était le premier officiel français à dénoncer les exactions de l'armée française et les exécutions sommaires des civils algériens. "Le livre se réfère à des documents inédits et de centaines de lettres retrouvés en 2017. Il nous montre ce qui se jouait dans les coulisses de l'Etat entre 1959 et 1976", indique-t-il.
L'auteur rappelle, dans ce sens, comment son père dénonçait les pratiques de l'armée coloniale. "L'armée française rassemblait des gens dans des camps et les laissait mourir de faim et de froid. Mon père a donc protesté auprès des généraux en leur disant : 'on a libéré les camps nazis, mais vous avez mis en place d'autres ici'.
Jean-marie Robert dénonçait aussi la torture", rapporte l'auteur.
L'ancien sous-préfet, raconte-t-il, avait aussi dénoncé le système colonial en rappelant que "la France n'a rien fait pour les populations en Algérie".
"Il a montré que ce qu'il avait fait lui en trois ans, avec la construction d'un nouvel hôpital et de routes à Akbou, le colonialisme ne l'a pas fait en 130 ans", précise le même auteur.
Jean-Marie Robert a également dénoncé l'exécution de harkis (collaborateurs de l'armée française) par le FLN après l'indépendance du pays.
"Je cherche en vain dans l'Histoire contemporaine un autre Etat qui ait livré 150 000 amis de leur pays à leurs ennemis mortels", avait lancé l'ex sous-préfet en janvier 1963, pour dénoncer l'attitude de la France officielle.

Jean-Marie Robert fut l'un des premiers haut fonctionnaire d'Etat français à condamner le sort réservé aux indigènes pendant la guerre d'Algérie. À base d'archives capitales et des documents inédits, son fils en a fait un livre : "Le journal d'un pacificateur" (éditions Max Milo).
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 24 Février 2022 à 06:49
Emmanuel Macron : le triomphe
de l’histoire en miettes
Par Olivier Le Cour Grandmaison
8 février 2022. Soixante ans après, les « événements » survenus au métro Charonne sont qualifiés de « tragédie » par Emmanuel Macron dans le communiqué rendu public par l’Elysée. Efficace cheville rhétorique, l’hyperbole ici employée est aux discours commémoriels ce que la main gauche est aux illusionnistes. Elle détourne l’attention pendant que la main droite s’active pour cacher ce qui doit l’être.
« L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L’investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l’origine de toutes formations politiques… » Ernest Renan, 1882
« Il n’est jamais mauvais qu’exposé à cette histoire mémoriale-oublieuse, l’historien prenne ses livres (…). L’histoire-science peut résister à l’oubli logé dans l’histoire édifiante, l’empêcher de “raconter des histoires”. » Jean-François Lyotard, 1988
Organisée par plusieurs partis politiques et syndicats du mouvement ouvrier pour protester contre les attentats commis par l’OAS et pour la paix en Algérie, il est rappelé que cette manifestation a été « violemment réprimée par la police » puisque « neuf personnes ont perdu la vie » et « plusieurs centaines furent blessées ».
Un hommage est rendu à la « mémoire des victimes et de leurs familles », est-il écrit en conclusion. Comme on pouvait s’y attendre, les dévots du président ont applaudi ce geste qui confirmerait sa volonté de « regarder l’histoire en face » et d’œuvrer sans relâche à la réconciliation des mémoires, selon les éléments de langage répétés ad nauseam en de telles circonstances. Quelques historiens empressés et intéressés se sont joints à ce chœur louangeur en saluant ce « pas en avant » longtemps attendu par celles et ceux qui militent depuis des décennies pour l’établissement de la vérité. Singulière mais classique complaisance de quelques amoureux de Clio. Contrairement à ce qu’il serait légitime d’attendre d’eux, ils semblent préférer l’éclat des ors de la République et la fréquentation des « grands » à l’entêtement de faits désormais avérés et documentés de façon précise et circonstanciée.
Une fois encore, cette initiative présidentielle, qui s’ajoute à plusieurs autres pour des raisons liées à la conjonction inédite d’épisodes majeurs de la guerre d’Algérie et d’échéances électorales décisives, est d’une partiélité et d’une partialité remarquables puisqu’elle est contraire aux connaissances établies par les spécialistes de la manifestation du 8 février 1962(1).
De plus, ce geste demeure très en-deçà de la reconnaissance pleine et entière exigée notamment par le collectif « Vérité et Justice pour Charonne ». Comme souvent en ces matières, le communiqué élyséen mobilise une hyperbole creuse - « tragédie » -, qui permet, dans le même mouvement, d’occulter la pusillanimité de ce communiqué, - le refus de qualifier avec précision le comportement des forces de l’ordre en atteste -, et d’accréditer l’opinion selon laquelle il est fait droit à la gravité des actes commis par ces dernières.
Efficace cheville rhétorique, l’hyperbole ici employée est aux discours commémoriels ce que la main gauche est aux illusionnistes. Elle détourne l’attention pendant que la main droite s’active pour cacher ce qui doit l’être.
Au terme de cet artificieux tour langagier, les grands mots – de même pour la formule convenue « les pages sombres de l’histoire » souvent utilisée en des circonstances analogues - passent pour de courageuses déclarations, et des vessies sont prises pour des lanternes par une cohorte hétéroclite de fidèles du président, de naïfs vrais ou faux, et de personnalités diverses soucieuses de rester en cour ou de la fréquenter.
L’efficacité discursive du terme « tragédie(2) », et aux autres vocables du même tonneau, tient également à ceci qu’il s’agit de mots pare-feu destinés à nommer pompeusement des événements devenus condamnables pour mieux circonscrire le périmètre de ceux qui en portent la responsabilité. Dans ce cas d’espèce, les sommets de la hiérarchie policière et politique sont placés hors champ, épargnés donc. Quant au massacre, jamais nommé, il demeure sans coupable d’importance ni adresse précise.
En effet, les personnalités diverses qui exerçaient le pouvoir, la Cinquième République et l’État in fine sont rendus invisibles afin de ménager certaines fractions de l’électorat et de préserver des mythologies nationales, partisanes et personnelles jugées fondamentales au prestige de la France et des institutions républicaines. Réputées toujours fidèles à leurs traditions comme à leurs idéaux, ces dernières demeurent, à l’instar de la divine Marie, innocentes, immaculées et vierges. Sublime magie de la rhétorique commémorative. Elle parvient ainsi à feindre la reconnaissance tout en préservant les images d’Épinal chères aux amoureux transis de l’Hexagone et des grands hommes qui ont présidé à ses destinées universelles et glorieuses.
De là cette autre (in)conséquence majeure : la néantisation du rôle joué par les ministres et le préfet qui ont décidé d’interdire la manifestation du 8 février 1962, de la réprimer dans le sang, de couvrir le massacre d’État au moyen d’un mensonge forgé en haut lieu puis diffusé par une certaine presse et des medias contrôlés par l’exécutif. N’oublions pas la justice, soumise, complaisante et aux ordres. Saisie, elle a fait preuve d’une très servile et opportune lenteur qui l’a conduit, quatre ans plus tard, à considérer que son action devait s’achever conformément à la loi d’amnistie du 18 juin 1966.
Euphémisation, dénégation, mépris de l’histoire et de ceux qui l’ont pourtant écrite, sont au fondement du communiqué élyséen qui ravale de très graves événements au rang de bavure condamnable mais étrangère au gouvernement de l’époque.
En quelques mots, Emmanuel Macron et ses communicants affairés réhabilitent la thèse, qui n’est qu’une mauvaise fable politique infirmée par les recherches menées par Alain Dewerpe, selon laquelle les policiers auraient agi à l’insu de leurs supérieurs hiérarchiques et du gouvernement. Stupéfiantes régression et réécriture de l’histoire qui conjuguent opportunisme, électoralisme et désinvolture scandaleuse à l’endroit des travaux les mieux informés.
Anticommunistes notoires, le premier ministre Michel Debré, le ministre de l’Intérieur Roger Frey et le préfet de police Maurice Papon se sont en effet donnés les moyens juridiques et humains d’empêcher puis de réprimer comme rarement une mobilisation jugée dangereuse pour l’autorité de l’Etat et de son chef, le général de Gaulle. Avec son aval, faut-il préciser, puisqu’avant la manifestation ce dernier avait déclaré : les « agitateurs » doivent être réduits et châtiés. Martial et lumineux langage.
Le but ainsi fixé, il suffisait désormais de laisser faire « l’intendance » qui s’est exécutée dans les conditions que l’on sait. Après quoi, les premiers se sont empressés de justifier et de saluer, comme il se doit, l’action des fonctionnaires de police. Selon les formules utilisées par celui qui se trouvait place Beauvau(3), il s’agissait de préserver l’ordre public contre la « subversion » de « véritables émeutiers » qui sont donc coupables de ce qu’il s’est passé.
Très classique inversion maligne qui consiste à imputer aux manifestants des comportements prétendument séditieux pour mieux les accuser d’être à l’origine des violences subies, lesquelles sont désormais légitimes puisqu’elles ont été motivées par la volonté de conjurer une menace jugée exceptionnelle. Au temps du massacre a succédé le temps du mensonge des pouvoirs publics forgé pour les besoins de la cause : celle de la raison d’Etat et celle des hommes qui depuis longtemps la servaient.
Relativement au massacre du 17 octobre 1961, au cours duquel furent tués des centaines d’Algériens rassemblés pacifiquement à l’appel du FLN pour protester contre le couvre-feu raciste qui leur était imposé depuis le 5 octobre par Maurice Papon et le gouvernement, Emmanuel Macron use de procédés similaires. Contre toute vérité historique, politique et institutionnelle, il circonscrit la responsabilité des « crimes commis cette nuit-là » aux forces de l’ordre agissant « sous l’autorité » du préfet de police.
Et c’est ainsi que cet autre massacre d’État, bien plus important que celui de Charonne eu égard au nombre de victimes et aux moyens employés : rafles, internement de masse, exécutions sommaires, noyades, tortures, disparitions forcées, -, se transforme en un crime imputable au seul Maurice Papon. Mauvaise fable qui serait dérisoire si elle n’était obscène en raison de l’extrême gravité des faits qu’elle travestit et de l’occultation des rapports hiérarchiques de l’époque sur laquelle elle prospère.
L’autoritaire Emmanuel Macron, qui aux dires de beaucoup se complait dans la verticalité des rapports de pouvoir, croit-il lui-même à cette fable forgée par ses services ? Il est permis d’en douter. Élu président, il s’est coulé avec délice dans les institutions de la Cinquième République en réprimant avec la vigueur que l’on sait tous les mouvements sociaux. Il est donc fort bien placé pour savoir qu’un préfet de police, qui plus est en période de crise particulièrement grave, n’est qu’un exécutant.
Quoi qu’il en soit, les spécialistes, historiens, politistes ou juristes(4) ont établi que Maurice Papon a agi, avant, pendant et après le 17 octobre 1961, avec l’aval de ses supérieurs, le ministre de l’Intérieur Roger Frey et le chef du gouvernement Michel Debré ; tous deux résolus, quoi qu’il en coûte, à empêcher une démonstration de force du FLN dans la capitale. À charge pour le préfet d’accomplir cette mission particulièrement importante. Elle s’inscrit dans la continuité de celles qui lui ont été confiées par le premier : «frapper juste et fort» pour « démanteler (...) l’organisation rebelle(5).(5) »
Soutenus par des personnalités du parti présidentiel, l’Union pour la Nouvelle République (UNR), les mêmes ont aussitôt couvert les pratiques meurtrières de leur subordonné puis élaboré une version officielle destinée à minorer de façon drastique le nombre de victimes et à imputer les « heurts » aux militants du FLN. Voilà qui confirme ceci : la dénégation et l’inversion des responsabilités sont au principe de l’action et de la rhétorique de ceux qui, ayant commis et/ou justifié un crime d’Etat, doivent immédiatement l’occulter en forgeant un récit leur permettant d’échapper au scandale et de continuer à exercer légitimement le pouvoir sans être inquiétés.
Comme pour Charonne, le communiqué du président de la République, relatif au 17 octobre 1961, témoigne d’une conception platement partisane, instrumentale et utilitariste de l’histoire, ceci expliquant cela, et des travaux de celles et ceux qui l’ont écrite en s’appuyant sur des archives, des sources diverses et des témoignages circonstanciés.
De là la singularité des rapports qu’Emmanuel Macron, ce très mauvais et très infidèle élève de Paul Ricoeur, entretient avec les faits. Quelquefois convoqués, le plus souvent de façon partielle, ces derniers sont presque toujours tronqués, arrangés et minimisés pour mieux les coucher dans le lit de Procuste de commémorations officielles qui prétendent révéler l’Histoire alors qu’elles ne cessent de raconter des histoires fragmentaires.
Et des histoires parfois abracadabrantesques, comme le prouve la fiction élyséenne élaborée pour rendre compte des crimes commis le 17 octobre 1961 puis à Charonne ; tous relevant, est-il soutenu, d’initiatives répréhensibles de subordonnés débordés et/ou désireux de prendre leur revanche sur le FLN d’abord, sur le Parti communiste ensuite. Courage de la vérité mis au service d’un désir de connaissance exhaustive ? Souci de restituer la complexité d’une période et des événements qui ont eu lieu ? Volonté de les reconnaître pleinement ? Ces quelques commémorations prouvent qu’il n’en est rien.
Le procédé politico-rhétorique employé par le président est des plus classiques. Il a fort bien été identifié, défini et analysé par Roland Barthes qui le nomme « vaccine(6) ». Elle « consiste à confesser le mal accidentel d’une institution (…) pour mieux en masquer le mal principiel. »
Dans le cas présent, il s’agit de domestiquer l’histoire en imposant une pauvre mais efficace histoire-bataille destinée à satisfaire certains en évitant, autant que faire se peut, les foudres de quelques autres. Sans être édifiante, puisqu’il ne s’agit évidemment pas de célébrer des victoires et d’encenser des héros mais de réprouver des actes et de condamner ceux qui les ont commis, cette histoire-bataille repose sur des procédés voisins : la décontextualisation sociale, politique et institutionnelle des acteurs et des massacres commis, lesquels ne sont plus que des actes isolés sans rapport les uns avec les autres(7).
Là où existaient un système et des institutions diverses – gouvernement, police, armée, justice…- dirigés par un président, un gouvernement et des ministres, qui ont fixé les orientations, et des fonctionnaires civils et militaires qui ont rempli les missions définies par les premiers, ne reste plus que quelques individualités et une histoire en miettes. Une histoire ? Un récit officiel bien plutôt qui repose sur la simplification et la réécriture mensongère, par omission, des événements. L’ensemble est conçu pour éviter tout scandale, complaire aux desservants du culte national et entretenir la thèse immunitaire, mythologique et consensuelle, à droite comme au sein d’une certaine gauche, selon laquelle le gouvernement de l’époque, le général de Gaulle, bien sûr, la France et la République, cela va de soi, sont absolument étrangers à ce qu’il s’est passé.
Certains contemporains se sont élevés avec vigueur contre de telles affirmations. Pierre-Vidal Naquet, notamment, en démontrant de façon précise que les pratiques mises en œuvre par l’armée et la police, des deux côtés de la Méditerranée, étaient les conséquences d’une politique arrêtée au sommet de l’Etat(8). Rappelons aussi aux « oublieux »de l’Elysée et à ceux qui les soutiennent que le général Pâris de Bolladière a demandé être relevé de son commandement pour protester contre l’usage de la torture avant d’en témoigner publiquement dans L’Express du 29 mars 1957. De même Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d’Alger, qui a pris la décision de démissionner de ses fonctions quelques mois plus tard, le 12 septembre 1957, considérant que le recours à la question et les disparitions forcées étaient systématiques désormais.
Relativement à la guerre d’Algérie, Emmanuel Macron a soutenu qu’il est confronté à un « défi mémoriel(9) » particulièrement dramatique comparable, nonobstant la différence de nature des crimes commis, à celui qu’a affronté Jacques Chirac lorsqu’il a reconnu, dans son célèbre discours du 16 juillet 1995, que « la folie criminelle de l’occupant a été secondée (…) par l’État français ». Et, précisait-il, par sa police et sa gendarmerie qui ont livré 13 000 Juifs à « leurs bourreaux » lors des rafles des 16 et 17 juillet 1942.
Comparons donc. Dans un cas, la France, le régime de Pétain, les institutions de l’époque et les différents corps chargés d’assurer la défense du nouvel ordre public, dictatorial, raciste et antisémite, sont désignés de façon explicite afin d’établir ceci : tous furent responsables et coupables d’avoir commis «l’irréparable.» Dans l’autre, la politique mémorielle et commémorielle de l’actuel président de la République évite constamment de semblables mises en cause. Hier, un homme d’État résolu qui, en dépit de l’opposition de nombreux « barons » gaullistes, d’une fraction du parti qui le soutenait et de son propre électorat, a prononcé un discours courageux et précis. Aujourd’hui, les faux-fuyants et les contorsions rhétoriques d’un « Jupiter » auto-proclamé qui se comporte en chef de parti plus soucieux de sa réélection et de la défense de ses intérêts particuliers que de la vérité.
Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, imaginons ce que devrait être une juste déclaration relative aux crimes perpétrés dans cette colonie. « 19 mars 2022.
La France reconnait que dix ans après la prise d’Alger en 1830, les colonnes infernales du général Bugeaud ont commis l’irréparable en se livrant à de nombreuses razzias, enfumades et tueries. Au XXème siècle, l’irréparable encore. Souvenons-nous des terribles massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, de la répression sanglante de militants nationalistes algériens lors de la manifestation parisienne du 14 juillet 1953, du crime d’Etat du 17 octobre 1961 et de celui du métro Charonne le 8 février 1962.
N’oublions pas les centaines de milliers de victimes de la guerre d’Algérie au cours de laquelle l’armée française a torturé, déporté les populations civiles, interné en masse dans des camps regroupant plus de 2 millions d’Algériens, soit un quart de la population totale.
Irréparables toujours les disparitions forcées, les exécutions sommaires, les viols des femmes. Soixante ans après, la France reconnait que l’Etat, la République, leurs forces armées, leur police et leur gendarmerie ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Soixante ans après, la France rend hommage aux victimes de ce terrible conflit, décide d’ouvrir toutes les archives et d’élever un lieu de mémoire dans la capitale afin que nul n’oublie. »
Le Cour Grandmaison, universitaire. Dernier ouvrage paru : « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, La Découverte, 2019 et, avec O. Slaouti (dir.), Racismes de France, La Découverte, 2020.
(1). Cf l’ouvrage de référence sur le sujet : A. Dewerpe, Charonne. 8 février 1962 : anthropologie historique d’un massacre d’Etat, Paris, Gallimard, 2006.
(2). Lorsque les faits sont particulièrement graves, l’adjectif « inexcusable » est ajouté pour renforcer le poids des mots et frapper plus encore les imaginations. Pareille formule permet d’éviter le recours à des qualifications autrement plus précises – celles de crime de guerre voire de crime contre l’humanité - et plus lourdes de conséquences politiques voire juridiques. « Tragédie inexcusable » ; telle fut l’expression employée par l’ambassadeur de France en Algérie, H. Colin de Verdière le 27 février 2005 suivi, au mois de mai de la même année, par Michel Barnier, alors ministre des Affaires étrangères. De là cette conséquence majeure : les auteurs de cette « tragédie inexcusable » : l’Etat français, ses forces armées et ses milices coloniales, ayant commis les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, ne sont jamais désignés et c’est précisément pour éviter qu’ils le soient que ce syntagme pare-feu est utilisé.
(3). Dès le lendemain, le 9 février 1962, Roger Frey décide de saisir L’Humanité et Libération dans un contexte où, depuis longtemps déjà, les pouvoirs publics prennent beaucoup de liberté avec les libertés fondamentales en recourant à la censure et à la saisie de nombreuses publications et ouvrages jugés contraire à la doxa officielle. Tel fut également le sort réservé aux ouvrages de Paulette Péju, Ratonnades à Paris et Les Harkis à Paris publiés par Fr. Maspero en 1961.
(4). Cf., l’ouvrage pionnier de Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris : le 17 octobre 1961, Paris, Seuil, 1991 puis Octobre 1961 : un massacre à Paris, Paris, Fayard, 2001, et notamment Linda Amiri, La Bataille de France : la guerre d’Algérie en métropole, Paris, R. Laffont, 2004, Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961 : les Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire, Paris, Tallandier, 2008, Emmanuel Blanchard, La Police parisienne et les Algériens (1944-1962), Paris, Nouveau Monde Editions, 2011, Arlette Heymann-Doat, Guerre d’Algérie. Droit et non-droit, Paris, Dalloz, 2012 et Fabrice Riceputi, Ici on noya des Algériens, Paris, Le Passager clandestin, 2021.
(5). Roger Frey cité par Le Monde, 16 octobre 1961.
(6). R. Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 238.
(7). De même pour l’assassinat, le 27 mars 1957, de l’avocat nationaliste algérien, maître Ali Boumendjel, arrêté, torturé et précipité, sur ordre du commandant Aussaresses, du sixième étage d’un bâtiment pour faire croire à un suicide. Dans ses mémoires publiées en 2001, ce dernier a reconnu les faits et livré d’assez nombreux détails. Cf., Services spéciaux. Algérie 1955-1957, Paris, Perrin, 2001, pp. 173-178. Là encore, ce crime de guerre, qui fit scandale, a été couvert par la hiérarchie militaire, le pouvoir politique de l’époque et le très socialiste président du Conseil, Guy Mollet. Cf. P. Vidal-Naquet, La Torture dans la République, (1963), Paris, Les Editions de Minuit, 1972, p. 72 et suiv. Quant à Emmanuel Macron, il s’en est tenu à ce cas emblématique en se gardant bien de rappeler qu’il n’était pas le seul et que cet assassinat fut la conséquence de pratiques : la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées, légitimées par une doctrine bien connue : celle de la guerre contre-révolutionnaire qui les a érigées en système.
(8). P. Vidal-Naquet, La Torture dans la République, op. cit. , p. 12 et suiv.
(9). Le Monde, 25 janvier 2000.
Histoire et mémoire
Manifeste pour la reconnaissance
et la réparation des crimes et dommages
coloniaux français en Algérie

1. La reconnaissance de la responsabilité unilatérale de la France coloniale en Algérie.
La France est aujourd’hui à la croisée des chemins avec la question de savoir si elle sera capable de passer un pallier dans la gestion apaisée de ses démons mémoriels en particulier celui avec l’Algérie qui fut une des guerres les plus tragiques du 20e siècle. La problématique centrale n’est pas la repentance, les excuses ou le ni ni avec une reconnaissance générique mais la question de la reconnaissance de la responsabilité française en Algérie, notion juridique, politique et philosophique.
Cette question de la responsabilité unilatérale de la France coloniale est centrale au même titre que la déclaration du Président Chirac en 1995 sur la responsabilité de l’Etat Français concernant la déportation des juifs durant la seconde guerre mondiale. Cette reconnaissance qui ouvra la voie à l’indemnisation de ces victimes.
La barbarie coloniale française en Algérie ne peut être édulcorée par quelques rapports fantasmés d’auteurs qui flirtent avec les pouvoirs politiques de droite comme de gauche depuis 40 ans. La question des massacres, crimes et autres dommages impose inéluctablement une dette incompressible de la France vis-à-vis de l’Algérie.
La stratégie développée depuis toujours est de faire table rase du passé, une offense à la dignité des algériens. Cette responsabilité est impérative car elle peut sauver l’âme de la France qui est fracturée par ses démons du passé.
La reconnaissance de la responsabilité c’est admettre que la France s’est mal comportée en Algérie et qu’elle a créé de nombreux dommages avec des centaines de milliers de victimes et des dégâts écologiques incommensurables avec ses nombreuses expériences nucléaires et chimiques.
Que s’est-il réellement passé en Algérie durant près de cent-trente-deux années d’occupation ? La colonisation et la guerre d’Algérie sont considérées et classées comme les événements les plus terribles et les plus effroyables du XIXe et XXe siècle. La révolution algérienne est aussi caractérisée comme l’une des plus emblématiques, celle d’un peuple contre un autre pour recouvrer son indépendance avec des millions de victimes.
L’ignominie française en Algérie se traduit par les massacres qui se sont étalés sur près de cent-trente années, avec une évolution passant des enfumades au moment de la conquête, aux massacres successifs de villages entiers comme Beni Oudjehane, pour aller vers les crimes contre l’Humanité du 8 mai 45 sans oublier les attentats tels celui de la rue de Thèbes à Alger. La violence était inouïe à l’encontre des indigènes algériens. Entre 600 et 800 villages ont été détruits au napalm. L’utilisation par la France des gaz sarin et vx était courante en Algérie. La torture à grande échelle et les exécutions sommaires étaient très proches des pratiques nazies.
La France sait qu’elle a perdu son âme en Algérie en impliquant son armée dans les plus sales besognes. Ces militaires devaient terroriser pour que ces indigènes ne puissent à jamais relever la tête. Plus ils massacraient, plus ils avaient de chance de gravir les échelons.
La colonisation, c’est aussi la dépossession des Algériens de leurs terres où ces indigènes sont devenus étrangers sur leurs propres terres.
Le poison racisme est le socle fondateur de tout colonialisme. Sous couvert d’une mission civilisatrice, le colonisateur s’octroie par la force et en bonne conscience le droit de massacrer, torturer et spolier les territoires des colonisés. La colonisation française de l’Algérie a reposé sur l’exploitation de tout un peuple, les Algériens, considérés comme des êtres inférieurs de par leur religion, l’islam.
Il suffit de relire les illustres personnages français, Jules Ferry, Jean Jaurès, Léon Blum et tous les autres que l’on nous vante souvent dans les manuels scolaires.
La résistance algérienne sera continue, de 1830 jusqu’à l’Indépendance en 1962, même si de longues périodes d’étouffement, de plusieurs années, seront observées. Sans excès, on peut affirmer que la colonisation a abouti à un développement du racisme sans précédent et nourri la rancœur des colonisés.
Etrangement, plus on martyrisait la population algérienne, plus sa ténacité à devenir libre était grande. Sur le papier, l’Algérie était condamnée à capituler devant la cinquième puissance mondiale. Le bilan tragique n’a pas empêché les Algériens de gagner cette guerre d’indépendance avec une étrange dialectique. Les enfants des ex colonisés deviendront français par le droit du sol et continueront d’hanter la mémoire collective française.
On tente aujourd’hui de manipuler l’Histoire avec un déni d’une rare violence en continuant de présenter cette colonisation comme une œuvre positive, un monde de contact où les populations se mélangeaient et les victimes étaient symétriques. Une supercherie grossière pour ne pas assumer ses responsabilités historiques.
Colons et colonisés n’étaient pas sur un pied d’égalité, il y avait une puissance coloniale et des européens et de l’autre coté des indigènes avec des victimes principalement du côté des colonisés algériens. Cette population indigène a été décimé de 1830 à 1962 faisant des centaines de milliers de victimes, morts, torturées, violées, déplacées, spoliées et clochardisées, devenant des sujets sur leurs propres terres. Cette réalité est indiscutable et vouloir la noyer par quelques rapports dans un traitement symétrique c’est prolonger une nouvelle forme de déni et de domination sous couvert de paternalisme inacceptable.
Le monde fantasmé du Professeur Stora est une insulte à la réalité historique, d’autant plus grave qu’il la connaît parfaitement. Son rapport répond à un objectif politique qu’il a bien voulu réaliser pour des raisons étranges mais certaines : édulcorer les responsabilités avec un entre deux savamment orchestré laissant supposer l’égalité de traitement des protagonistes pour neutraliser la reconnaissance de la responsabilité unilatérale de la France coloniale en Algérie. Le rapport est mort né car il n’a pas su répondre aux véritables enjeux de la responsabilité de la France coloniale en Algérie. Le jeu d’équilibriste pour endormir les algériens n’a pas pu s’opérer car les consciences des deux côtés de la méditerranée sont alertes. Personne n’est dupe sauf ceux qui ne veulent pas assumer les démons de la barbarie coloniale française en Algérie.
2. La France face à son démon colonial où le syndrome de l’ardoise magique.
Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, la France a déployé une batterie de stratagèmes pour ne pas être inquiété sur son passé colonial. La France sait précisément ce qu’elle a commis durant 132 années comme crimes, viols, tortures, famine des populations et autres. Pour se prémunir contre tous risques de poursuites, elle a exigé aux algériens d’approuver une clause d’amnistie lors du cessez-le-feu. D’autres lois d’amnisties furent promulguées par la suite pour tenter d’effacer toute trace de cette barbarie coloniale. La suffisance de certains est allée jusqu’a obtenir la promulgation d’une loi en 2005 vantant les mérites de la colonisation française en Algérie. Ultime insulte aux victimes algériennes qu’on torturait symboliquement à nouveau.
3. Pourquoi la France a peur de reconnaître ses responsabilités.
Reconnaître les responsabilités des crimes et dommages coloniaux c’est inéluctablement accepter l’idée d’une réparation politique et financière ce que la France ne peut admettre aujourd’hui face à une certaine opinion pro Algérie française encore vivace sur ce sujet.
Mais c’est aussi accepter de revoir la nature de la relation franco algérienne ou la rente permet toujours à la France de préserver sa position monopolistique sur ce marché qui est toujours sa chasse gardée.
C’est bien sûr également la peur de perdre une seconde fois l’Algérie française mythifiée, celle du monde du contact largement développée dans le rapport Stora.
Enfin, la crainte de devoir rendre des comptes d’une manière singulière aux enfants de colonisés qui constituent le principal des populations habitant les banlieues populaires françaises où le poison racisme est omniprésent. Il suffit de lire le dernier rapport du Défenseur des droits sur les discriminations pour s’en convaincre.
Ces dernières années, un nouveau palier s’est opéré avec l’idée que ces citoyens musulmans où les algériens sont majoritaires, sont devenus en France les ennemis de la République car ils sont souvent accusés d’être les nouveaux porteurs de l’antisémitisme français. Aujourd’hui, la majorité de cette population subit une triple peine. La première est d’être souvent considérée comme étranger dans le regard de l’autre, car enfant de la colonisation, enfants de parents qui se sont battus pour ne pas être français.
Ensuite, le fait d’être musulman dans la cité française se confronte à l’image séculaire de cette religion qui est maltraitée depuis au moins mille ans.
Enfin, cette population est suspectée d’être porteuse du nouvel antisémitisme français car solidaire du peuple palestinien. Ces palestiniens qui sont aujourd’hui parmi les derniers colonisés de la planète. Les Algériens ont connu la même colonisation et sont unis à jamais à ce peuple opprimé par un lien indicible qui s’exprime dans les tripes et le cœur. Entre Algériens et Palestiniens demeure une identité commune avec un combat similaire contre la colonisation. Dans une continuité idéologique, la France est depuis toujours l’un des plus fervents défenseurs de l’État d’Israël. En Algérie, le peuple dans sa grande majorité est palestinien de cœur car ce que subissent les Palestiniens dans le présent, il l’a subi dans le passé par la puissance coloniale française. Ce lien fraternel est aussi visible dans la diaspora algérienne qui est presque toujours pro-palestinienne, sans forcément connaître l’origine de ce lien profond.
Ce sont ces constituants qui enferment cette population comme les supposés porteurs du nouvel antisémitisme, faisant d’elle, la cible privilégiée du poison français alors que l’on aurait pu croire que le système les en aurait protégés un peu plus du fait d’un racisme démultiplié à leur encontre. Les musulmans où les algériens sont majoritaires sont silencieux comme s’ils avaient été frappés par la foudre. Ils sont perdus dans cette société française, égaux en droit et rejetés dans les faits par un racisme structurel aggravé par une mémoire non apaisée.
À quelques très rares exceptions, les intellectuels et relais d’opinion abondent dans le sens du vent assimilationniste. Ils espèrent en tirer profit et acceptent d’être utilisés comme des « Arabes de service » faisant le sale boulot en s’acharnant à être « plus blanc que blanc ». Leurs missions sont de vanter à outrance le système assimilationniste ou le déni de mémoire est fortement présent. Ces partisans du modèle assimilationniste savent au fond d’eux-mêmes qu’ils ont vendu leurs âmes en étant du côté de l’amnésie imposée du plus fort. Leur réveil se fait souvent douloureusement lorsqu’on les relève de leur poste en politique ou dans les sphères où ils avaient été placés en tant que porte-drapeaux du modèle assimilationniste. Ils se retrouvent soudainement animés par un nouvel élan de solidarité envers leur communauté d’origine, ou perdus dans les limbes de la République qui les renvoie à leur triste condition de « musulmans » où d’enfants d »indigènes ».
La faiblesse de cette population toujours en quête d’identité et de mémoire apaisée est peut être liée à l’absence d’intellectuels capables de les éclairer pour réveiller un peu leur conscience et leur courage face à une bien-pensance très active en particulier sur ces questions mémorielles.
4. L’inéluctable réparation des crimes et dommages de la colonisation française en Algérie.
La France, via son Conseil Constitutionnel, a évolué dans sa décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, en reconnaissant une égalité de traitement des victimes de la guerre d’Algérie permettant le droit à pension aux victimes civiles algériennes. Nous nous en félicitons mais la mise en œuvre a été détournée par des subterfuges juridiques rendant forclos quasi toutes les demandes des victimes algériennes. Comme si la France faisait un pas en avant et deux en arrière car elle ne savait pas affronter courageusement les démons de son passé colonial, pour apaiser les mémoires qui continuent de saigner.
Il ne peut y avoir une reconnaissance des crimes contre l’humanité commis en Algérie par la France et dans le même temps tourner le dos aux réparations des préjudices subis y compris sur le plan environnemental. La première marche du chemin de la réparation financière c’est de nettoyer les nombreux sites nucléaires et chimiques pollués par la France en Algérie ainsi que les nombreuses victimes comme le confirme l’observatoire de l’Armement. C’est une question de droit et de justice universelle car tout dommage ouvre droit à réparation lorsqu’il est certain, ce qui est le cas en Algérie. Sauf si on considère la colonisation française en Algérie comme une œuvre positive comme la France tente de le faire croire depuis la promulgation de la loi du 23 février 2005 qui est un outrage supplémentaire à la dignité des algériens.
La France ne peut échapper à cette réparation intégrale car sa responsabilité est pleinement engagée. D’une part c’est une question de dignité et d’identité des algériens qui ne s’effacera jamais de la mémoire collective de cette nation.
C’est pourquoi les jeunes générations contrairement à l’espérance de certains ne cesseront d’interpeler la France et l’Algérie sur cette question mémorielle.
Sur la nature de cette réparation, la France devra suivre le chemin parcouru par les grandes nations démocratiques comme l’Italie qui, en 2008, a indemnisé la Lybie à hauteur de 3.4 milliards d’euros pour l’avoir colonisé de 1911 à 1942, mais aussi : l’Angleterre avec le Kenya, les Etats unis et le Canada avec les amérindiens ou encore l’Australie avec les aborigènes. L’Allemagne a accepté, depuis 2015, le principe de responsabilité et de réparation de ses crimes coloniaux avec les Namibiens mais butte sur le montant de l’indemnisation. Avec le risque pour l’Allemagne d’une action en justice devant la Cour Pénale Internationale du gouvernement Namibien, avec l’assistance d’un groupe d’avocats britanniques et la demande de 30 milliards de dollars de réparations pour le génocide des Ovahéréro et des Nama.
La France elle-même s’est fait indemniser de l’occupation allemande durant la première et seconde guerre mondiale à hauteurs de plusieurs milliards d’euros d’aujourd’hui. Au même titre, l’Algérie indépendante doit pouvoir être réparée des crimes contre l’humanité et dommages qu’elle a subi de 1830 à 1962.
Cette dimension historique a un lien direct avec le présent car les évènements semblent se répéter, les banlieusards d’aujourd’hui sont en grande partie les fils des ex-colonisés. On continue à leur donner, sous une autre forme, des miettes avec comme point culminant cette nouvelle forme de discrimination, poison ou racisme invisible, matérialisé dans toutes les strates de la société.
L’Histoire ne doit pas se répéter dans l’hexagone, les miettes accordées ici et là sont révélatrices d’un malaise profond de la République française. En particulier, son incapacité à fédérer tous ses citoyens, poussant certains à la résignation, au retranchement et parfois aux extrémismes.
Paradoxalement, c’est le modèle français qui produit le communautarisme alors qu’il souhaite le combattre.
Comme un exercice contre-productif, il lui explose au visage car il ne sait pas comment l’aborder. C’est aussi ce modèle qui pousse un grand nombre de ces citoyens franco algériens à ne pas être fier d’être français. Cette révolution algérienne fait partie de l’Histoire de France à la fois comme un traumatisme à plus d’un titre, mais aussi comme un lien sensible entre les Français quelles que soient leurs origines. Le cœur de cette double lecture est lié à cette singularité algérienne qui n’a jamais démenti ses attaches à l’islam. Cet islam a été utilisé par la France comme porte d’entrée pour coloniser l’Algérie et soumettre sa population. Il a aussi donné la force à cette population algérienne de faire face au colonialisme français, comme porte de sortie de la soumission.
En France et ailleurs, cette religion semble interpeller les sociétés dans lesquelles elle s’exprime. A l’heure d’une promulgation d’une loi sur le séparatisme qui risque de stigmatiser un peu plus cette population musulmane ou les algériens sont nombreux, l’enlisement semble se perpétuer comme si l’apaisement des mémoires tant voulue était un peu plus affaibli car nous sommes toujours incapable d’expliquer à nos enfants le traitement différencié à l’égard des victimes de cette tragédie historique.
5. L’Algérie face à ses responsabilités historiques.
Le silence de l’Algérie est lourd car elle n’a pas su appréhender la question de sa mémoire d’une manière énergique et l’illégitimité de ses gouvernances successives a maintenu des revendications peu soutenues à l’égard de la France. Pire, les problématiques algériennes ont trop souvent, surfé sur cette fibre mémorielle pour occulter leurs inefficiences à gérer d’une manière performante le pays. Aujourd’hui, L’Algérie ne peut plus faire table rase du passé colonial français et se contenter de quelques mesurettes ou gestes symboliques. L’Algérie au nom de ses chouadas doit assumer une revendication intégrale, celle de la reconnaissance pleine et entière de la responsabilité des crimes et dommage de la colonisation en Algérie.
L’objectif de cette réparation n’est pas de diaboliser l’ex-puissance coloniale, mais au contraire de lui permettre de se réconcilier avec elle-même afin d’entrer définitivement dans une ère d’amitié et de partenariat. L’Algérie a laissé perdurer une approche minimaliste comme si elle était tenue par son ex puissance coloniale, tenu par le poison corruption qui la gangrène de l’intérieur et qui la fragilise dans son rapport avec la France. Comme si l’Algérie enfermée dans une position toujours timorée avait peur de franchir la ligne de l’officialisation de sa demande de réparation alors que la France l’avait faite de son coté en légiférant en 2005 sur les bienfaits de la colonisation française en Algérie. Aujourd’hui, au nom de la mémoire des chouadas, l’Algérie doit également assumer ses responsabilités historiques.
6. L’urgence d’agir.
Sur la question mémorielle, reconnaître la responsabilité de la France sur les crimes et les dommages coloniaux y compris écologiques et les réparer financièrement au même titre que les principales grandes puissances mondiales. Abroger la loi de 2005 sur les bienfaits de la colonisation, la loi Gayssot et la loi sur l’antisémitisme pour déboucher sur une seule loi générique contre tous les racismes permettant de rassembler au lieu de diviser. Nettoyer les sites pollués nucléaires et chimiques et indemniser les victimes. Restituer la totalité des archives algérienne. Signer un traité d’amitié avec l’Algérie et suppression des visas entre les deux pays.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 23 Février 2022 à 09:49
Revue de presse française
Et aussi celle que vous ne verrez jamais
en France !!!
La guerre d'Algérie, un conflit aux plaies encore vives

Tlemcen se prépare à accueillir François Hollande en visite officielle de deux jours en Algérie le 20 décembre 2012. Le président français avait alors reconnu la domination coloniale «brutale» de la France sur le peuple algérien, sans s'en excuser, alors qu'il cherchait à lancer une nouvelle ère dans les relations avec l’Algérie. (Bertrand Langlois/Pool/AFP)
- Emmanuel Macron reconnaît en 2018 que le mathématicien Maurice Audin est mort sous la torture de l'armée française en 1957, et demande «pardon» à sa veuve
- En septembre, le président Macron demande «pardon» aux harkis qui furent «abandonnés» par la France après avoir combattu pour elle
PARIS : Soixante ans après la fin de la guerre de l'Algérie (1954-1962), les plaies sont encore vives de part et d'autre malgré des gestes symboliques au fil des ans de la France, qui exclut toutefois «repentance» ou «excuses».
Introspection douloureuse
Il faut attendre près de 40 ans, en 1999, pour que la France qualifie officiellement de «guerre» cette période douloureuse et sanglante ayant scellé l'indépendance de son ancienne colonie.
Comme Valéry Giscard d'Estaing, premier chef d'État français à effectuer en 1975 une visite officielle dans l'Algérie désormais indépendante, François Mitterrand et Jacques Chirac se gardent de condamner la colonisation durant leurs mandats élyséens.
En 2007, en visite à Alger, le président Nicolas Sarkozy déclare que «le système colonial a été profondément injuste», mais évoque «d'innombrables victimes des deux côtés».
En 2012 à Alger, François Hollande va plus loin en déclarant que «pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal». Le 19 mars 2016, il est le premier président à commémorer la fin de la guerre d'Algérie, provoquant une levée de boucliers parmi une partie de la classe politique.
Cinq ans après, en février 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, provoque un tollé à droite et parmi les rapatriés d'Algérie en déclarant que la colonisation « c'est un crime contre l’humanité », « une vraie barbarie ». « Ca fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes », ajoute-t-il.
«Actes symboliques»
En septembre 2018, devenu président, M. Macron reconnaît que le jeune mathématicien communiste Maurice Audin est mort sous la torture de l'armée française en 1957, et demande « pardon » à sa veuve.
Après la publication du rapport de l'historien français Benjamin Stora, en janvier 2021, il s'engage à des « actes symboliques » pour tenter de réconcilier les deux pays, mais exclut cette fois « repentance » et « excuses ».
Début mars, il reconnaît ainsi, « au nom de la France », que l'avocat nationaliste Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » le 23 mars 1957 par l'armée française, contredisant la thèse officielle de son suicide.
En septembre, le président Macron demande « pardon » aux harkis qui furent « abandonnés » par la France après avoir combattu pour elle, et annonce un projet de loi « de réparation », adopté le 15 février 2022.
Regain de tension avec Alger
Le 2 octobre 2021, Alger rappelle, pour trois mois, son ambassadeur à Paris, en réaction indignée aux propos d'Emmanuel Macron affirmant devant des jeunes que l'Algérie, après son indépendance, s'est construite sur « une rente mémorielle » entretenue par « le système politico-militaire ».
Le 16 octobre, M. Macron déclare que « les crimes commis le 17 octobre 1961 sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République », 60 ans après le massacre de manifestants algériens pacifiques à Paris.
Après avoir annoncé un accès facilité aux archives classifiées, Paris annonce le 10 décembre l'ouverture de celles concernant « les enquêtes judiciaires » de la guerre d'Algérie.
Le 26 janvier 2022 Emmanuel Macron exprime « la reconnaissance » de la France envers les rapatriés d'Algérie et invite à reconnaître comme tels deux « massacres » ayant eu lieu après la signature des accords d'Evian : la fusillade de la rue d'Isly à Alger, le 26 mars 1962, et le « massacre du 5 juillet 1962 » à Oran.
Le 8 février, il rend hommage aux manifestants morts au métro Charonne à Paris le 8 février 1962 lors d'un rassemblement pacifique contre l'OAS très violemment réprimé par la police. C'est le premier président à rendre hommage aux neuf victimes de ce rassemblement organisé entre autres par le parti communiste, la CGT, et l'UNEF.
MARSEILLE REVISITE SES « HISTOIRES » D'ALGÉRIE
Avant-poste de la France coloniale, port d'arrivée pour des milliers d'ouvriers algériens puis pour les rapatriés à l'indépendance de l'Algérie il y a 60 ans, Marseille concentre des histoires franco-algériennes multiples et souvent douloureuses qu'elle commence à revisiter.
Dans la deuxième ville de France, « on estime que sur plus de 800.000 habitants, près de 200.000 sont concernés de près ou de loin par l'Algérie », souligne Samia Chabani, directrice d'Ancrages, centre de ressources sur l'histoire et les mémoires des migrations à Marseille.
Parmi elles, les pieds-noirs, Européens originaires de France, d'Espagne ou d'Italie, établis en Algérie depuis des générations et rapatriés dans l'urgence et la douleur après une guerre qui fit près de 500.000 morts civils et militaires, dont quelque 400.000 Algériens, selon les historiens.
Mais aussi des Harkis, supplétifs de l'armée française, des Marseillais appelés à combattre en Algérie, ainsi que des immigrés algériens, parfois militants indépendantistes, et les descendants de tous ces groupes.
Les grandes cités de Marseille construites à la va-vite dans les années 1960 virent passer une partie de ces populations ballottées entre les deux pays.
Des Algériens fuyant la « décennie noire » (1991-2002) ou des étudiants ont ensuite rejoint la ville portuaire. Chaque semaine, les ferries blancs reliant Alger symbolisent les liens toujours forts entre ces cités méditerranéennes «miroirs».
Quand il s'agit d'évoquer la guerre d'Algérie et les 132 ans de colonisation, les mémoires restent «compartimentées», constate l'historienne Karima Dirèche, spécialiste de l'Algérie au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). S'il existe un monument aux rapatriés, il n'y a pas de lieu du souvenir faisant consensus entre les mémoires blessées.
Certains à Marseille travaillent pourtant au dialogue de ces histoires.

Comme Jacques Pradel, président de l'Association nationale des pieds-noirs progressistes, qui, avec Ancrages et des associations de la diaspora algérienne et antiracistes, organisent des commémorations pour les accords d'Evian. Une démarche peu commune, beaucoup de pieds-noirs refusant de commémorer ces accords qu'ils vivent comme un moment sombre.
Né à Tiaret (nord-ouest de l'Algérie), Jacques Pradel a grandi dans « une famille de colons français, un milieu privilégié», même si l'ancêtre arrivé au XIXe siècle «était un petit paysan du Tarn chassé par la misère »
« Comme mes parents étaient fondamentalement antiracistes, cela m'a aidé à ouvrir les yeux sur la réalité » du système colonial, raconte à l'AFP ce scientifique retraité. A 18 ans, pour éviter d'être enrôlé de force dans l'Organisation de l'armée secrète (OAS) luttant contre l'indépendance de l'Algérie, il part en France. Ses parents suivront.
« Réconciliation sincère »
Même si des blessures restent, l'exil, la perte de cet ami d'enfance algérien qui se détourna de lui pendant la guerre, il milite pour une réconciliation «sincère et durable» entre les deux pays. Sa bibliothèque regorge d'ouvrages sur l'Algérie, mais sans nostalgie, avec nombre d'auteurs algériens contemporains.
La réconciliation passe par la pénétration dans la société du « formidable travail des historiens », dit celui qui approuve la déclaration du président français Emmanuel Macron admettant que la colonisation était «une vraie barbarie».
Ancrages raconte de son côté les histoires souvent oubliés des Algériens de Marseille. Comme ces ouvriers recrutés en masse par les industries de la région et qui s'étaient reconstitués un foyer dans les rues étroites de Belsunce.
«Le café nord-africain y constitue un lieu de sociabilité, d'expression musicale, mais c'est là aussi que s'organisent les revendications pour l'indépendance», rappelle Samia Chabani en illustrant ses propos avec la façade désormais murée du Moka.
Pendant la guerre, « ces cafés seront très contrôlés par la police française et certains immigrés internés », rappelle-t-elle.
Fatima Sissani, établie à Marseille, a réalisé un documentaire sur des femmes engagées dans le Front de libération nationale (FLN), pour comprendre l'histoire d'une guerre que ses parents, immigrés en France, taisaient.
En mai dernier, Marseille a donné le nom d'un tirailleur algérien ayant participé à la libération de la ville en 1944, Ahmed Litim, à une école auparavant baptisée Bugeaud, un militaire colonisateur, même si mi-février aucune plaque n'était encore visible avec ce nouveau nom.
« Une école ne saurait ériger en modèle un bourreau des guerres coloniales. Nous ne pouvons ni l'expliquer ni le justifier à nos enfants », avait plaidé le maire Benoît Payan.
Fadila avait un grand-père algérien ayant combattu pour la France en 1914-1918. Cette Marseillaise aimerait que ces histoires soient mieux connues.
Préférant taire son nom, car le sujet de la guerre d'Algérie reste sensible, elle voudrait qu'un jour les blessures cicatrisent : « Parce que la France et l'Algérie, on est liés, comme ça ensemble », dit-elle en croisant les doigts de ses mains.
Source : https://www.arabnews.fr/node/208416/france
France-Algérie : une relation mouvementée 60 ans après les Accords d’Évian

Le 4 juin 1958, lors de la visite du général de Gaulle à Alger. - PHOTO AFP
Le tumulte des mots et des mémoires : 60 ans après la fin de la guerre d’Algérie, la relation entre Paris et Alger, plutôt porteuse dans les décennies qui ont suivi l’indépendance, s’emballe régulièrement, prise au piège d’enjeux de politique intérieure.
“Globalement, en dépit des apparences et des critiques, on a eu une relation stable, très équilibrée au regard de la situation coloniale et post-coloniale”, relève Luis Martinez, chercheur sur le Maghreb à Sciences Po Paris, alors que les deux pays s’apprêtent à commémorer sans effusion le 60e anniversaire du cessez-le-feu conclu à Evian le 18 mars 1962. Le courant passe bien entre les nouveaux dirigeants algériens et le général de Gaulle, respecté pour avoir ouvert la voie à la décolonisation de l’Algérie, son successeur Georges Pompidou ou François Mitterrand, pourtant ministre de l’Intérieur au début de l’insurrection algérienne en 1954. “Mitterrand était entouré de gens du Parti socialiste qui étaient tous pro-FLN. Il a su se mettre en retrait et apparaître comme l’homme des relations privilégiées avec ce pays”, raconte Pierre Vermeren, professeur d’histoire à La Sorbonne, en référence aux insurgés algériens du Front de libération nationale (FLN).
A l’indépendance, la France est autorisée à poursuivre ses essais nucléaires dans le Sahara jusqu’en 1967. En secret, l’armée française y mènera aussi des essais chimiques jusqu’en 1978. En 1992, François Mitterrand condamne la suspension du processus électoral en Algérie après la victoire des islamistes au premier tour des législatives. En riposte, Alger rappelle son ambassadeur pour consultation. Au sortir de la décennie noire de la guerre civile, en 2000, le nouveau président algérien Abdelaziz Bouteflika, pourtant très proche de la France, opte ouvertement pour un discours antifrançais. “Pour reprendre en main le champ idéologique et politique après la guerre civile, ils vont oublier que la France les a aidés à combattre les islamistes et revenir à leur ennemi traditionnel”, décrypte Pierre Vermeren.
“Dans le secret”
L’association des anciens combattants, les idéologues du régime développent un discours de plus en plus virulent sur le “génocide” français durant la colonisation. Vingt ans plus tard, après le coup de tonnerre du mouvement de protestation du Hirak, le pouvoir en place continue à fonder sa légitimité sur la guerre de libération. Mais au-delà du discours officiel, en coulisses, la coopération entre les deux pays se poursuit. En 2013, l’Algérie donne ainsi discrètement son feu vert au survol de son territoire par les avions militaires français engagés dans la lutte contre la jihadisme au Mali. “Les relations franco-algériennes sont bonnes quand elles sont dans le secret. Elles sont plus heurtées quand c’est public”, résume Naoufel Brahimi El Mili, auteur de “France-Algérie, 60 ans d’histoires secrètes”.
Avec Emmanuel Macron, premier président français né après la guerre d’Algérie, tout commence sous les meilleurs auspices. En février 2017, alors candidat à la présidentielle, il marque les esprits en déclarant depuis Alger que la colonisation est un “crime contre l’humanité”. Une fois élu, Emmanuel Macron multiplie les gestes mémoriels autour de la guerre d’Algérie, avec l’ambition de réconcilier les deux peuples.
Mais il n’ira pas jusqu’à prononcer des excuses pour la colonisation, un sujet hautement sensible en France où le discours ultranationaliste ne cesse de gagner en audience, jetant un froid à Alger. En septembre 2021, le chef de l’Etat finit de doucher les espoirs de rapprochement en reprochant au système “politico-militaire” algérien d’entretenir une “rente mémorielle” autour de la guerre d’indépendance et en suggérant que la “nation algérienne” n’existait pas avant la colonisation en 1830. En réaction, l’Algérie rappelle son ambassadeur.
“Il faut être deux”
La relation semble de nouveau reprendre de la hauteur à quelques semaines de la présidentielle française d’avril, dans laquelle sept millions de rapatriés, immigrés, harkis, appelés du contingent ou leurs descendants pèseront d’une manière ou d’une autre. “L’Algérie vote Macron. Les Algériens sont convaincus qu’un Macron II sera plus audacieux”, estime Naoufel Brahimi El Mili. “Ils ne veulent pas de Valérie Pécresse avec un discours assez droitier. Ils ne veulent surtout pas de Zemmour ou de Marine Le Pen”, les deux candidats de l’extrême-droite, renchérit l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, auteur de “L’Enigme algérienne”.
Pour autant, tout reste à faire. L’Algérie n’a pas saisi la main tendue du président Macron sur le travail de mémoire. La Chine est devenue son premier partenaire commercial. Elle s’est aussi rapprochée de la Turquie et a développé son partenariat militaire avec la Russie. “La relation franco-algérienne repart de zéro. On remet à plat et on essaie de voir sur quoi on peut s’entendre”, observe Luis Martinez. L’ex-ambassadeur se montre plus circonspect encore. “Il faut être deux pour avoir une relation”. Est-ce que l’Algérie le voudra après les élections ? “Je ne suis pas très optimiste”, esquisse Xavier Driencourt.
Algérie : 60 ans après les accords d'Evian

Sur cette photo d'archive prise le 18 novembre 1961, des manifestants crient des slogans en faveur de l'indépendance et de la paix en Algérie. Copyright © africanews-/AFP or licensors
Mohamed Mokrani, garde dans cette bibliothèque des souvenirs précieux de l'histoire de son pays l'Algérie. Cet ancien membre de l'Armée de libération nationale (ALN), a suivi minute par minute les négociations d'Évian depuis le quartier général de Ghardimaou, en Tunisie, où s'étaient réfugiés de nombreux "maquisards" (résistants). Soixante ans après les accords d'Evian marquant la fin de la guerre d'Algérie et le départ des colons après 130 ans d'occupation française, cet ancien responsable de l'ALN se souvient d'un jour ordinaire.
"Pour nous, soldats, officiers et commandants, le 19 mars était, un jour, ordinaire qui ne méritait pas d'être mentionné, car nous étions toujours dans une guerre en cours. Sauf qu'il donnait la date du référendum - le 3 juillet - et la date de l'indépendance - le 5 juillet 1962."
Après la signature de l'accord le 19 mars 1962, les chefs de l'ALN ont maintenu leurs troupes en position et "en état d'alerte maximum, jusqu'à l'annonce de l'indépendance en juillet de la même année. Les chefs de l'ALN craignaient à l'époque des provocations de l'OAS, l'Organisation armée secrète hostile aux accords d'Evian, et opposés à l'indépendance de l'Algérie.
"Quelques jours - deux ou trois - après le cessez-le-feu, des ordres ont été donnés à minuit pour frapper les positions de l'ennemi français. L'état-major voulait faire savoir à l'ennemi français que quoi qu'il fasse, nous avions le doigt sur la gâchette."
Selon les historiens algériens, environ 1 million et demi de personnes ont été tuées pendant la guerre de libération qui a duré huit ans entre 1954 et 1962.
MERCI DE CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS POUR VISUALISEZ
UNE VIDéo
https://fr.africanews.com/embed/1848602
Source : Algérie : 60 ans après les accords d'Evian | Africanews
«J’étais persuadé que la France était le paradis terrestre», se souvient Brahim, ancien du bidonville de Nanterre

A Nanterre, dans l’ouest parisien, ils étaient plus de 10 000 habitants à vivre dans des bidonvilles construits à la hâte à partir des années 1950 lorsqu’affluait en France une main-d’oeuvre venue notamment des colonies du Maghreb. Retour et visite guidée avec Brahim, ancien habitant, sur cet habitat édifié à la va-vite entre des allées de boue, de parpaings et de tôle.
Brahim Benaïcha, 68 ans, semble mélancolique lorsqu’il contemple l’espace scolaire des Pâquerettes, à Nanterre. Pourtant, il y a une soixantaine d’années, à la place de cet ensemble d’habitations HLM, se tenait un gigantesque bidonville. Celui de Nanterre était un des plus imposants de la région parisienne, avec plus de 10 000 habitants, majoritairement algériens. Ceux-ci étaient employés en France comme main-d’œuvre ouvrière, pour reconstruire le pays au sortir la Seconde Guerre mondiale. Le bidonville devint le symbole de la relégation des Nord-Africains, médiatisés lorsque des centaines d’Algériens en partirent pour manifester dans la capitale le 17 octobre 1961 à l’appel du Front de libération nationale. Brahim Benaïcha, ancien habitant, raconte « les conditions inhumaines » dans lesquelles il a vécu enfant.
« C’était plus qu’une porcherie, on vivait avec les rats » aux portes de Paris, résume-t-il. Les conditions sont « plus que sommaires », l’exiguïté de mise et l’intimité impossible tant les cloisons sont fines. À la moindre pluie, la peinture se délave, « tout fuyait » et « c’était rafistolé avec des feuilles de goudron ». Mais « la mémoire adoucit la violence », glisse M. Benaïcha, qui confie que son enfance fut aussi « heureuse ». L’ambiance était « solidaire » dans ce « village » aux murs empreints d’une « culture préservée », se souvient-il, loin des images de « lèpre urbaine » souvent associée à ce qui servit d’habitat à des milliers de personnes jusque dans les années 1970. À cette époque, « ce fut extrêmement violent d’être obligé de bouger du jour au lendemain en cité de transit », se souvient M. Benaïcha qui a perdu la chaleur de ce voisinage pour des tours où la population sera marginalisée. Et « ce fut une déchirure de quitter le bidonville », finalement détruit deux ans plus tard.
Cliquez sur ce lien pour visualiser une vidéo :
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par micheldandelot1 le 22 Février 2022 à 10:32
« Morts pour la France ou morts inutiles ? »

La Place des Martyrs à Alger. (Photo d’illustration) | GETTY IMAGES
Témoignage. « On n’a pas fait la guerre en Algérie pour sauver notre pays, mais pour s’opposer à un désir légitime d’indépendance. »
Pierre Daumas (Loire-Atlantique) :
J’ai lu avec intérêt la réflexion « Morts pour la France dans l’anonymat » (O.-F. du 10 février). Ce courrier me ramène soixante-quatre ans en arrière, en 1958, quand j’avais 12 ans. C’est en effet le 6 octobre 1958 que mon frère aîné a été tué en Algérie, à Souk-Ahras, près de la frontière tunisienne, avec trois autres soldats.
Il y était parti seulement quatre mois avant, en tant qu’appelé dans le cadre de son service militaire. Ses obsèques ont eu lieu plusieurs mois plus tard, dans ma petite ville du Loir-et-Cher, lorsque son corps a été rapatrié. Mort pour la France ? Cela a bien sûr été affirmé dans les discours officiels… Non, pas mort pour la France, puisque l’on ne faisait pas la guerre pour sauver notre pays, mais pour s’opposer au désir légitime de l’indépendance du peuple algérien.
Je ne suis pas naïf, l’accès de l’Algérie à l’indépendance ne pouvait que très difficilement se réaliser dans un climat serein et en brûlant certaines étapes. Mais que d’occasions ratées, de temps perdu, de manque de courage politique pour préparer et réaliser une indépendance qui, de toute évidence, ne pouvait qu’advenir, de gré ou de force, dans une volonté commune de construction ou dans la guerre.
Morts inutiles, oui je le pense. Cette mort de mon frère, et d’autres événements dans ma vie, m’ont fait aimer ce pays qu’est l’Algérie ainsi que des Algériens qui sont devenus des amis.
C’est sans doute aussi pour cela que j’ai adhéré sans hésiter à l’Association des appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre, créée voici plus de quinze ans par des anciens appelés. Ils mobilisent leur retraite d’anciens combattants pour financer des actions de développement auprès d’associations en Algérie et témoignent dans les établissements scolaires en France, avec le souci de développer la fraternité et la réflexion sur la guerre et l’esprit de paix. Morts pour la France ? Non. Morts inutiles, oui certainement… mais qui ont, peut-être, malgré tout fait germer la vie.
« Morts pour la France dans l’anonymat »

« Ils avaient vingt ans et ont été incorporés pour un « simple maintien de l’ordre », qui a duré vingt-sept mois pour beaucoup d’entre eux. » | ARCHIVES AFP
Le décès d’un soldat de la force Barkhane en Afrique fait l’objet d’une grande médiatisation et ses obsèques donnent lieu à des reportages largement télévisés sur les grandes chaînes nationales. Ces célébrations sont nécessaires pour la mémoire des disparus ainsi que pour leurs familles. Elles le sont aussi pour forger notre conscience nationale.
Lors de la guerre d’Algérie, des dizaines de milliers de soldats du contingent y ont perdu la vie. Ils avaient vingt ans et ont été incorporés pour un « simple maintien de l’ordre », qui a duré vingt-sept mois pour beaucoup d’entre eux.
Ils n’étaient pas des militaires professionnels et ils étaient bien jeunes. Aujourd’hui, les camarades de ceux qui ont été tués à leurs côtés voient la différence de traitement que notre pays aura faite entre ses « morts pour la France », ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui.
D’un côté les honneurs, de l’autre la mort anonyme. Bien des familles de ces « petits gars » constatent qu’à l’époque, on faisait peu de cas de leur malheur. Des souvenirs douloureux tourmentent encore beaucoup de contemporains de ces événements, actuellement octogénaires. Pensons aussi à eux.
Combien de bateaux de retour en métropole auront ramené des dizaines de cercueils dans leurs cales ?
À l’époque, on ne communiquait pas sur le nombre de décès au combat. Les journaux faisaient état, de temps en temps, de « victoires françaises » sur le terrain.
Tous ces dégâts humains pour quel résultat ? Une indépendance pour une population à qui on a toujours refusé la citoyenneté française dans ces trois départements où les uns, d’origine européenne, étaient citoyens alors que les autres, l’immense majorité, restaient des sujets. Ces derniers avaient les mêmes devoirs que les citoyens français, mais pas les mêmes droits.
Et nos politiques de l’époque ont envoyé sur ce territoire notre jeunesse pour défendre l’indéfendable. Comme toujours, les responsables des conflits ont fait payer à leurs peuples – mais pas qu’à eux – les conséquences de leurs sanglantes expéditions.
Citons Victor Hugo : « La guerre c’est la guerre des hommes. La paix c’est la guerre des idées. »
« Guerre d’Algérie, les appelés n’avaient pas le choix »
Guy Le Floch (Loire-Atlantique) :
« Merci et bravo à votre lecteur (O.-F. du 10 février). En effet, je suis entièrement d’accord avec son courrier nommé « Morts pour la France dans l’anonymat ». Bien que n’étant pas allé en Algérie durant mon service militaire classe 58 1 A, orphelin de guerre et pupille de la nation, j’ai quand même effectué vingt-huit mois sous les drapeaux.
J’ai deux camarades qui se sont fait tuer en pénétrant dans une grotte où se trouvaient des combattants algériens et un autre s’est suicidé après ce qu’il avait enduré.
Mes camarades n’avaient pas demandé à participer à cette opération appelée « maintien de l’ordre ». Ils étaient obligés d’y participer, contrairement aux soldats des opérations extérieures (Mali, Burkina, etc.) qui ont opté pour le métier des armes avec tout ce que comporte cette profession. Bien sûr, je compatis à la douleur de la famille et des amis. »

Le témoignage de Jacques Pous, l’un de ceux qui ont dit NON.Pourquoi si peu de refus à faire la guerre ?
Il ne faut pas oublier que la plupart des appelés sortaient de l’enfance (c’était le cas de la plupart de ceux que j’ai rencontrés au 24e RIMa) et ce n’est pas la lecture de Bled et de la grande presse, les discours lénifiants ou menteurs des politiques, des Églises et de la plus grande partie de ce que l’on appelle les élites qui allaient leur ouvrir les yeux. L’important, dans l’immédiat, c’était la bouffe et les "perms" (lorsque l’on a passé plusieurs jours dans une caserne, l’on est prêt à tout pour ne pas se faire punir et "se la faire" …) et, dans un avenir beaucoup plus lointain, compter à combien "au jus" l’on en était et "la quille, bordel", horizon ultime de la présence à l’armée, cri lancé avec dérision, par des centaines de milliers de jeunes, pour éviter de pleurer face à l’absurde. Le grand public et surtout les responsables de la politique de la France en Algérie n’avaient pas voulu, durant huit ans, entendre des gosses qui hurlaient leur souffrance, leur sentiment d’abandon et parfois même leur dégoût (Des rappelés témoignent) et maintenant ils étaient une nouvelle fois victimes d’une entreprise de récupération qui allait alimenter le silence dans lequel certains d’entre eux allaient s’emmurer.
Tous, par contre, ont eu le sentiment de ne pas être compris et même parfois d’être jugés et condamnés lors de leur retour dans une société civile qui ne s’était intéressée à l’Algérie que lorsqu’un proche était concerné. Ils savaient que parmi eux ils avaient été nombreux à ne pas participer aux exactions, qu’il s’en était trouvé quelques-uns qui, comme des appelés le racontent à Patrick Rotman et Bertrand Tavernier, avaient bien traité des prisonniers, soigné des adversaires blessés, refusé de participer à la torture ou qui, comme le brigadier Monjardet, avaient été héroïques en refusant de tirer, malgré les ordres, sur des fellahs désarmés.
Tous ceux-là ne pourront que refuser les généralisations dont ils étaient victimes et qui étaient la conséquence de l’amnistie accordée aux véritables coupables.
Comment d’ailleurs pourrait-on juger des gosses auxquels l’on avait inculqué la soumission à l’autorité alors que l’on ne sait pas ce que, à leur place, l’on aurait fait. Pour ma part, en tous cas, je me refuse de me mettre dans la position du si : qu’aurais-je fait ou pas fait si … Ce qui compte, c’est ce que j’ai fait ou pas fait. C’est pourquoi il m’est difficile de juger les autres, en particulier ceux de ma génération, car je connais trop la part d’animalité et la part d’humanité qui hantent l’homme ; si j’avais été dans la même situation qu’eux, j’aurais, peut-être, agi comme eux. Cette problématique du « si » n’a, par ailleurs, aucun intérêt car il est à tout jamais impossible de savoir ce que l’on aurait fait si … Ceux qui prétendent le savoir s’illusionnent. Des enquêtes d’opinion ont d’ailleurs montré que, dans la génération de la paix, ils sont nombreux à proclamer que s’ils avaient été confrontés aux situations auxquelles ont été confrontés les appelés de la génération du feu, ils auraient refusé d’y participer ; à les entendre, si la même alternative leur était proposée, (11,5 % des élèves de terminale interrogés en 1977 par Jean-Pierre Vittori auraient opté pour la désertion), le chiffre fantaisiste des trois mille réfractaires serait donc aujourd’hui largement dépassé.
Reste enfin une forte minorité qui a été victime de ce que l’on appelle le stress du combattant ou de la culpabilité de s’en être sorti ou encore du dégoût pour ce qu’ils avaient fait. Ce sont les véritables victimes d’une guerre que, dès 1955, Guy Mollet considérait comme "imbécile et sans issue" ; sans oublier ce qu’ont subi ceux d’en face qui, lors d’un conflit asymétrique sont dix fois plus exposés aux séquelles de la guerre. De nombreux travaux concernent les traumatismes des GI’s retour du Vietnam, d’Irak ou d’Afghanistan ; qu’en est-il des Vietnamiens, des Irakiens ou des Afghans qu’ils ont massacrés ? Qu’en est-il des Algériens, des réfugiés croisés en Tunisie, des Moudjahidins traumatisés par huit ans de guerre, des millions de personnes regroupées dans ce qui trop souvent ressemblait à des camps de concentration ? Peut-être qu’un jour les historiens se demanderont quelles ont pu être les séquelles lointaines de la guerre sur la population algérienne et sur un avenir de violences qui, là aussi, s’enracinent dans un passé qui ne veut pas passer.
Quant à moi, j’avais choisi la trahison comme règle de vie : comment en effet ne pas trahir ses idéaux si l’on ne se résout pas, un jour, à trahir son pays. Toutefois, je n’ai pas eu immédiatement conscience qu’avoir pu dire NON, qu’avoir pu trahir en réalité et non en rêve, est une chance qui n’est pas donnée à tous ; l’obsession de trahir et la frustration de ne pouvoir le faire seront au cœur de mes engagements futurs. Combien de fois, par la suite, n’ai-je pas regretté de ne pouvoir refuser d’aller au Vietnam, de ne pouvoir refuser d’aller se battre en Irak ou en Afghanistan, de ne pouvoir désobéir à l’ordre d’aller bombarder la Serbie ou Gaza. De nombreux témoignages d’appelés du contingent mentionnent d’ailleurs le sentiment d’impuissance qui les étreignait lorsqu’ils étaient témoins de crimes contre lesquels ils avaient l’impression de ne pouvoir rien faire. Je ne voudrais pas, comme cela a été le cas pour eux, qu’un jour l’on vienne me dire que je suis responsable ou que je dois me repentir de crimes décidés et perpétrés par d’autres alors que l’on ne m’aurait jamais donné la parole et la possibilité de m’y opposer.
Les associations d’anciens combattants, la FNACA ou l’UNC-AFN, au lieu de faire répéter par la dernière génération du feu les rites dérisoires du passé, auraient dû l’amener à demander des comptes à tous ceux qui, durant quarante ans, allaient continuer à diriger la France : eux, les décideurs politiques, ils savaient ce qu’ils faisaient. Ce n’est pas un hasard si ce sont d’abord les rappelés, ensuite les sursitaires et enfin les étudiants qui se sont le plus opposés au discours officiel. La grande erreur des tenants de l’Algérie française est d’avoir accordé des sursis ! Toutefois, plusieurs appelés, regroupés dans l’Association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre qui, eux, ont servi, durant de nombreux mois, "Au pays de la soif et de la peur" ne seront pas dupes et refuseront les décorations en chocolat (Carte, Croix et Retraite du combattant), telles ces médailles du travail que le système accorde aux prolétaires pour qu’ils se souviennent et se félicitent jusqu’à la mort d’avoir été exploités.
Le communiste Étienne Boulanger, "insoumis sous l’uniforme", qui s’était résigné à servir après deux années passées en prison, refusera le certificat de bonne conduite et la médaille commémorative des opérations de maintien de l’ordre en Algérie que l’armée avait finalement décidé de lui attribuer. "Je ne me sentais pas une âme de médaillé, proclame-t-il. Le chien du régiment était à côté de moi. Je trouvais que ce chien, qui avait été dressé à mordre les Arabes sur commande, – le dressage n’avait pas marché pour moi – était plus méritant que moi. Je lui ai donc passé la médaille autour du cou". Quant à Jean Faure, il note dans ses carnets : « A Tizi Ouzou, dans la rigidité militaire, beaucoup à dire aussi sur les obsèques de ce copain. “Nous vous conférons la médaille militaire … la croix de la valeur militaire avec palmes …”, etc. Conférez tout ce que vous voudrez, ça ne vous coûte pas cher. Mais jamais vous ne rendrez la vie à Philibert, ni Philibert à sa famille ».
Jacques Pous

Henri Pouillot l’a dit et même écrit avant
Emmanuel Macron
«La colonisation est un crime contre l’humanité»

La droite, l’extrême droite et il faut ajouter ce qu’on appelle la fachosphère sont vent debout, criant au scandale contre les propos qu’a déclarés Emmanuel Macron, à Alger en 2017 « La colonisation est un crime contre l’humanité » avant lui Henri Pouillot, ancien appelé de la guerre d’Algérie, qui a été témoin de la torture à la villa Susini (terme exact : Sésini) à Alger avait envoyé une lettre ouverte à François Hollande (et je suis solidaire avec Henri Pouillot) dont voici un passage essentiel : « En particulier pendant la Guerre de Libération de l’Algérie, la France a une terrible responsabilité qu’elle n’a toujours pas reconnue, ni donc condamnée :
Ce sont des crimes d’état : du 8 Mai 1945 à Sétif / Guelma / Khératta les massacres qui ont fait plus de 40.000 victimes, du 17 octobre 1961 au Pont Saint-Michel à Paris où plusieurs centaines d’Algériens ont été massacrés, noyés dans la Seine, assassinés par la police, du 8 février 1962 au Métro Charonne à Paris où 9 militants pacifiques ont été assassinés par le Police
Ce sont des crimes de guerre : avec l’utilisation des gaz VX et Sarin (voir les témoignages publiés sur mon site : le premier et le second ), avec l’utilisation du napalm (600 à 800 villages ont été rasés : des Oradour-sur-Glane algériens !!!)
Ce sont des crimes contre l’humanité : le colonialisme, l’institutionnalisation de la torture, les viols, les exécutions sommaires (corvées de bois, "crevettes Bigeard"…), les essais nucléaires du Sahara, les camps d’internements (pudiquement appelés camps de regroupements qui ont fait des centaines de milliers de morts)… Alors Monsieur le Président, avant de donner des leçons de droits de l’homme comme vous venez de le faire, la parole de la France dans ce domaine aurait un autre poids si vous aviez fait les gestes symboliques nécessaires de reconnaissance et de condamnation de ces crimes commis au nom de notre pays. Dans quelques mois, ce sera le 60ème anniversaire de la Bataille d’Alger où l’Armée Française a généralisé les exactions, ne serait-il pas plus que temps que la France, par votre intervention intervienne dans ce sens ? »
Illustration de ce à quoi ressemble une Crevette Bigeard
L’expression « crevettes Bigeard » désigne les personnes qui auraient été exécutées lors de « vols de la mort », en étant jetées depuis un hélicoptère en mer Méditerranée, les pieds coulés dans une bassine de ciment, lors de la guerre d’Algérie, plus particulièrement pendant la bataille d’Alger en 1957.
La Villa SUSINI (SESINJ), un lieu symbolique, d’un lourd passé

« C’est dans cette Villa, à Alger, que je me suis retrouvé à effectuer la fin de mon service militaire, pendant la Guerre d’Algérie, de juin 1961 à mars 1962.
Ce lieu fut utilisé, pendant les 8 années de cette guerre, sans interruption, comme centre de torture. »Henri Pouillot

Ce sera ma conclusion
Pourquoi j’ai refusé la


Ma participation à cette guerre d’Algérie j'y étais opposé, je l’ai donc subie et je le regrette, quant à mon statut de combattant, j'ai été contraint de l'accepter...
Ceux qui ont participé à la seconde guerre mondiale, c'était leur devoir ou d'autres qui se sont engagés dans la Résistance ou ont rejoint l’armée de la France Libre pour combattre le nazisme. Ils choisirent, et firent là actes de citoyens libres et responsables. Si j’avais été dans ce cas-là j’aurai accepté la croix du combattant… mais en aucun cas pour la sale guerre coloniale d’Algérie…
Je refuse de considérer les anciens des guerres coloniales de la France comme des combattants au même titre que ceux qui se sont engagés pour des causes justes ? (contre le nazisme par exemple). Les appelés et rappelés sont des victimes des politiciens pro-coloniaux de l'époque.
La croix du combattant je l'ai refusée parce qu'en Algérie on ne défendait pas la France mais l'Empire colonial.

A la place de la croix du combattant je suis fier de voir la colombe de la Paix
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par micheldandelot1 le 21 Février 2022 à 10:26
Accords d'Evian : une "mémoire discrète" 60 ans plus tard

Les funérailles de Camille Blanc, maire d'Evian, tué lors d'une explosion en mars 1961. © RDB/ullstein bild via Getty Images GEO AVEC AFP Publié le 21/02/2022 à 9h19
Suite de mon article (lien ci-dessous). Moi aussi j’avais visité Evian en 2013, mais aujourd’hui je suis triste de lire ce nouvel article, je m’aperçois que rien n’a vraiment été fait pour garder les souvenirs de la signature des Accords d’Evian le 18 mars 1962 dans cette ville historique.
Michel Dandelot
La ville d'Evian garde peu de traces des Accords du 18 mars 1962 ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie, largement occultés dans les mémoires locales par l'assassinat du maire, tué dans un attentat avant même l'ouverture des négociations.
31 mars 1961, "flash" de l'AFP : "M. Camille Blanc, maire d'Evian, est mort des suites de ses blessures". Deux "puissantes charges de plastic" ont éclaté "à 02H35", "à 15 secondes d'intervalle", dans l'impasse séparant "la mairie de l'hôtel Beau Rivage, propriété et résidence de M. Blanc".
Socialiste, grand résistant, ce militant de la paix avait œuvré pour accueillir dans sa ville les pourparlers qui déboucheront un an plus tard sur un cessez-le-feu destiné à mettre fin à la guerre d'Algérie. L'élégante cité thermale est sous le choc. "C'était un cœur d'or", pleurent les habitants.
Aujourd'hui, que reste-t-il ? "Rien. Les Evianais ont décidé de tourner la page après l'assassinat", d'autant que dans cette ville d'eau proche de la Suisse, les Accords ont "été associés à deux saisons touristiques catastrophiques en 1962 et 1963", résume l'ancien adjoint municipal PS Serge Dupessey, 78 ans.
"Il n'y a pas d'endroit", pas de lieu de commémoration, car "on sent encore cette blessure" de l'assassinat et la guerre d'Algérie demeure "un épisode sensible", décrypte la maire d'Evian Josiane Lei (DVD). L'hôtel Beau rivage est aujourd'hui à l'abandon.
Sur sa façade décrépie, une plaque rend hommage au maire assassiné. Sans mention de l'implication de l'OAS, organisation clandestine opposée à l'indépendance algérienne.
"Guerre civile"
Les visites guidées de l'Office du tourisme font halte ici, ainsi qu'à l'hôtel de ville contigu, ancienne résidence d'été somptueuse des frères Lumière, les inventeurs du cinéma. Une verrière soufflée par l'attentat n'a pas été refaite à l'identique "pour précisément rappeler ce drame", explique Frédérique Alléon, responsable de l'Office.
Les visites guidées excluent l'ex-hôtel du Parc, plus excentré, où les délégations du gouvernement français et du FLN discutèrent pendant des mois, sous haute surveillance. L'établissement Art-déco dominant le lac Léman est devenu une résidence privée, le "salon inondé de soleil" où furent conclus les Accords, comme le racontait l'envoyé spécial de l'AFP le 18 mars 1962, a été transformé.
"On a voulu accompagner notre circuit historique jusqu'à l'entrée du parc" de l'ancien palace, mais habitants et résidents "ont eu du mal à accepter", explique la maire d'Evian. Serge Dupessey se souvient aussi que "c'est un Evianais de l'OAS qui a assassiné, avec des complices évianais" et "que de la famille de l'assassin habite encore ici". Ce qui selon lui, a pu entretenir une "atmosphère de guerre civile".
Aussi, ses efforts pour convaincre au début des années 1990 l'ancien maire Henri Buet de "faire quelque chose" en mémoire des accords sont-ils restés vains. Même refus en 2011 d'un autre maire, Marc Francina, de baptiser une rue du nom des Accords du 18 mars.
Et lorsque, pour le 50e anniversaire, la société d'histoire savoisienne La Salésienne réunit des universitaires au Palais des Congrès, "des anciens de l'OAS, venus avec un cercueil, manifestent devant", raconte son président Claude Mégevand. Pour le 60e anniversaire, donc, "on a fait le choix, en accord avec la préfecture", d'une cérémonie "comme d'habitude, aux monuments aux morts", avec porte-drapeaux, anciens combattants et harkis, explique la maire.
"C'est une période sensible avec les élections", souligne-t-elle, allusion au risque de récupération politique avant la présidentielle. Des projets existent néanmoins, en liaison avec la date-anniversaire. Une conférence sur Albert Camus et l'Algérie est programmée le 18 mars dans un centre culturel jouxtant la résidence du Parc.
Celle qui l'anime, Claude Gerbaulet, une ancienne médecin pied-noir, entend "ne pas réveiller les querelles sanguinaires, tout en mettant le doigt sur les insuffisances de la France". Les écoles d'Evian préparent une "journée de la paix" - le 24 mai, "après les élections" insiste Mme Lei- avec une chanson écrite par les enfants.
Et le lycée Anna de Noailles fait plancher ses terminales sur le thème "60 ans des accords d'Evian, histoire et mémoires de la guerre d'Algérie", avec intervention de témoins - ex-appelé, harki, pied-noir et descendant du FLN. "Ça m'intéresse de faire travailler les élèves sur les traces de la guerre d'Algérie ici. La conclusion, qui interpelle les élèves, est qu'il s'agit d'une mémoire discrète", estime Renaud Vieuguet, professeur d'histoire.
Un de ses élèves Louis Bailly, 17 ans, acquiesce : "J'habite avenue des Grottes", où se trouve l'ex-hôtel du Parc, "mais je ne savais pas avant que les accords avaient été signés là".
Source : Accords d'Evian : une "mémoire discrète", 60 ans plus tard - Geo.fr
Suite à cet article Jean-Philippe Ould Aoudia nous rappelle ce qui s'est passé au cours d'un colloque qui a eu lieu à Evian le samedi 17 mars 2012.

À gauche : un groupe d’anciens parachutistes opposés à la tenue du colloque. (DR)
Le samedi 17 mars 2012, l’association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons, l’Anpromevo et La Salévienne ont organisé un colloque Les accords d’Evian : la paix en Algérie ?
La tenue de ce colloque avait fait l’objet de plusieurs menaces, certaines au plus haut niveau de l’Etat, qui ont justifié la protestation de l’association Marchand-Feraoun.
Quelques anciens parachutistes, coiffés de leur béret d’appartenance et venus de Grenoble par train, étaient présents devant le Palais des festivités protégé par un escadron de CRS. A quelques mètres, quelques harkis avaient passé la nuit sous une tente pour protester contre le sort qui leur avait été réservé à la suite de ces Accords. Marc Francina, maire d’Evian, s’est trouvé dans l’impossibilité d’ouvrir le colloque. Jean-François Gavoury et moi-même avons dû procéder au contrôle des personnes avant leur entrée dans la salle, pour éviter toute perturbation.
Des journalistes de la presse algérienne ont rendu compte de la tenue et du contenu de ce colloque. La presse française s’est tue.
ASSOCIATION LES AMIS DE MAX MARCHAND,
DE MOULOUD FERAOUN ET DE LEURS COMPAGNONS
2 mars 2012
COMMUNIQUÉ
La République au service des extrémistes de l’Algérie française
D’anciens ultras, soutenus par des membres du gouvernement, veulent imposer une écriture et une mémoire partisanes de la guerre d’Algérie.
En deux occasions récentes, l’État n’a pas hésité à porter atteinte aux libertés de réunion et d’expression :
- l’opposition publique du député-maire de Nice, Christian Estrosi, à la tenue d’une conférence -débat animée par des historiens sur le thème "Algérie 1962, pourquoi une fin de guerre si tragique ? » a entraîné la perturbation du colloque.
- l’hostilité ouverte du ministre chargé des rapatriés, M. Marc Laffineur, dans son appel lancé le 22 février contre un colloque d’universitaires prévu à Nîmes, pourrait inciter les autorités locales à son interdiction.
Une réunion s’est tenue le 22 février entre Christian Frémont, directeur de cabinet du président de la République et Renaud Bachy, président de la Mission interministérielle aux rapatriés d’une part et, d’autre part, des représentants du lobby pro colonial, l’un d’entre eux ancien déserteur ayant appartenu à l’OAS.
Lors de cette rencontre, rapportée par l’un des participants, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy se serait ému que des colloques universitaires puissent se tenir, même sur des sujets rigoureusement neutres, tels que "Les Accords d’Évian : la paix en Algérie ? », thème retenu par notre association le 17 mars prochain.
Serait-il interdit à des historiens, enseignants dans des Universités, d’essayer de répondre à une question historique, dès lors que celle-ci concerne l’écriture de la guerre d’Algérie ?
Les partisans de l’Algérie française détiendraient-ils la vérité sur cette période de l’histoire de France ?
Christian Frémont aurait même demandé quelle serait l’initiative du candidat Nicolas Sarkozy susceptible de plaire à ses interlocuteurs, considérés comme des conseillers de la Présidence.
Ainsi, pour des mobiles électoraux, la République flatte ceux-là même qui regrettent toujours de n’avoir pu la renverser et assassiner le général de Gaulle.
Porteuse du souvenir des six dirigeants des Centres sociaux éducatifs assassinés le 15 mars 1962 par « les singes sanglants de l’OAS qui faisaient la loi à Alger(1)] », l’association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons condamne la volonté de l’Etat, à ses plus hauts niveaux, d’empêcher la tenue de colloques universitaires, pour obtenir les suffrages des nostalgiques les plus extrémistes de l’Empire colonial français.
Jean-Philippe Ould Aoudia
Président.
(1) Article de Germaine Tillion, déportée résistante fondatrice des Centres sociaux, Le Monde 18 mars 1962.
Quotidien algérien El Watan avec AFP – 25 mars 2012
Rubrique : Histoire
Retour sur le Colloque d’Evian. «Sortir de la guerre d’Algérie : regards croisés, regards apaisés»
Une séquence réussie d’échanges entre historiens, témoins et acteurs
Pour les organisateurs du colloque «Sortir de la guerre d’Algérie : regards croisés, regards apaisés » qui s’est tenu les 17 et 18 mars derniers à Evian, il s’agissait de comprendre et d’aider à comprendre les enkystements mémoriels, les idées reçues, les non-dits ou dits erronés, de replacer les faits dans leur contexte et dans leur véracité.
Evian, de notre envoyée spéciale
Certains thèmes comme celui des harkis (dont un petit groupe était devant le Palais des festivités pendant la durée du colloque, ndlr) ont déjà été abordés à Chambéry l’an dernier. Ce présent colloque en est la suite. Nous savons que les plaies ne sont pas refermées », « comprendre l’histoire est aussi une thérapie pour ceux qui en ont souffert et pour passer à quelque chose de plus constructif», a affirmé Claude Mégevand, président de la Salévienne (société d’histoire régionale de Savoie). Eugène Blanc, représentant l’Association des professeurs d’histoire et de géographie de Grenoble et Jean-Philippe Ould Aoudia, président de l’association Les amis de Max Marchand, Mouloud Feraoun et leurs compagnons, n’en ont pas dit moins.
Ce colloque se voulait «apaisé» et «en dehors de la politique». «Place aux historiens, aux témoins pour offrir des regards apaisés et apaisants, aux regards des spécialistes sur des événements douloureux pour construire une paix démocratique, une paix définitive, totalement nourrie d’un respect mutuel tendu vers le développement humain», a affirmé, pour sa part, Eric Brunat, vice-président de l’université de Savoie, chargé des relations internationales. Gilles Manceron, historien et président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme (co-organisatrice) a fait une mise au point à propos du 19 Mars comme date de la fin de la guerre : «Un certain nombre de gens disent qu’il ne doit pas y avoir de commémoration car le conflit a continué au-delà de cette date. C’est le cas de nombreux conflits, qu’on prenne l’exemple du 11 Novembre ou du 8 Mai 1945, la guerre s’est poursuivie, notamment dans le Pacifique. L’argument est biaisé et quand le secrétaire d’Etat annonce qu’il n’y aura pas de commémoration officielle, c’est une manière de céder à des arguments fallacieux.»
L’historien avance qu’on ne peut pas évacuer le rôle de l’OAS ; quant à la question des supplétifs, elle fait partie de l’histoire, mais il faut la «contextualiser», ce sont «des gens enrôlés, instrumentalisés par l’armée, victimes d’abandon par le pouvoir politique français». Et comme l’écrit l’historienne Raphaëlle Branche dans son dernier livre Guerre d’Algérie, une histoire apaisée ?, qui a servi de fil conducteur à ce colloque : «Assumer la part coloniale de l’histoire nationale est encore un chantier politique à construire. Il apparaît comme un préalable à un changement de regard sur la guerre d’Algérie. Sans cette prise en compte élargie, on continuera à voir cette séquence historique comme le début d’une histoire sociale et politique française marquée par la perte, la douleur, la défaite, alors qu’elle n’est qu’un moment dans les relations entre la France et l’Algérie, un moment marqué par la fin d’une relation politique inégale et la délégitimation de l’idéologie coloniale.» Il a été question de la dimension savoyarde des Accords d’Evian avec l’évocation du maire d’Evian, Camille Blanc, assassiné par l’OAS le 31 mars 1961 ; de l’archevêque d’Alger Mgr Duval ; de la diplomatie helvétique ; du regard des Allemands sur la guerre d’Algérie ; du point de vue des Algériens au titre des regards croisés, d’autres regards croisés avec un gros plan sur l’enseignement de la guerre d’Algérie de chaque côté des deux rives de la Méditerranée, enseignement qui évolue dans le temps mais qui pose la question préalable fondamentale sur les objectifs de l’enseignement de l’histoire.
Concernant l’écriture de l’histoire en Algérie, Gilbert Meynier note qu’elle reste une histoire officielle, marquée par quelques évolutions, avec toutefois une impasse sur la berbérité. Faisant référence au récent colloque à Tlemcen sur l’Emir Abelkader auquel il a pris part, «j’ai eu l’impression que la mentalité changeait, que les esprits s’ouvraient». Et l’historien de noter que sur la commémoration du cinquantenaire des Accords d’Evian les deux Etats, algérien et français sont absents. De toutes les communications, témoignages, débats denses de ces deux jours d’échanges nous ne pouvons, faute de place, rendre toute la teneur. Nous proposons toutefois une synthèse de quelques-unes des communications. Les organisateurs se chargent pour leur part d’en éditer les actes dans un proche avenir. Nadjia Bouzeghrane
Retour sur la fusillade de la rue d’Isly, le 26 mars 1962
«Les jours d’après : le drame de la fusillade de la rue d’Isly (26 mars 1962) : histoire et mémoire»
L’historien Alain Ruscio a replacé la fusillade de la rue d’Isly, le 26 mars 1962, dans son contexte, celui d’une «escalade de la violence de l’OAS contre l’armée française et la population algérienne». Il a rappelé que le général putchiste Salan avait prôné «l’offensive généralisée» contre l’armée française, donnant consigne à ses activistes l’emploi de bouteilles explosives. Instrumentalisant la population européenne, Salan l’avait considérée comme un «outil valable». L’annonce de la signature des Accords de cessez-le-feu précipite l’escalade. «Je donne l’ordre de harceler les forces armées partout en Algérie», dit Salan. «Le cessez-le-feu de de Gaulle n’est pas le nôtre.»
Le général Salan jette la population européenne d’Alger dans la rue pour faire le forcing de Bab El Oued, bouclé par l’armée. La majorité des commentaires relève l’irresponsabilité de ceux qui ont envoyé la population à la mort. L’OAS cherchait-elle le martyr, se demande l’historien. «L’OAS porte la plus lourde responsabilité de ce drame.» Et de citer les propos de Jean-Jacques Susini (fondateur de l’OAS) : «La violence était mûrement planifiée dès le début de l’organisation, nous cherchions à mobiliser la population européenne.» Alain Ruscio considère que Susini et ses comparses «ont changé le cours de l’histoire, ont précipité le départ des Européens d’Algérie».
Jean-Philippe Ould Aoudia rappelle que pour le seul mois de mars, il y a eu 611 attentats de l’OAS, soit 20 par jour. Et il rappelle que le 25 février 1962, le général Salan donnait l’ordre de s’attaquer aux intellectuels musulmans chaque fois qu’ils seront soupçonnés de sympathie avec le FLN ».Nadjia Bouzeghrane
Gilles Manceron : « L’OAS empêchait le processus de transition »
[El Watan, 17 mars 2012]L’historien et spécialiste de la colonisation française en Algérie, Gilles Manceron, estime, dans un entretien à l’APS, que pour progresser vers une perception apaisée du passé, il faut dépasser ce ressassement des mémoires meurtries et accepter la libre recherche historique.
- 50 ans après la signature des Accords d’Evian, on n’arrive toujours pas à dépasser le « contentieux historique » entre l’Algérie et la France. L’entente conclue à Evian a-t-elle définitivement « scellé » la paix entre les deux pays ?
Si les Accords d’Evian ont marqué l’arrêt de la guerre entre l’armée française et l’ALN, ils ont laissé place à une guerre des mémoires qui s’est poursuivie depuis cinquante ans. En effet, puisqu’ils ne disent rien sur les causes de cette guerre ni sur la légitimité de la lutte de l’un des camps qui s’affrontaient, toutes les interprétations différentes ont pu perdurer. L’urgence était d’arrêter la guerre. Dans ces conditions, la société algérienne qui gardait le souvenir de la violence de la colonisation et, dans la société française, ont pu perdurer majoritairement les mythes anciens sur « l’œuvre coloniale civilisatrice » ainsi que le déni officiel des crimes coloniaux. Le courant anti-colonial dans la société française était très minoritaire en 1962. Aucune parole officielle n’est venue lui donner raison.
- Au lendemain de la signature de ces Accords, le sang a continué à couler de part et d’autre, la plupart des actions meurtrières étant l’œuvre de l’OAS. En dépit du fait que les Accords prévoyaient des « garanties » à l’égard des Européens pour rester ou quitter l’Algérie, les affrontements se poursuivaient. La non-mise sur pied d’une autorité pour veiller à l’application stricte du cessez-le-feu en serait-elle l’unique raison ?
L’OAS refusait l’indépendance de l’Algérie et elle a tout fait pour empêcher le processus de transition que prévoyaient les Accords d’Evian. En se lançant dans des attentats terroristes qui ont tué de nombreux civils algériens, elle a compromis le maintien en Algérie d’un nombre important de pieds-noirs. Les négociateurs d’Evian envisageaient le maintien d’environ 400 000 pieds-noirs. Il n’en est resté que moins de 200 000 à la fin de l’année 1962. L’OAS, en s’attaquant à l’exécutif provisoire qui devait organiser la transition vers l’indépendance, a compromis leur avenir en Algérie. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle les Accords n’ont pas été appliqués. Ils prévoyaient des « garanties » pour la population européenne. Mais un courant partisan d’une citoyenneté algérienne fondée sur la seule religion musulmane et la seule langue arabe, qui existait de manière minoritaire dans le FLN dès le début et avait été désavoué lors du Congrès de la Soummam en août 1956, n’a cessé de prendre de l’importance avec la prolongation de la guerre et l’accroissement des violences entre les communautés. Ce courant ne voulait pas non plus qu’un nombre important d’Européens prenne leur place dans l’Algérie indépendante.
- Aujourd’hui, la France continue dans le déni de ses crimes coloniaux en Algérie. La reconnaissance par la République de son passé peu glorieux était-elle la seule à même de jeter un regard apaisé sur cette guerre et de permettre d’entrevoir un avenir meilleur pour les deux pays et les deux peuples. Et quelles sont, selon vous, les raisons qui poussent le président Sarkozy à continuer dans le déni (discours de Perpignan, notamment), tout en faisant un clin d’œil aux nostalgiques de l’Algérie française, se recrutant essentiellement parmi l’extrême droite ?
C’est essentiellement dans un but électoral que le président Sarkozy a choisi de rechercher l’appui de la fraction de l’opinion restée attachée à la colonisation. Cela l’a conduit à faire réapparaître au grand jour des discours racistes et colonialistes, alors que, pendant une vingtaine d’années, cette fraction de l’opinion ne pesait pas lourd parmi les forces politiques du pays. Après la loi de 2005 sur la « colonisation positive », cela a donné, en 2007, les discours du président Sarkozy sur le « refus de la repentance ». Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, on assiste à la résurgence de haines anciennes. Mais ceux qui les expriment ne font pas le poids face à la volonté de comprendre des nouvelles générations, au travail des historiens et aux efforts de nombreuses associations. Pour progresser vers une perception apaisée du passé, il faut dépasser ce ressassement des mémoires meurtries, il faut accepter la libre recherche historique, à l’écart de toutes les instrumentalisations officielles. Pour qu’une connaissance se développe sur la base des regards croisés des historiens des deux pays.
 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique